Jules Verne
claudius bombarnac
(Chapitre XXII-XXVII)
55 illustrations par Leon Benett
6 grandes gravures en chromotypographie
2 cartes en couleurs
Bibliothèque D’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
![]() insi, moi qui voulais un incident, j’ai été servi à souhait, et je n’aurais qu’à remercier le Dieu des reporters, s’il n’y avait pas eu de victimes de notre côté. Je suis sorti sain et sauf de la bagarre. Tous mes numéros sont intacts, hormis deux ou trois éraflures insignifiantes. Seul, mon numéro 4 a été traversé d’une balle de part en part – dans son chapeau de noce.
insi, moi qui voulais un incident, j’ai été servi à souhait, et je n’aurais qu’à remercier le Dieu des reporters, s’il n’y avait pas eu de victimes de notre côté. Je suis sorti sain et sauf de la bagarre. Tous mes numéros sont intacts, hormis deux ou trois éraflures insignifiantes. Seul, mon numéro 4 a été traversé d’une balle de part en part – dans son chapeau de noce.
A présent, je n’ai plus en perspective que la reprise du mariage Bluett-Ephrinell! et le dénouement de l’aventure de Kinko. En effet, je ne pense pas que le rôle du seigneur Faruskiar nous réserve de nouvelles surprises. On peut compter sur le casuel, il est vrai, puisque le voyage est pour durer cinq jours encore. En comprenant le retard occasionné par l’affaire Ki-Tsang, cela fera juste treize jours depuis le départ d’Ouzoun-Ada.
Treize jours… Diable!… Et il y a treize numéros inscrits sur mon carnet… Si j’étais superstitieux, cependant!
Nous sommes restés trois heures à Tcharkalyk. La plupart des voyageurs n’ont point quitté leurs couchettes. On s’est occupé des déclarations relatives à l’attaque du train, des morts que l’autorité chinoise fera ensevelir, des blessés qui doivent être laissés à Tcharkalyk, où les soins ne leur manqueront pas. C’est une bourgade populeuse, m’a dit le jeune Pan-Chao, et j’ai le regret de n’avoir pu la visiter.
Quant à la Compagnie du Grand-Transasiatique, elle enverra sans délai des ouvriers, afin de réparer la voie, relever les poteaux télégraphiques, et, en quarante-huit heures, la circulation pourra être en entier rétablie.
Il va sans dire que le seigneur Faruskiar, avec toute l’autorité d’un administrateur de la Compagnie, a pris part aux diverses formalités qui ont été remplies à Tcharkalyk. Je ne saurais trop faire son éloge. D’ailleurs il est récompensé de ses bons offices par les déférences que lui marque le personnel de la gare.
Trois heures du matin – arrivée à Kara-Bouran, où le train n’a stationné que quelques minutes. C’est là que le railway coupe l’itinéraire du voyage de Gabriel Bonvalot et du prince Henri d’Orléans à travers le Tibet en 1889-90. Voyage autrement complet que le nôtre, autrement pénible, autrement périlleux, voyage circulaire de Paris à Paris, par Berlin, Pétersbourg, Moscou, Nijni, Perm, Tobolsk, Omsk, Sémipalatinsk, Kouldja, Tcharkalyk, Batang, Yunnan, Hanoï, Saigon, Singapore, Ceylan, Aden, Suez, Marseille – le tour de l’Asie et le tour de l’Europe.
Le train fait halte au Lob-Nor à quatre heures et repart à six. Ce lac, dont le général Petzoff a visité les rives en 1889, lorsqu’il revenait de son expédition du Tibet, n’est qu’un vaste marécage semé d’îlots de sable, à peine entourés d’un mètre d’eau. Le pays où le Tarim promène son cours épais et lent, avait déjà été reconnu par les pères Huc et Gabet, les explorateurs Prjevalski et Carey jusqu’à la passe Davana, située à cent cinquante kilomètres vers le sud. Mais, à partir de cette passe, Gabriel Bonvalot et le prince Henri d’Orléans, campant parfois à cinq mille mètres d’altitude, se sont aventurés à travers des territoires vierges, au pied de la superbe chaîne himalayenne.
C’est dans la direction de l’est, vers le Kara-Nor, que pointe notre itinéraire, en longeant la base des monts Nan-Chan, derrière lesquels se développe la région du Tsaïdam. Le railway n’a pas osé s’aventurer au milieu des montagneuses contrées du Kou-Kou-Nor, et c’est en contournant ce massif que nous atteindrons la grande cité de Lan-Tchéou.
Cependant, si le pays est triste, les voyageurs de notre train vont avoir cent raisons de ne pas l’être. Une journée de fête s’annonce avec ce beau soleil, dont les rayons dorent à perte de vue les sables du Gobi. Depuis le Lob-Nor jusqu’au Kara-Nor, il y a trois cent cinquante kilomètres à parcourir, et c’est entre ces deux lacs que s’accomplira le mariage si malencontreusement interrompu de Fulk Ephrinell et de miss Horatia Bluett. Espérons-le, aucun incident ne viendra cette fois retarder le bonheur des deux époux.
Dès l’aube, le wagon-restaurant a été réinstallé pour cette cérémonie, les témoins sont prêts à reprendre leur rôle, et les futurs ne peuvent qu’être dans les mêmes dispositions.
Le révérend Nathaniel Morse, en venant nous prévenir que le mariage sera célébré à neuf heures, nous présente les compliments de M. Fulk Ephrinell et de miss Horatia Bluett.
Le major Noltitz et moi, M. Caterna et Pan-Chao, nous serons sous les armes à l’heure dite.
M. Caterna ne croit pas devoir réendosser son habit de marié villageois, ni Mme Caterna son costume de mariée villageoise. Ils ne s’habilleront que pour le grand dîner qui sera servi à huit heures du soir, – dîner offert par M. Fulk Ephrinell à ses témoins et aux notables des wagons de première classe. Notre trial en gonflant sa joue gauche, me laisse entendre qu’il y aura une «surprise» au dessert. Laquelle?… Je n’insiste pas par discrétion.
Un peu avant neuf heures, la cloche du tender a été mise en branle. Qu’on se rassure, elle n’annonce point un accident. C’est nous que ses joyeux tintements appellent au dining-car, et nous marchons en procession vers le lieu du sacrifice.
M. Fulk Ephrinell et miss Horatia Bluett sont déjà assis devant la petite table en face du digne clergyman, et nous prenons place autour d’eux.
Sur les plates-formes se sont groupés les curieux empressés à ne rien perdre de la cérémonie nuptiale.
Le seigneur Faruskiar et Ghangir, qui avaient été l’objet d’une invitation personnelle, viennent d’arriver. L’assistance se lève respectueusement pour les recevoir. Ils doivent signer à l’acte de mariage. C’est un grand honneur, et, s’il se fût agi de moi, j’aurais été fier de voir l’illustre nom du seigneur Faruskiar figurer à la dernière page de mon contrat.
La cérémonie est reprise, et, cette fois, le révérend Nathaniel Morse a pu achever son speech, si regrettablement interrompu la surveille. Ni les assistants ni lui n’ont été culbutés par un arrêt prématrimonial du train.
Les deux futurs, – ils ont encore droit à cette qualification, – se lèvent alors, et le clergyman leur demande s’ils consentent à s’accepter réciproquement pour époux.
Avant de répondre, miss Horatia Bluett, se tournant vers Fulk Ephrinell, lui dit, les lèvres pincées:
«Il est bien entendu que la participation de la maison Holmes-Holme sera de vingt-cinq pour cent dans les bénéfices de notre association…
– Quinze, répond Fulk Ephrinell, quinze seulement.
– Ce ne serait pas juste, puisque j’accorde trente pour cent à la maison Strong Bulbul and Co…
– Eh bien, disons vingt pour cent, miss Bluett.
– Soit, monsieur Ephrinell.
– Mais c’est bien parce que c’est vous!» ajoute M. Caterna, qui murmure cette phrase à mon oreille.
En vérité, j’ai vu le moment où le mariage allait être tenu en échec pour un écart de cinq pour cent!
Enfin tout s’est arrangé. Les intérêts des deux maisons ont été sauvegardés de part et d’autre. Le révérend Nathaniel Morse réitère sa question.
Un oui sec de miss Horatia Bluett, un oui bref de Fulk Ephrinell lui répondent, et les deux époux sont déclarés unis par les liens du mariage.
L’acte est alors signé, eux d’abord, puis les témoins, puis le seigneur Faruskiar, puis les assistants. Enfin le clergyman y appose son nom et son paraphe, – ce qui clôt la série de ces formalités réglementaires.
«Les voilà rivés pour la vie, me dit le trial avec son petit mouvement d’épaule.
– Pour la vie… comme deux bouvreuils! ajoute en souriant la dugazon, qui n’a point oublié que ces oiseaux sont cités pour la fidélité de leurs amours.
– En Chine, fait observer le jeune Pan-Chao, ce ne sont point les bouvreuils, ce sont les canards mandarins, qui symbolisent la fidélité dans le mariage.
– Canards ou bouvreuils, c’est tout un!» réplique philosophiquement M. Caterna.
La cérémonie est achevée. On complimente les époux. Chacun retourne à ses occupations. Fulk Ephrinell à ses comptes, mistress Ephrinell à son ouvrage. Rien n’est changé dans le train: il n’y a que deux conjoints de plus.
Le major Noltitz, Pan-Chao et moi, nous allons fumer sur une des plates-formes, laissant à leurs préparatifs M. et Mme Caterna, qui m’ont l’air de faire une répétition en leur coin. C’est probablement la surprise du soir.
Peu varié, le paysage. Toujours ce monotone désert du Gobi avec les hauteurs des monts Humboldt sur la droite, vers la partie qui se rattache aux monts Nan-Chan. Stations assez rares, et encore ne s’agit-il que d’une agglomération de huttes, entre lesquelles la maison du cantonnier produit l’effet d’un monument. C’est là que se renouvellent l’eau et le charbon du tender. Au delà du Kara-Nor, où apparaîtront quelques bourgades, l’approche de la véritable Chine, populeuse et laborieuse, se fera sérieusement sentir.
Cette partie du désert de Gobi ne ressemble guère aux régions du Turkestan oriental que nous avons traversées en quittant Kachgar. Ce sont des territoires aussi nouveaux pour Pan-Chao et le docteur Tio-King que pour nous Européens.
Je dois dire que le seigneur Faruskiar ne dédaigne plus de se mêler à notre conversation. C’est un homme charmant, instruit, spirituel, avec lequel je compte faire plus ample connaissance, lorsque nous serons arrivés à Pékin. Il m’a déjà invité à lui rendre visite en son yamen, et ce sera l’occasion de le mettre à la question… de l’interview. Il a beaucoup voyagé, et semble professer une sympathie particulière pour les journalistes français. Il ne refusera pas de s’abonner au XXe Siècle, j’en suis sûr. – Paris, 48 francs; départements, 56; étranger, 76.
Donc, tandis que le train file à toute vapeur, on cause de choses et d’autres. A propos de la Kachgarie, dont le nom a été prononcé, le seigneur Faruskiar veut bien nous donner des détails très intéressants sur cette province, qui fut si profondément troublée par les mouvements insurrectionnels. C’était à l’époque où la capitale, résistant aux convoitises chinoises, n’avait pas encore subi la domination russe. Maintes fois, nombre de Célestes furent massacrés lors des révoltes des chefs turkestans, et la garnison dut se réfugier dans la forteresse de Yanghi-Hissar.
Parmi ces chefs d’insurgés, il y en eut un, cet Ouali-Khan-Toulla, dont j’ai parlé déjà à propos du meurtre de Schlagintweit, et qui devint temporairement le maître de la Kachgarie. C’était un homme très intelligent, mais d’une férocité peu commune. Et le seigneur Faruskiar nous cite un trait, de nature à donner une idée du caractère impitoyable de ces Orientaux.
«Il y avait à Kachgar, dit-il, un armurier de renom, qui, désireux de s’assurer les faveurs d’Ouali-Khan-Toulla, fabriqua un sabre d’un grand prix. L’ouvrage terminé, il chargea son fils, son garçon de dix ans, d’aller offrir ce sabre, espérant que l’enfant recevrait quelque récompense de la royale main. Il en reçut une. Ce personnage, après avoir admiré le sabre, demanda si la lame était de première trempe: «Oui, répondit l’enfant. – Approche alors!» dit Ouali-Khan-Toulla, et d’un seul coup, il lui abattit la tête qu’il renvoya à son père avec le prix de ce sabre dont il venait d’éprouver l’excellente qualité.»
Ce récit a été fait avec une parfaite justesse d’inflexions. Mais si M. Caterna l’eût entendu, je pense qu’il ne m’aurait pas demandé d’en tirer le sujet d’une opérette turkestane.
La journée s’est écoulée sans incident. Le train a marché avec son allure modérée d’une quarantaine de kilomètres à l’heure, – moyenne qui se fût élevée à quatre-vingts, si on eût écouté le baron Weissschnitzerdörfer. La vérité est que les mécaniciens et les chauffeurs chinois ne s’inquiétèrent en aucune façon de regagner le temps perdu entre Tchertchen et Tcharkalyk.
A sept heures du soir, nous arrivons au Kara-Nor pour y stationner cinquante minutes. Ce lac, qui n’est pas aussi étendu que le Lob-Nor, absorbe les eaux du Soule-Ho, descendu des monts Nan-Chan. Nos regards sont charmés par les massifs de verdure qui encadrent sa rive méridionale, animée du vol de nombreux oiseaux. A huit heures, lorsque nous quittons la gare, le soleil s’est couché derrière les dunes de sable, et une sorte de mirage, produit par réchauffement des basses couches de l’atmosphère, prolonge le crépuscule au-dessus de l’horizon.
Sitôt partis, sitôt à table. Le dining-car a repris son aspect de restaurant, et voici le repas de noces qui va remplacer le repas réglementaire. Une vingtaine de convives ont été invités à cette agape railwayenne, et en premier lieu le seigneur Faruskiar. Mais, pour une raison ou une autre, il a cru devoir décliner l’invitation de Fulk Ephrinell.
Je le regrette, car j’espérais que ma bonne chance m’aurait placé près de lui.
La pensée me vient alors que ce nom illustre vaut la peine d’être envoyé à la direction du XXe Siècle, – ce nom et aussi quelques lignes relatives à l’attaque du train, aux péripéties de la défense. Jamais information n’aura mieux mérité d’être expédiée par un télégramme, si cher qu’il coûte. Cette fois, je ne risque pas de m’attirer une semonce. Nulle erreur possible, dans le genre de celle qui s’est produite à propos du faux mandarin Yen-Lou que j’ai sur la conscience… Il est vrai, c’était dans le pays du faux Smerdis, et là peut être mon excuse.
C’est entendu, dès que nous serons arrivés à Sou-Tchéou, puisque la ligne télégraphique aura été rétablie en même temps que la voie ferrée, je ferai passer une dépêche, qui révélera à l’admiration de l’Europe entière le nom brillant de Faruskiar.
Nous voici à table. Fulk Ephrinell a fait les choses aussi bien que le permettent les circonstances. En vue de ce festin, les provisions ont été renouvelées à Tcharkalyk. Ce n’est plus la cuisine russe, c’est la cuisine chinoise, apprêtée par un cuisinier chinois, à laquelle nous allons faire honneur. Par chance, nous ne serons pas condamnés à manger au moyen de bâtonnets, et les fourchettes ne sont point prohibées des repas du Grand-Transasiatique.
Je suis placé à la gauche de mistress Ephrinell, le major Noltitz à la droite de Fulk Ephrinell. Les autres convives se sont assis au hasard. Le baron allemand, qui n’est point homme à bouder devant un bon morceau, est au nombre des convives. Quant à sir Francis Trevellyan, il n’a pas même répondu par un signe à l’invitation qui lui a été faite.
Pour commencer, potages au poulet et aux œufs de vanneaux; puis, des nids d’hirondelles, coupés en fils, des jaunes de crabes en ragoût, des gésiers de moineaux, des pieds de cochon rôti préparés à la sauce, des moelles de mouton, des holoturies frites, des ailerons de requin très gélatineux; enfin, des pousses de bambou au jus, des racines de nénuphar au sucre, – toutes victuailles les plus invraisemblables, arrosées du vin de Chao-Hing, qui est servi tiède dans des théières de métal.
La fête est très gaie, et comment dirais-je? très intime, – à cela près que le marié ne s’occupe aucunement de la mariée… et réciproquement.
Quel loustic intarissable que notre trial! Quel jet continu de calembredaines incomprises pour la plupart, de calembours antédiluviens, de coq-à-l’âne dont il rit de si bon cœur qu’il est difficile de ne pas rire avec lui. Il veut apprendre quelques mots de chinois, et Pan-Chao ayant dit que «tching-tching» signifie merci, il a «tching-tchingué» à tout propos avec des intonations burlesques.
Puis, ce sont des chansons françaises, des chansons russes, des chansons chinoises, – entre autres «le Shiang-Touo-Tching», la Chanson de la rêverie, dans laquelle notre jeune Céleste répète que «les fleurs du pêcher sentent bon à la troisième lune et celles du grenadier rouge à la cinquième».
Ce festin s’est prolongé jusqu’à dix heures. A ce moment, le trial et la dugazon, qui s’étaient éclipsés avant le dessert, font leur entrée, l’un en houppelande de cocher, l’autre en caraco de bonne, et ils ont joué les Sonnettes avec un entrain, une verve, un brio!… En vérité, ce ne serait que justice si Claretie, sur la recommandation de Meilhac et d’Halévy, leur faisait une place parmi les pensionnaires de la Comédie-Française.
A minuit, la fête a pris fin. Chacun de nous a regagné son compartiment. Nous n’entendons même pas crier le nom des stations qui précèdent Lan-Tchéou, et c’est entre quatre et cinq heures du matin qu’une halte de quarante minutes nous retient dans la gare de cette bourgade.
Le pays se modifie sensiblement à mesure que le railway descend au-dessous du quarantième degré, afin de contourner la base orientale des monts Nan-Chan. Le désert s’efface peu à peu, les villages sont moins rares, la densité de la population s’accroît. Aux terrains sablonneux se substituent les plaines verdoyantes, et même les rizières, car les montagnes voisines déversent abondamment leurs eaux sur ces hautes régions du Céleste-Empire. Nous ne nous plaignons pas de ce changement, après les tristesses du Kara-Koum et les solitudes du Gobi. Depuis la Caspienne, les déserts ont incessamment succédé aux déserts, sauf à travers les massifs du plateau de Pamir. Jusqu’à Pékin, maintenant, ni les sites pittoresques, ni les horizons de montagnes, ni les profondes vallées, ne manqueront au parcours du Grand-Transasiatique. Nous entrons en Chine, la véritable Chine, celle des paravents et des porcelaines, sur les territoires de cette vaste province du Kin-Sou. En trois jours, nous serons arrivés au terme du voyage, et ce n’est pas moi, simple correspondant de journal, voué à d’interminables déplacements, qui me plaindrai de sa longueur. Bon pour Kinko, enfermé dans sa caisse, et pour la jolie Zinca Klork, dévorée d’inquiétudes en sa maison de l’avenue Cha-Coua!
Nous faisons halte pendant deux heures à Sou-Tchéou. Mon premier soin est de courir au bureau télégraphique. Le complaisant Pan-Chao veut bien me servir d’interprète. L’employé nous apprend que les poteaux de la ligne ont été relevés, de sorte que les dépêches suivent leur direction normale.
Aussitôt je lance au XXe Siècle un télégramme ainsi conçu:
«Sou-Tchéou 25 mai 2h. 25 soir.
«Train attaqué entre Tchertchen et Tcharkalyk par bande du célèbre Ki-Tsang voyageurs ont repoussé attaque et sauvé trésor chinois morts et blessés de part et d’autre chef tué par héroïque seigneur mongol Faruskiar un des administrateurs de Compagnie dont nom doit être objet d’admiration universelle.»
Si cette dépêche ne me vaut pas une gratification de mon directeur…
Deux heures pour visiter Sou-Tchéou, c’est maigre.
Jusqu’alors, en Turkestan, nous avions toujours vu deux villes juxtaposées, une ancienne et une nouvelle. En Chine, ainsi que le fait observer Pan-Chao, deux villes et même trois ou quatre comme à Pékin, sont emboîtées l’une dans l’autre.
Ici, Taï-Tcheu est la ville extérieure, et Le-Tcheu, la ville intérieure. Ce qui nous frappe d’abord, c’est que toutes deux présentent un aspect désolé. Partout des traces d’incendie, ça et là des pagodes ou des maisons à demi détruites, un amas de ces débris qui ne sont point l’œuvre du temps, mais l’œuvre de la guerre. Cela tient à ce que Sou-Tchéou, prise autrefois par les Musulmans et reprise par les Chinois, a subi les horreurs de ces luttes barbares, qui finissent par la destruction des édifices et le massacre des habitants de tout âge et de tout sexe.
Il est vrai, les populations se refont rapidement au Céleste-Empire, plus rapidement que les monuments ne se relèvent de leurs ruines. Aussi Sou-Tchéou est-elle redevenue populeuse dans sa double enceinte comme dans les faubourgs qui lui donnent accès. Le commerce y est florissant, et, en nous promenant à travers la rue principale, nous avons remarqué de nombreuses boutiques bien achalandées, sans parler des revendeurs ambulants.
Et là, pour la première fois, M. et Mme Caterna ont vu passer, entre les habitants qui se rangeaient plutôt par crainte que par respect, un mandarin à cheval, lequel était précédé d’un domestique portant un parasol à franges, marque de la dignité de son maître.
Puis, il est une curiosité qui vaut la visite à Sou-Tchéou; là vient aboutir la fameuse Grande-Muraille du Céleste-Empire.
Après avoir redescendu au sud-est vers Lan-Tchéou, cette muraille remonte vers le nord-est en couvrant les provinces du Kian-Sou, de Chan-si et de Petchili jusqu’au nord de Pékin. Ici, ce n’est plus qu’une sorte d’épaulement en terre, rehaussé de quelques tours, ruinées pour la plupart. J’aurais cru manquer à tous mes devoirs de chroniqueur, si je n’étais allé saluer à son début cette œuvre gigantesque, qui dépasse tous les travaux de nos modernes fortificateurs.
«Est-elle réellement utile, cette Muraille de la Chine?… m’a demandé le major Noltitz.
– Aux Célestes, je ne sais, ai-je répondu, mais certainement à nos orateurs politiques, auxquels elle sert de comparaison, quand ils discutent des traités de commerce. Sans elle, que deviendrait l’éloquence législative?»
![]()
![]() e n’ai pas vu Kinko depuis quarante-huit heures, et encore, la dernière fois, n’ai-je pu échanger que quelques paroles pour le rassurer.
e n’ai pas vu Kinko depuis quarante-huit heures, et encore, la dernière fois, n’ai-je pu échanger que quelques paroles pour le rassurer.
La nuit prochaine, j’essaierai de lui rendre visite; j’ai soin de me procurer des provisions à la gare de Sou-Tchéou.
Nous sommes partis à trois heures. Nos wagons sont attelés à une locomotive plus puissante. A travers ces territoires accidentés, les rampes sont quelquefois assez raides. Sept cents kilomètres nous séparent de l’importante cité de Lan-Tchéou, où nous ne devons arriver que le lendemain matin, en marchant à une vitesse de dix lieues à l’heure.
Je fais observer à Pan-Chao que cette moyenne est relativement peu élevée.
«Que voulez-vous? me répond-il en croquant des graines de pastèque, vous ne changerez pas et rien ne changera le tempérament des Célestes. Comme ils sont conservateurs à l’excès, ils conserveront cette vitesse, quels que soient les progrès de la locomotion. Et d’ailleurs, monsieur Bombarnac, que l’Empire du Milieu possède des chemins de fer, je trouve déjà cela assez invraisemblable!
– Je ne dis pas le contraire, ai-je répondu. Cependant, quand on se donne des railways, c’est pour en tirer tous les avantages qu’ils comportent.
– Bah! fit insoucieusement Pan-Chao.
– La vitesse, ai-je répondu, c’est du temps gagné, et gagner du temps…
– Le temps n’existe pas en Chine, monsieur Bombarnac, et il ne peut exister pour une population de quatre cents millions d’hommes. Il en resterait trop peu pour chacun. Aussi n’en sommes-nous même pas à compter par jours et par heures… C’est toujours par lunes et par veilles…
– Ce qui est plus poétique que pratique, ai-je répondu.
– Pratique, monsieur le reporter! En vérité, vous autres Occidentaux, vous n’avez que ce mot à la bouche! Être pratique, mais c’est être esclave du temps, du travail, de l’argent, des affaires, du monde, des autres, de soi-même! Je vous l’avoue, pendant mon séjour en Europe, – demandez au docteur Tio-King, – je n’ai guère été pratique, et maintenant, revenu en Asie, je ne le serai pas davantage. Je me laisserai vivre, voilà tout, comme le nuage se laisse emporter par la brise, le brin de paille par le courant, la pensée par l’imagination…
– Je vois, dis-je, qu’il faut prendre la Chine comme elle est…
– Et comme elle sera probablement toujours, monsieur Bombarnac. Ah! si vous saviez combien l’existence y est facile, – un adorable far niente entre paravents dans le calme des yamens! Le souci des affaires nous préoccupe peu, le souci de la politique encore moins. Songez donc! Depuis Fou-Hi, premier empereur en 2950, un contemporain de Noé, nous en sommes à la vingt-troisième dynastie. Actuellement, elle est mandchoue, et ce qu’elle sera plus tard, qu’importé! Avons-nous un gouvernement ou n’en avons-nous pas, lequel de ses fils le Ciel a-t-il choisi pour faire le bonheur de ses quatre cents millions de sujets, à peine si nous le savons et désirons le savoir!»
Il est évident que le jeune Céleste a mille et dix mille fois tort, pour employer sa formule numérative; mais ce n’est pas moi qui l’entreprendrai à ce propos.
Au dîner, M. et Mrs. Ephrinell, placés l’un près de l’autre, ont à peine échangé quelques paroles. Leur intimité semble moins étroite depuis qu’ils ont été mariés. Peut-être sont-ils absorbés dans le calcul de leurs intérêts réciproques, encore mal fusionnés. Ah! ils ne comptent pas par lunes et par veilles, ces Anglo-Saxons! Ils sont pratiques, trop pratiques!
La nuit a été fort mauvaise. Le ciel, d’une teinte pourpre et sulfurée, était devenu très orageux vers le soir, l’atmosphère étouffante, la tension de l’électricité excessive. Cela nous vaut un orage «extrêmement réussi». C’est du moins l’expression dont M. Caterna a cru devoir se servir, en ajoutant qu’il n’a jamais rien vu de mieux, si ce n’est peut-être au second acte du Freyschütz pendant la chasse infernale. La vérité est que le train court, pour ainsi dire, au milieu d’une zone éblouissante d’éclairs, à travers un retentissement de foudre que l’écho des montagnes prolonge indéfiniment. Je pense même que le tonnerre a dû tomber à plusieurs reprises; mais les rails métalliques, s’emparant du fluide, forment comme autant de conducteurs qui préservent les wagons de ses atteintes. C’est, en vérité, un beau spectacle, quelque peu effrayant, ces feux de l’espace que la pluie torrentielle ne peut éteindre, ces décharges continues des nuages, auxquels se mêlent les sifflets stridents de notre locomotive, lorsqu’elle passe devant les stations de Yanlu, de Youn-Tcheng, de Houlan-Sieu et de Da-Tsching.
A la faveur de cette nuit si troublée, j’ai pu communiquer avec Kinko, lui remettre les provisions, et m’entretenir pendant quelques instants avec lui.
«C’est après-demain, m’a-t-il demandé, que nous serons arrivés à Pékin, monsieur Bombarnac?
– Oui… après-demain, Kinko, si le train ne subit aucun retard.
– Oh! je ne crains point les retards! Mais, lorsque ma caisse sera dans la gare de Pékin, je ne serai pas encore rendu à l’avenue Cha-Coua…
– Qu’importé, Kinko, puisque la jolie Zinca Klork se trouvera à la gare…
– Non, monsieur Bombarnac, et je lui ai bien recommandé de n’y pas venir.
– Pourquoi?…
– Les femmes sont si impressionnables! Elle chercherait à voir le fourgon où j’ai voyagé, elle réclamerait cette caisse avec une insistance qui pourrait éveiller les soupçons… Enfin, elle risquerait de se trahir…
– Vous avez raison, Kinko.
– D’ailleurs nous n’arriverons en gare que dans l’après-midi, fort tard peut-être, et le camionnage des colis ne se fera que le lendemain…
– C’est probable…
– Eh bien, monsieur Bombarnac, si ce n’est pas abuser, je vous demanderai encore un léger service.
– Qu’attendez-vous de moi?…
– Que vous veuillez assister au départ de la caisse, afin d’éviter tout accident…
– Je serai là, Kinko, je serai là, je vous le promets. Diable! des glaces, c’est fragile, et je veillerai à ce qu’on ne les manie pas trop rudement. Et même, si vous le voulez, j’accompagnerai la caisse jusqu’à l’avenue Cha-Coua…
– Je n’osais vous en prier, monsieur Bombarnac…
– Vous aviez tort, Kinko. On ne doit pas se gêner avec un ami, et je suis le vôtre. D’ailleurs, cela me sera très agréable de faire la connaissance de mademoiselle Zinca Klork. Je veux être là, quand on fera livraison de la caisse, la précieuse caisse… je l’aiderai à la déclouer…
– La déclouer, monsieur Bombarnac! Et mon panneau?… Ah! que j’aurai vite fait de sauter à travers mon panneau…»
Un épouvantable coup de tonnerre interrompt notre conversation. J’ai cru que le train allait être jeté hors des rails par la commotion de l’air. Je quittai donc le jeune Roumain et regagnai ma place à l’intérieur du wagon.
Le matin, – 26 mai, sept heures, – arrivée à la gare de Lan-Tchéou. Trois heures d’arrêt – trois heures seulement. Voilà ce que nous vaut l’attaque de Ki-Tsang. Allons, major Noltitz, allons, Pan-Chao, allons, M. et Mme Caterna, en route… Nous n’avons pas une minute à perdre.
Mais, au moment de quitter la gare, nous sommes arrêtés par l’apparition d’un grand, gros, gris, gras et grave personnage. C’est le gouverneur de la ville, en double robe de soie blanche et jaune, éventail à la main, ceinture à boucle, et mantille, – une mantille noire qui ferait meilleur effet sur les épaules d’une manola. Il est accompagné d’un certain nombre de mandarins à globules, et les Célestes le saluent en rapprochant leurs deux poings qu’ils meuvent de bas en haut avec inclinaison de la tête.
Ah ça! que vient-il faire, ce monsieur-là?… Est-ce encore quelque formalité chinoise?… La visite des voyageurs et des bagages va-t-elle recommencer?… Et Kinko que je croyais hors de toute complication…
Rien d’inquiétant, il ne s’agit que du trésor dont le Grand-Transasiatique est chargé pour le Fils du Ciel. Le gouverneur et sa suite se sont arrêtés devant le précieux wagon, verrouillé et plombé, et ils le regardent avec cette admiration respectueuse que l’on éprouve, – même en Chine, – devant un coffre-fort renfermant plusieurs millions.
Je demande alors à Popof ce que signifie la présence dudit gouverneur, et si cela nous regarde:
«En aucune façon, répond Popof. L’ordre est venu de Pékin de télégraphier l’arrivée du trésor. C’est ce que le gouverneur a fait, et il attend une réponse pour savoir s’il doit le diriger sur Pékin ou le garder provisoirement à Lan-Tchéou.
– Cela ne saurait nous retarder?…
– Je ne le pense pas.
– Alors en route», dis-je à mes compagnons.
Mais, si la question du trésor impérial nous laisse indifférents, il ne paraît pas en être ainsi du seigneur Faruskiar. Et cependant, que ce wagon parte ou ne parte pas, qu’il reste accroché à notre train ou qu’on l’en décroche, en quoi cela peut-il l’intéresser? Toutefois, Ghangir et lui semblent très contrariés, bien qu’ils cherchent à n’en rien laisser voir, tandis que les Mongols, prononçant quelques mots à voix basse, jettent au gouverneur de Lan-Tchéou des regards peu sympathiques.
En ce moment, le gouverneur vient d’être mis au courant de ce qui s’est passé pendant l’attaque du train, de la part que notre héros a prise à la défense du trésor impérial, du courage avec lequel il s’est battu, comment il a délivré le pays de ce terrible Ki-Tsang. Et alors, en termes louangeurs que Pan-Chao s’empresse de nous traduire, il remercie le seigneur Faruskiar, il le complimente, il lui fait entendre que le Fils du Ciel saura reconnaître ses services…
L’administrateur du Grand-Transasiatique l’écoute de cet air tranquille qui le caractérise, non sans quelque impatience, je le vois très clairement. Peut-être se sent-il supérieur aux éloges comme aux récompenses, même quand ils viennent de si haut. Je reconnais là toute la fierté mongole.
Mais ne nous attardons pas. Que le wagon au trésor continue ou ne continue pas sur Pékin, peu nous importe! Ce qui est intéressant, c’est de visiter Lan-Tchéou.
Quoique nous l’ayons fait sommairement, il m’en est resté un souvenir assez net.
Et d’abord, il existe une ville extérieure et une ville intérieure. Pas de ruines, cette fois. Cité bien vivace, population très fourmillante et très active, familiarisée par le chemin de fer avec la présence des étrangers qu’elle ne poursuit plus comme autrefois de ses curiosités indiscrètes. De vastes quartiers occupent la droite du Houan-Ho, large de deux kilomètres. Ce Houan-Ho, c’est le fleuve Jaune, le fameux fleuve Jaune, lequel, après un cours de quatre mille cinq cents kilomètres, précipite ses eaux argileuses dans les profondeurs du golfe de Petchili.
«Est-ce que ce n’est pas à son embouchure près de Tien-Tsin que le baron doit prendre le paquebot pour Yokohama? demande le major Noltitz.
– C’est là même, ai-je répondu.
– Il le manquera, réplique le trial.
– A moins qu’il ne trotte, notre globe-trotter!
– Le trot d’un âne dure peu, comme on dit, riposte M. Caterna, et il n’arrivera pas…
– Il arrivera si le train n’a plus de retard, fait observer le major. Nous serons en gare de Tien-Tsin, le 23, dès six heures du matin, et le paquebot ne part qu’à onze.
– Qu’il manque le paquebot ou non, mes amis, ai-je répliqué, ne manquons pas notre promenade!»
En cet endroit, un pont de bateaux traverse le fleuve Jaune, dont le courant est si rapide que le tablier est soumis à un véritable mouvement de houle. Mme Caterna, qui a cru pouvoir s’y hasarder, commence à pâlir.
«Caroline… Caroline… s’écrie son mari, tu vas avoir le mal de mer! Allons… amène-toi… amène-toi!»
Mme Caterna «s’amène», et nous remontons vers une pagode qui domine la ville.
Ainsi que tous les monuments de ce genre, cette pagode ressemble à une pile de compotiers, placés les uns sur les autres; mais ces compotiers sont d’une jolie forme, et ils seraient en porcelaine de Chine qu’on ne pourrait s’en étonner.
Vu, aussi, mais sans y pénétrer, d’importants établissements industriels, une fonderie de canons, une fabrique de fusils, dont le personnel est d’origine indigène. Parcouru un beau jardin, attenant à la maison du gouverneur, avec son capricieux ensemble de ponts, kiosques, vasques, portes en forme de potiches. Il y a là plus de pavillons et de toits retroussés que d’arbres et d’ombrages. Puis, ce sont des allées pavées de briques, entre les restes du soubassement de la Grande-Muraille.
Il était dix heures moins dix, lorsque nous sommes revenus à la gare, absolument éreintés, car la promenade a été rude, absolument essoufflés, car la chaleur est très forte.
Mon premier soin est de chercher du regard le wagon aux millions. Il est toujours à la même place, l’avant-dernier du train, sous la surveillance des gendarmes chinois.
En effet, la dépêche, attendue par le gouverneur, est arrivée: ordre de diriger ledit wagon sur Pékin, où le trésor sera remis entre les mains du Ministre des Finances.
Où donc est le seigneur Faruskiar?… Je ne l’aperçois pas. Est-ce qu’il nous aurait faussé compagnie?…
Non! le voici sur une des plates-formes, et les Mongols sont remontés dans leur wagon.
Quant à Fulk Ephrinell, il est allé faire quelques courses de son côté, – des échantillons de ses produits à colporter sans doute, – et Mrs. Ephrinell est allée du sien, – un simple marché de cheveux à conclure très probablement. Tous deux reviennent en ce moment et reprennent leur place habituelle, sans même avoir l’air de se connaître.
Quant aux autres voyageurs, ce sont uniquement des Célestes, – les uns à destination de Pékin, les autres ayant pris leurs billets pour les stations intermédiaires, Si-Ngan, Ho-Nan, Lon-Ngan, Taï-Youan. Le train doit compter une centaine de voyageurs. Tous mes numéros sont à leur poste. Il n’en manque pas un… Treize, toujours treize!
Nous étions encore sur la plate-forme au moment où le signal du départ a été donné, lorsque M. Caterna demande à Mme Caterna ce qu’elle a trouvé de plus curieux à Lan-Tchéou:
«De plus curieux, Adolphe?… C’étaient de grandes cages, suspendues aux murs et aux arbres, et qui renfermaient de singuliers oiseaux…
– Singuliers, en effet, madame Caterna, répond Pan-Chao, des oiseaux qui parlaient de leur vivant…
– Comment, c’étaient des perroquets?…
– Non, des têtes de criminels…
– Quelle horreur! s’écrie la dugazon avec un jeu de physionomie des plus expressifs.
– Que veux-tu, Caroline, répond sentencieusement M. Caterna, si c’est la mode dans ce pays!»
![]()
![]() epuis Lan-Tchéou, le railway dessert un pays remarquablement cultivé, arrosé de nombreux cours d’eau, et assez accidenté pour nécessiter de fréquents détours. Aussi les ingénieurs ont-ils dû établir plusieurs ouvrages d’art, ponts et viaducs – ouvrages en charpentes d’une solidité douteuse, et le voyageur n’est guère rassuré, quand il sent ces tabliers fléchir sous le poids du train. Il est vrai, nous sommes dans le Céleste-Empire, et les quelques milliers de victimes d’une catastrophe de chemin de fer compteraient à peine au milieu de ses quatre cents millions d’habitants.
epuis Lan-Tchéou, le railway dessert un pays remarquablement cultivé, arrosé de nombreux cours d’eau, et assez accidenté pour nécessiter de fréquents détours. Aussi les ingénieurs ont-ils dû établir plusieurs ouvrages d’art, ponts et viaducs – ouvrages en charpentes d’une solidité douteuse, et le voyageur n’est guère rassuré, quand il sent ces tabliers fléchir sous le poids du train. Il est vrai, nous sommes dans le Céleste-Empire, et les quelques milliers de victimes d’une catastrophe de chemin de fer compteraient à peine au milieu de ses quatre cents millions d’habitants.
«D’ailleurs, nous dit Pan-Chao, le Fils du Ciel ne va jamais en chemin de fer!»
Allons, tant mieux.
A six heures du soir, nous arrivons à King-Tchéou, après avoir suivi pendant une partie du trajet les contours capricieux de la Grande-Muraille. De cette immense frontière artificielle, élevée entre la Mongolie et la Chine, il ne reste plus que les quartiers de granit et de quartz rougeâtre qui lui servaient de base, sa terrasse en briques avec parapets de hauteurs inégales, quelques vieux canons rongés de rouille et cachés sous l’épais rideau des lichens, puis des tours carrées, à créneaux dépareillés. L’interminable courtine monte, descend, s’infléchit, se redresse, court à perte de vue en épousant les dénivellations du sol.
A six heures du soir, halte d’une demi-heure à King-Tchéou, dont je n’ai fait qu’entrevoir quelques hautes pagodes, et vers dix heures, halte de quarante-cinq minutes à Si-Ngan, dont je n’ai pas même aperçu la silhouette.
Toute la nuit a été employée à parcourir les trois cents kilomètres qui séparent cette ville de Ho-Nan, où nous avons stationné pendant une heure.
Je pense que des Londoniens n’auraient pas eu de peine à se figurer que cette ville de Ho-Nan était Londres, et il est possible que mistress Ephrinell s’y soit trompée. Ce n’est pas qu’il y eût là un Strand, avec son extraordinaire va-et-vient de passants et de voitures, ni une Tamise, avec son prodigieux mouvement de gabares et de bateaux à vapeur. Non! mais nous étions au milieu d’un brouillard si britannique qu’il était impossible de rien voir ni des maisons ni des pagodes embrumées.
Ce brouillard a duré toute la journée, – ce qui a rendu la marche du train assez difficile. Ces mécaniciens célestes sont véritablement très entendus, très attentifs, très intelligents, et méritent d’être donnés en exemple à leurs confrères des railways occidentaux.
Mille chroniques! nous ne sommes pas favorisés pour notre dernier jour de voyage avant d’arriver à Tien-Tsin! Que de copie perdue! Que de reportages anéantis au milieu de ces insondables vapeurs! Je n’ai rien vu des gorges et ravins, à travers lesquels circule le Grand-Transasiatique, rien de la vallée de Lou-Ngan, où nous stationnons à onze heures, rien des deux cent trente kilomètres que nous avons franchis sous les volutes d’une sorte de buée jaunâtre, digne de ce pays jaune, pour faire halte vers dix heures du soir à Taï-Youan.
Ah! la maussade journée!
Heureusement, le brouillard s’est dissipé dès les premières heures de la soirée. Il est bien temps, maintenant qu’il fait nuit, – et une nuit très obscure!
Je vais à la buvette de la gare, où j’achète quelques gâteaux et une bouteille de vin. Mon intention est de rendre une dernière visite à Kinko. Nous boirons ensemble à sa santé, à son prochain mariage avec la jolie Roumaine. Il aura voyagé en fraude, je le sais bien, et si le Grand-Transasiatique le savait… Mais le Grand-Transasiatique ne le saura pas.
Pendant la halte, le seigneur Faruskiar et Ghangir se promènent sur le quai, le long du train. Cette fois, ce n’est point le wagon au trésor qui attire leur attention, c’est le fourgon de tête, et ils semblent y mettre une extrême insistance.
Est-ce qu’ils se douteraient que Kinko?… Non! cette hypothèse est invraisemblable. Ce sont le chauffeur et le mécanicien qui paraissent être plus particulièrement l’objet de leur examen. Ce sont deux braves Chinois, qui viennent de prendre leur tour de service, et peut-être le seigneur Faruskiar n’est-il pas fâché de voir à quelles gens est confiée, avec le trésor impérial, la vie d’une centaine de voyageurs?…
L’heure du départ sonne et à minuit la machine démarre en lançant de violents coups de sifflet.
Ainsi que je l’ai dit, la nuit est très noire, sans lune, sans étoiles. De longs nuages rampent à travers les basses zones de l’atmosphère. Il me sera facile de m’introduire dans le fourgon sans être aperçu. Au total, je n’aurai pas abusé de mes visites à Kinko pendant ces douze jours de voyage.
En ce moment, Popof me dit:
«Vous n’allez pas dormir, monsieur Bombarnac?
– Je ne tarderai pas, ai-je répondu. Après cette journée brumeuse qui nous a chambrés dans nos wagons, j’ai besoin de respirer en plein air. Où le train doit-il s’arrêter?…
– A Fuen-Choo, lorsqu’il aura dépassé le point où vient s’embrancher la ligne de Nanking.
– Bonsoir, Popof.
– Bonsoir, monsieur Bombarnac.»
Me voici seul.
L’idée me prend alors de me promener jusqu’à l’arrière du train et je m’arrête un instant sur la plate-forme qui précède le wagon au trésor.
Tous les voyageurs, à l’exception des gendarmes chinois, dorment de leur dernier sommeil – le dernier, s’entend, sur le railway du Grand-Transasiatique.
Revenu à l’avant du train, je m’approche de la logette où Popof me paraît être profondément endormi.
J’ouvre alors la porte du fourgon, je la referme, et je signale ma présence à Kinko.
Le panneau s’abaisse, la petite lampe nous éclaire. En échange des gâteaux et de la bouteille de vin, je reçois les remerciements de ce brave garçon, et nous buvons à la santé de Zinca Klork, avec laquelle je ferai demain connaissance.
Il est minuit cinquante. Dans une dizaine de minutes, ainsi que l’a dit Popof, nous aurons dépassé l’endroit d’où se détache l’embranchement de la ligne de Nanking. Cet embranchement, établi seulement sur une longueur de cinq ou six kilomètres, conduit au viaduc de la vallée de Tjou. Ce viaduc est un gros ouvrage, – je tiens ces détails de Pan-Chao, – et les ingénieurs chinois n’en ont encore édifié que les piles, dont la hauteur est d’une centaine de pieds au-dessus du sol. C’est au raccordement de cet embranchement avec le Grand-Transasiatique qu’est placée l’aiguille, qui permettra de diriger les trains sur la ligne de Nanking; mais le travail ne sera vraisemblablement pas terminé avant trois ou quatre mois.
Comme je sais que nous devons faire halte à Fuen-Choo, je prends congé de Kinko avec une bonne poignée de main, et je me relève pour sortir…
En ce moment, il me semble que j’entends marcher sur la plate-forme, à l’arrière du fourgon…
«Prenez garde, Kinko!» dis-je à mi-voix.
La petite lampe s’éteint aussitôt, et nous restons tous les deux immobiles.
Je ne me suis pas trompé… Quelqu’un cherche à ouvrir la porte du fourgon.
«Votre panneau…» dis-je.
Le panneau est relevé, la caisse s’est refermée, et je suis seul au milieu de l’obscurité.
Évidemment ce ne peut être que Popof qui va entrer… Que pensera-t-il, s’il me trouve là?…
La première fois que j’ai rendu visite au jeune Roumain, je me suis déjà caché entre les colis… Eh bien! je vais m’y cacher une seconde fois. Lorsque je serai blotti derrière les caisses de Fulk Ephrinell, il n’est pas probable que Popof puisse m’apercevoir – même à la clarté de sa lanterne.
Cela fait, je regarde…
Ce n’est pas Popof, car il aurait apporté sa lanterne.
J’essaie de reconnaître quelles sont les personnes qui viennent d’entrer… C’est difficile… Elles n’ont fait que glisser entre les colis, et, après avoir ouvert la porte antérieure du fourgon, elles l’ont refermée derrière elles…
Ce sont des voyageurs du train, nul doute à cet égard, mais pourquoi en cet endroit… à cette heure?…
Il faut le savoir… J’ai le pressentiment qu’il se machine là quelque chose…
Peut-être en écoutant…
Je m’approche de la paroi antérieure du fourgon, et, malgré les ronflements du train, j’entends assez distinctement…
Mille et dix mille diables, je ne me trompe pas!… C’est la voix du seigneur Faruskiar… Il cause avec Ghangir en langue russe… C’est bien lui!… Les quatre Mongols l’ont accompagné… Mais que font-ils là?… Pour quel motif ont-ils pris place sur la plate-forme qui précède le tender!… Et que disent-ils?…
Ce qu’ils disent, le voici!… Ces demandes et ces réponses, échangées entre le seigneur Faruskiar et ses compagnons, je n’en perds pas un mot.
«Quand serons-nous à l’embranchement?…
– Dans quelques minutes.
– Est-on sûr que Kardek soit à l’aiguille?…
– Oui, puisque cela est convenu.»
Qu’est-ce qui est convenu, et quel peut être ce Kardek dont ils parlent?…
La conversation reprend:
«Il faudra attendre que nous ayons aperçu le signal, dit le seigneur Faruskiar.
– N’est-ce pas un feu vert? demande Ghangir.
– Oui… il indiquera que l’aiguille est faite.»
Je ne sais plus si j’ai toute ma raison… L’aiguille faite?… Quelle aiguille?…
Une demi-minute s’écoule… Ne conviendrait-il pas de prévenir Popof?… Oui… il le faut…
J’allais me diriger vers l’arrière du fourgon, lorsqu’une exclamation me retient.
«Le signal… voici le signal! s’est écrié Ghangir.
– Et maintenant lé train est lancé sur la ligne de Nanking!» réplique le seigneur Faruskiar.
Sur la ligne de Nanking!… Mais alors nous sommes perdus… A cinq kilomètres d’ici se trouve le viaduc de Tjou en construction, et c’est vers un abîme que le train se précipite…
Décidément le major Noltitz ne s’était pas trompé sur le compte du seigneur Faruskiar… Je comprends le projet de ces misérables… L’administrateur du Grand-Transasiatique n’est qu’un malfaiteur de la pire espèce… Il n’a accepté les offres de la Compagnie que pour attendre l’occasion de préparer quelque bon coup… L’occasion s’est présentée avec les millions du Fils du Ciel… Oui! toute cette abominable machination m’est révélée maintenant… Si Faruskiar a défendu le trésor impérial contre Ki-Tsang, ce n’était que pour l’arracher à ce chef de bandits qui avait arrêté le train, et dont l’attaque venait déranger ses criminels projets!… Voilà pourquoi il s’était si bravement battu!… Voilà pourquoi il avait risqué sa vie, pourquoi il s’était conduit en héros!… Et toi, pauvre bête de Claudius, qui t’es laissé prendre!… Encore un impair!… Allons tu feras bien de soigner cela, mon ami!
Avant tout, il faut empêcher ce coquin d’accomplir son œuvre… Il faut sauver le train qui est lancé à toute vitesse vers le viaduc inachevé… Il faut sauver les voyageurs qui courent à une épouvantable catastrophe… Du trésor que Faruskiar et ses complices espèrent s’emparer après l’anéantissement du train, je me moque comme d’une vieille chronique!… Mais les voyageurs et moi… c’est autre chose…
Je veux rejoindre Popof… Impossible… il semble que je sois cloué au plancher du fourgon… Ma tête se perd…
Est-il donc vrai que nous roulions vers l’abîme… Non!… Je suis fou!… Faruskiar et ses complices y seraient précipités… Ils partageraient notre sort… ils périraient avec nous!
En ce moment, des cris retentissent à l’avant du train, – des cris de gens qu’on tue… Pas de doute!… Le mécanicien et le chauffeur viennent d’être égorgés, et je sens que la vitesse du train commence à diminuer…
Je comprends… l’un de ces misérables sait manœuvrer une machine, et le ralentissement va leur permettre de sauter sur la voie, de s’enfuir avant la catastrophe…
Enfin je parviens à vaincre ma torpeur… Trébuchant comme un homme ivre, c’est à peine si j’ai la force de ramper jusqu’à la caisse de Kinko. Là, en quelques mots, je lui apprends ce qui s’est passé, et je m’écrie:
«Nous sommes perdus…
– Non… peut-être», répond-il.
Avant que j’aie pu faire un mouvement, Kinko est sorti de la caisse, il se précipite vers la porte du fourgon, et grimpe sur le tender, en me répétant:
«Venez… venez!…»
Je ne sais comment cela s’est fait, mais, en un instant, je me suis trouvé près de lui sur la plate-forme de la locomotive… les pieds dans le sang, – le sang du chauffeur et du mécanicien, qui ont été précipités sur la voie…
Quant à Faruskiar et à ses complices, ils ne sont plus là!
Mais, avant de s’enfuir, l’un d’eux a desserré les freins, largement ouvert les valves d’introduction de vapeur, chargé le foyer de combustible, et, maintenant, le train est lancé avec une vitesse effroyable…
En quelques minutes, il aura atteint le viaduc de Tjou…
Kinko, énergique et résolu, n’a rien perdu de son sang-froid. Mais en vain essaie-t-il de manœuvrer la manette, de contre-battre la vapeur, d’enrayer la marche en serrant les freins… Il ne sait comment fonctionnent ces robinets et ces leviers…
«Il faut prévenir Popof!… m’écriai-je.
– Et que ferait-il?… Non! il n’y a plus qu’un moyen…
– Lequel?…
– Activer le feu, répond Kinko d’une voix calme, charger les soupapes, faire sauter la locomotive…»
Est-ce donc le seul moyen – moyen désespéré – d’arrêter le train, avant qu’il ait atteint le viaduc?…
Kinko vient d’enfourner des pelletées de charbon sur la grille du foyer. Il se produit un tirage excessif qui appelle des masses d’air à travers la fournaise, la pression monte, la vapeur fuit par les soupapes au milieu des sifflements des joints, des ronflements de la chaudière, des hurlements de la machine… La vitesse s’accélère et doit dépasser cent kilomètres…
«Allez, me crie Kinko, et que tout le monde se réfugie dans les derniers wagons…
– Et vous, Kinko?…
– Allez, vous dis-je.»
Et je le vois s’accrocher des deux mains aux soupapes et peser de tout son poids sur leurs leviers.
«Mais allez donc!» me crie-t-il.
J’escalade le tender, je franchis le fourgon, je réveille Popof, hurlant de toutes mes forces:
«A l’arrière… à l’arrière!»
Quelques voyageurs, brusquement tirés de leur sommeil, se hâtent de quitter les premiers wagons…
Soudain retentit une effroyable explosion, qui est suivie d’une violente secousse. Le train éprouve d’abord comme un mouvement de recul; puis, emporté par la vitesse acquise, il continue de rouler pendant un demi-kilomètre…
Il s’arrête enfin…
Popof, le major, M. Caterna, la plupart des voyageurs, nous sautons aussitôt sur la voie…
Un enchevêtrement d’échafaudages apparaît confusément au milieu de l’obscurité au sommet des piles qui doivent porter le viaduc de la vallée de Tjou…
Deux cents pas plus loin, le train du Grand-Transasiatique était englouti dans l’abîme.
![]()
![]() t moi qui demandais des éléments de chronique, qui craignais les ennuis d’un voyage monotone et bourgeois de six mille kilomètres, au cours duquel je n’aurais rencontré ni une impression ni une émotion susceptibles de revêtir la forme typographique!
t moi qui demandais des éléments de chronique, qui craignais les ennuis d’un voyage monotone et bourgeois de six mille kilomètres, au cours duquel je n’aurais rencontré ni une impression ni une émotion susceptibles de revêtir la forme typographique!
Il n’en est pas moins vrai que j’ai commis une sottise de plus, et une fameuse! Ce seigneur Faruskiar dont j’ai fait – par dépêche – un héros pour les lecteurs du XXe Siècle! Décidément, avec mes bonnes intentions, je mérite de prendre rang entre les meilleurs paveurs de l’enfer.
Nous sommes, je l’ai dit, à deux cents pas de la vallée de Tjou, large dépression, qui a nécessité l’établissement d’un viaduc long de trois cent cinquante à quatre cents pieds. Le thalweg de cette vallée, semé de roches, est à cent pieds de profondeur. Si le train eût été précipité au fond de ce gouffre, pas un de nous n’en serait sorti vivant. Cette mémorable catastrophe, – très intéressante au point de vue du reportage, – se fût chiffrée par une centaine de victimes. Mais, grâce au sang-froid, à l’énergie, au dévouement du jeune Roumain, nous avons échappé à cet effroyable sinistre.
Tous?… Non!… Kinko a payé de sa vie le salut de ses compagnons de voyage.
En effet, au milieu du désarroi général, mon premier soin a été de visiter le fourgon des bagages, qui est resté intact. Évidemment, si Kinko avait survécu à l’explosion, il avait dû rentrer dans ce fourgon, réintégrer sa prison roulante, attendre que je pusse me mettre en communication avec lui…
Hélas! la caisse est vide, – vide comme celle d’une Société en faillite… Kinko a été victime de son sacrifice.
Ainsi il y avait un héros parmi nos compagnons de voyage, et ce n’était pas ce Faruskiar, abominable bandit caché sous la peau d’un administrateur, dont j’ai si maladroitement jeté le nom aux quatre coins du monde! C’était ce Roumain, cet humble, ce petit, ce pauvre fiancé que sa fiancée attendra vainement, qu’elle ne doit plus jamais revoir!… Eh bien! je saurai lui faire rendre justice… Je dirai ce qu’il a fait… Son secret, je me reprocherais de le garder… S’il a fraudé la Compagnie du Grand-Transasiatique, c’est grâce à cette fraude que tout un train de voyageurs a été sauvé!… Nous étions perdus, nous périssions de la plus épouvantable des morts, si Kinko n’eût été là! Je suis redescendu sur la voie, le cœur gros, les yeux pleins de larmes.
Certes, le coup de Faruskiar, – au travers duquel s’était jeté son rival Ki-Tsang, – était habilement combiné en utilisant cet embranchement de six kilomètres qui conduit au viaduc inachevé. Rien n’était plus facile que d’y engager le train si un complice manœuvrait l’aiguille au raccordement des deux lignes. Puis, dès qu’un signal aurait indiqué que nous étions lancés sur l’embranchement, il n’y aurait plus qu’à gagner la plate-forme de la locomotive, à égorger le mécanicien et le chauffeur, et cela fait, à s’enfuir en profitant du ralentissement de la machine à laquelle son foyer surchauffé ne tarderait pas à rendre toute sa vitesse…
Et maintenant, il n’est pas douteux que ces coquins, dignes des tortures les plus raffinées de la justice chinoise, se dirigent en toute hâte vers la vallée de Tjou. C’est là, parmi les débris du train, qu’ils comptent retrouver les quinze millions d’or et de pierres précieuses. Et ce trésor, ils pourront l’emporter sans risquer d’être surpris, et la nuit leur permettra de consommer cet épouvantable crime…
Eh bien! ils seront volés, ces voleurs, et, je l’espère, un si abominable forfait leur coûtera la tête – à tout le moins! Je suis seul à savoir ce qui s’est passé, mais je le dirai, puisque le pauvre Kinko n’est plus…
Oui! mon parti est pris, je parlerai, dès que j’aurai vu Zinca Klork… Il convient que la pauvre fille soit prévenue avec précaution… Je ne veux pas que la mort de son fiancé soit ébruitée et la frappe comme un coup de foudre… Oui!… demain… dès que nous serons arrivés à Pékin…
Après tout, si je ne veux rien raconter encore de ce qui concerne Kinko, je puis du moins dénoncer Faruskiar, Ghangir et les quatre Mongols leurs complices… Je puis dire que je les ai vus traverser le fourgon, que je les ai suivis, que je les ai compris pendant qu’ils s’entretenaient sur la plate-forme, que j’ai entendu les cris des malheureux égorgés à leur poste, que je suis alors revenu vers les wagons en criant: «A l’arrière… à l’arrière!»
Au surplus, ainsi qu’on va le voir, un autre que moi, dont les trop justes soupçons se sont changés en certitude, n’attend que l’occasion de dénoncer le prétendu seigneur Faruskiar!
En ce moment, nous sommes groupés à la tête du train, le major Noltitz, le baron allemand, M. Caterna, Fulk Ephrinell, Pan-Chao, Popof, – une vingtaine de voyageurs environ. Il va sans dire que les gendarmes chinois, fidèles à leur consigne, sont restés près du trésor, que pas un d’eux n’aurait osé l’abandonner. L’employé du dernier fourgon vient d’apporter les fanaux de queue, et leur puissante lumière permet de voir en quel état se trouve la locomotive.
Si le train, qui était alors animé d’une excessive vitesse, ne s’est pas arrêté brusquement – ce qui eût amené sa destruction totale, – c’est que l’explosion s’est produite à la partie supérieure et latérale de la chaudière. Les roues ayant résisté, la locomotive a continué de courir sur les rails assez longtemps pour amortir sa rapidité. Il en résulte donc que le train a fait halte de lui-même, et c’est pourquoi les voyageurs en ont été quittes pour une violente secousse.
Quant à la chaudière et à ses accessoires, il n’en reste que d’informes débris. Plus de cheminée, plus de dôme ni de boîte à vapeur, rien que des tôles éventrées, des tubes rompus et tordus, rien qu’un tuyautage crevé, des cylindres faussés, des bielles désarticulées, – des plaies béantes à ce cadavre d’acier.
Et non seulement la locomotive est détruite, mais le tender est hors de service. Ses caisses à eau sont défoncées, et son chargement de charbon a été dispersé sur la voie. Pour le fourgon de bagages, c’est miracle qu’il n’ait été qu’à peine endommagé.
Et devant les terribles effets de cette explosion, je comprends qu’il ne soit pas resté une seule chance de salut au jeune Roumain, qu’il ait été tué, déchiré, mis en lambeaux!… Aussi, lorsque je me suis traîné sur la voie pendant une centaine de mètres, n’est-il pas étonnant que je n’aie plus rien trouvé de lui!…
Nous regardons ce désastre, en silence d’abord; puis, les propos commencent à s’échanger.
«Il n’est que trop certain, dit un des voyageurs, que notre chauffeur et notre mécanicien ont péri dans l’explosion!
– Les pauvres gens! répond Popof. Mais je me demande comment le train a pu s’engager sur l’embranchement de Nanking et comment ils ne s’en sont pas aperçus?…
– La nuit est très obscure, fait observer Fulk Ephrinell, et le mécanicien n’aura pu voir que l’aiguille avait été faite.
– C’est la seule explication possible, répond Popof, car il eût essayé d’arrêter le train, et, au contraire, nous étions lancés à une vitesse effroyable…
– Mais enfin, dit Pan-Chao, d’où vient que l’embranchement sur Nanking était ouvert, puisque le viaduc de Tjou n’est pas achevé?… L’aiguille avait donc été manœuvrée?…
– Cela est hors de doute, répond Popof, et c’est probablement par suite de négligence…
– Non… de malveillance, réplique Fulk Ephrinell. Il y a eu crime – un crime prémédité pour amener la destruction du train et la perte des voyageurs…
– Et dans quel but? demande Popof.
– Dans le but de voler le trésor impérial, s’écrie Fulk Ephrinell. Oubliez-vous donc que ces millions devaient tenter des malfaiteurs? Est-ce que ce n’est pas pour le piller que notre train a été attaqué entre Tchertchen et Tcharkalyk?…»
L’Américain ne savait pas si bien dire.
«Ainsi, dit Popof, après l’agression de Ki-Tsang, vous pensez que d’autres bandits…»
Jusqu’alors, le major Noltitz n’avait point pris part à ce colloque. Mais le voici qui interrompt Popof et dit en élevant la voix de manière à être entendu de tous:
«Où donc est le seigneur Faruskiar?»
Chacun se retourne et cherche à voir ce qu’est devenu l’administrateur de la Compagnie.
«Où donc est son compagnon Ghangir?» reprend le major.
Pas de réponse.
«Où sont donc les quatre Mongols qui occupaient le dernier wagon?» demande le major Noltitz.
Aucun d’eux ne se présente.
On appelle le seigneur Faruskiar une seconde fois.
Le seigneur Faruskiar ne vient pas à l’appel.
Popof pénètre dans le wagon où se tenait habituellement ce personnage…
Le wagon est vide.
Vide?… Non. Sir Francis Trevellyan est tranquillement assis à sa place, absolument étranger à ce qui se passe. Est-ce que cela le regarde, ce gentleman? Et ne doit-il pas se dire que sur ces railways russo-chinois, c’est bien le comble de l’incurie et du désordre!… Une aiguille ouverte, on ne sait par qui!… Un train prenant une fausse voie!… Quelle administration aussi ridicule que moscovite!
«Eh bien! dit alors le major Noltitz, le malfaiteur qui a lancé le train sur l’embranchement de Nanking, celui qui a voulu le précipiter au fond de la vallée de Tjou pour s’emparer du trésor impérial, c’est Faruskiar!
– Faruskiar!» s’écrient les voyageurs.
Et la plupart refusent d’ajouter foi à l’accusation formulée par le major Noltitz.
«Comment, dit Popof, ce serait cet administrateur de la Compagnie, qui s’est si courageusement conduit pendant l’attaque des bandits, qui a tué de sa main Ki-Tsang, leur chef…»
J’entre en scène alors.
«Le major ne se trompe pas, dis-je. C’est ce Faruskiar qui a préparé ce joli coup!»
Et, au milieu de la stupéfaction générale, je raconte ce que je sais, ce que le hasard venait de m’apprendre. Je dis comment j’ai surpris le plan de Faruskiar et des Mongols, alors qu’il était trop tard pour en empêcher l’exécution, et je ne tais que ce qui concerne l’intervention de Kinko. Lorsque le moment sera venu, je saurai lui faire rendre justice.
A mes paroles succède un concert de malédictions et de menaces. Quoi! ce seigneur Faruskiar… ce superbe Mongol… ce fonctionnaire que nous avons vu à l’œuvre!… Non!… c’est impossible…
Mais il faut se rendre à l’évidence… J’ai vu… j’ai entendu… j’affirme que Faruskiar est l’auteur de cette catastrophe où tout notre train devait périr, qu’il est bien le plus affreux bandit qui ait jamais opéré en Asie centrale!
«Vous le voyez, monsieur Bombarnac, mes premiers soupçons ne m’avaient pas trompé, me dit à part le major Noltitz.
– Il n’est que trop vrai, ai-je répondu, et je conviens, sans fausse honte, que je me suis laissé prendre aux grandes manières de cet abominable coquin!
– Monsieur Claudius, ajoute M. Caterna, qui vient de nous rejoindre, mettez cela dans un roman, et vous verrez si l’on ne crie pas à l’invraisemblance!»
M. Caterna a raison, mais si invraisemblable que cela soit, cela est. Et, en outre, pour tous excepté pour moi qui suis dans le secret de Kinko, il y a lieu de regarder comme un miracle que la locomotive ait été arrêtée sur le bord de l’abîme par cette explosion providentielle.
Maintenant que tout danger a disparu, il s’agit de prendre immédiatement des mesures afin de ramener les wagons du train sur la ligne de Pékin.
«Le plus simple, dit Popof, c’est que quelques-uns de nous se dévouent…
– De ceux-là, j’en serai! s’écrie M. Caterna.
– Que faut-il faire? ai-je ajouté.
– Gagner la station la plus rapprochée, reprend Popof, celle de Fuen-Choo, et de là télégraphier à la gare de Taï-Youan d’envoyer une locomotive de secours.
– A quelle distance est cette station de Fuen-Choo? demande Fulk Ephrinell.
– Environ à six kilomètres de l’embranchement de Nanking, répond Popof, et la gare de Fuen-Choo se trouve à cinq kilomètres au-delà.
– Onze kilomètres, reprend le major, c’est l’affaire d’une heure et demie pour de bons marcheurs. Avant trois heures, la machine expédiée de Taï-Youan peut avoir rejoint le train en détresse. Je suis prêt à partir…
– Moi aussi, dit Popof, et je pense que nous ferons bien d’être en nombre. Qui sait si nous ne rencontrerons pas en route Faruskiar et ses Mongols?
– Vous avez raison, Popof, répond le major Noltitz, et, de plus, soyons bien armés.»
Ce n’est que prudent, car les bandits, qui ont dû se diriger vers le viaduc de Tjou, ne doivent pas être éloignés. Il est vrai, dès qu’ils auront reconnu que leur coup est manqué, ils se hâteront de déguerpir. Comment oseraient-ils – à six – attaquer une centaine de voyageurs, sans compter les soldats chinois préposés à la garde du trésor impérial.
Une douzaine de nous, dont M. Caterna, Pan-Chao et moi, offrent d’accompagner le major Noltitz. Mais, d’un commun accord, nous conseillons à Popof de ne pas abandonner le train, en lui assurant que nous ferons le nécessaire à Fuen-Choo.
Donc, armés de poignards et de revolvers, – il est une heure et demie du matin – nous suivons la voie qui remonte vers la bifurcation des deux lignes, marchant aussi rapidement que le permet cette nuit très obscure.
En moins de deux heures, nous arrivons à la station de Fuen-Choo, n’ayant fait aucune mauvaise rencontre. Évidemment Faruskiar aura rebroussé chemin. Ce sera donc à la police chinoise de s’emparer de ce bandit et de ses complices. Y parviendra-t-elle?… Je le souhaite sans trop l’espérer.
A la station, Pan-Chao s’abouche avec le chef de gare, lequel fait demander par le télégraphe qu’une locomotive soit immédiatement envoyée de Taï-Youan à l’embranchement de Nanking.
Il est trois heures, le jour commence à poindre, et nous revenons attendre la locomotive à la bifurcation. Trois quarts d’heure après, de lointains sifflements l’annoncent, et elle vient stopper au raccordement des deux lignes.
Dès que nous sommes entassés dans le tender, la locomotive s’engage sur l’embranchement, et, une demi-heure plus tard, nous avions rejoint le train.
L’aube est assez faite alors pour permettre aux regards d’embrasser un large rayon. Sans en rien dire à personne, je me mets à la recherche du corps de mon pauvre Kinko, et je n’en retrouve même pas les débris!
Comme la locomotive ne peut se placer en tête du train, puisqu’il n’existe en cet endroit ni double voie ni plaque tournante, il est décidé qu’elle marchera en arrière, en nous remorquant jusqu’à la bifurcation, après avoir abandonné le tender et la machine qui sont hors d’usage. Il en résultera que le fourgon dans lequel est placée la caisse, hélas! vide, de l’infortuné Roumain, se trouvera en queue de notre train.
On part, et, en une demi-heure, nous atteignons l’aiguille de la grande ligne de Pékin.
Très heureusement, il n’a pas été nécessaire de revenir à Taï-Youan, ce qui nous a épargné une heure et demie de retard. Avant de franchir l’aiguille, la locomotive est venue se mettre en direction sur Fuen-Choo; puis, les wagons ont été poussés un à un au delà de la bifurcation, et le train s’est reformé dans les conditions normales. Dès cinq heures, nous courions avec la vitesse réglementaire à travers la province de Petchili.
Je n’ai rien à dire de cette dernière journée de voyage, pendant laquelle notre mécanicien chinois n’a point cherché à regagner le temps perdu, je lui rends cette justice. Mais, si quelques heures de plus ou de moins nous importent peu, il n’en est pas de même du baron Weissschnitzerdörfer, qui doit prendre à Tien-Tsin le paquebot de Yokohama.
En effet, quand nous sommes arrivés vers midi, le paquebot était parti depuis trois quarts d’heure, et dès que le «globe-trotter» allemand, le rival des Bly et des Bisland, s’est précipité sur le quai de la gare, c’a été pour apprendre que ledit paquebot sortait en ce moment des bouches du Peï-Ho et prenait la pleine mer.
Infortuné voyageur! Qu’on ne s’étonne donc point si notre train essuyé une formidable bordée de jurons teutoniques que le baron lance «de tribord et de bâbord», eût dit M. Caterna. Et, franchement, il a bien le droit de pester dans sa langue maternelle!
Nous ne sommes restés qu’un quart d’heure à Tien-Tsin. Que les lecteurs du XXe Siècle me pardonnent donc si je n’ai pu visiter cette cité de cinq cent mille habitants, la ville chinoise et ses temples, le quartier européen où se concentre le mouvement commercial, les quais du Peï-Ho que des centaines de jonques remontent ou descendent… C’est la faute à Faruskiar, et rien que pour avoir entravé mes fonctions de reporter, il mérite d’être supplicié par le plus fantaisiste des bourreaux de la Chine!
Aucun incident n’a marqué les dernières étapes de notre parcours. Ce qui m’attriste profondément, c’est la pensée que je ne ramène pas Kinko et que sa caisse est vide!… Et lui qui m’avait chargé de l’accompagner chez Mlle Zinca Klork!… Comment apprendrai-je à cette malheureuse jeune fille que son fiancé n’est pas arrivé en gare de Pékin?…
Enfin, tout se termine en ce bas monde, même un voyage de six mille kilomètres sur la ligne du Grand-Transasiatique, et, après un voyage de treize jours, heure pour heure, notre train s’est arrêté aux portes de la capitale du Céleste-Empire.
![]()
![]() ékin, tout le monde descend!» crie Popof. Et M.
ékin, tout le monde descend!» crie Popof. Et M.
Caterna de répondre, avec un grasseyement à la parisienne:
«J’te crois, ma vieille!»
Et tout le monde est descendu.
Il est quatre heures du soir.
Pour des gens fatigués par trois cent douze heures de voyage, ce n’est pas le moment d’aller courir la ville, que dis-je, les quatre villes emboîtées les unes dans les autres. D’ailleurs, j’ai le temps, mon séjour devant se prolonger durant quelques semaines au milieu de cette capitale.
L’essentiel, c’est de trouver un hôtel où l’on puisse loger d’une façon à peu près passable. Renseignements pris, il y a lieu de croire que l’Hôtel des Dix mille Songes, voisin de la gare, nous offrira un bien-être en rapport avec nos habitudes d’Occidentaux.
Quant à Mlle Zinca Klork, je remets au lendemain la visite que j’ai à lui faire. J’arriverai chez elle avant que la caisse ait été expédiée à son domicile, et trop tôt, hélas! puisque ce sera pour lui apprendre la mort de son fiancé.
Le major Noltitz demeurera dans le même hôtel que moi. Je n’ai donc point à prendre congé de lui, ni de M. et Mme Caterna, qui comptent y rester une quinzaine de jours, avant de partir pour Shangaï. Quant à Pan-Chao et au docteur Tio-King, une voiture les attend pour les conduire au yamen habité par la famille du jeune Chinois. Mais nous nous reverrons. Des amis ne se séparent pas sur un simple adieu, et la poignée de main que je lui donne à la descente du wagon ne sera pas la dernière.
M. et Mrs. Ephrinell ne vont pas tarder à quitter la gare afin d’aller à leurs affaires, qui les obligent à chercher un hôtel dans le quartier commerçant de l’enceinte chinoise. Ils ne s’en iront pas, du moins, sans avoir reçu nos compliments. Aussi le major Noltitz et moi rejoignons-nous cet aimable couple, et les politesses d’usage sont réciproquement échangées.
«Enfin, dis-je à Fulk Ephrinell, les quarante-deux colis de la maison Strong Bulbul and Co, sont parvenus à bon port! Mais il s’en est fallu de peu que l’explosion de notre locomotive ne vous ait cassé vos dents artificielles…
– Comme vous dites, monsieur Bombarnac, répond l’Américain, et mes dents l’ont échappé belle. Que d’aventures depuis notre départ de Tiflis!… Décidément, ce voyage a été moins monotone que je l’imaginais…
– Et puis, ajoute le major, vous vous êtes marié en route… si je ne me trompe!
– Wait a bit! réplique le Yankee d’un ton bizarre. Pardon… nous sommes pressés…
– Nous ne voulons pas vous retenir, monsieur Ephrinell, ai-je répondu, et à mistress Ephrinell comme à vous, vous nous permettrez de dire au revoir…
– Au revoir», répond cette Anglaise américanisée, plus sèche encore à l’arrivée qu’elle n’était au départ.
Puis, se retournant:
«Je n’ai pas le loisir d’attendre, monsieur Ephrinell…
– Ni moi, mistress», répond le Yankee.
Monsieur… mistress!… Allons! on ne s’appelle déjà plus Fulk et Horatia!
Et alors, sans que l’un ait offert le bras à l’autre, tous deux franchissent la porte de sortie… J’ai comme une idée que le courtier a dû prendre à droite, tandis que la courtière prenait à gauche. Après tout, c’est leur affaire.
Restait mon numéro 8, sir Francis Trevellyan, le personnage muet, qui n’a pas dit un seul mot de toute la pièce, – je veux dire de tout le voyage. Je voudrais pourtant bien entendre le son de sa voix, ne fût-ce qu’une seconde.
Eh! si je ne me trompe, il me semble que cette occasion va se présenter ici même.
En effet, le flegmatique gentleman est là, promenant son regard dédaigneux sur les wagons. Il vient de tirer un cigare de son étui en maroquin jaune. Mais, lorsqu’il secoue sa boîte d’allumettes, il s’aperçoit qu’elle est vide.
Précisément, mon cigare, – un excellent londrès de choix, – est allumé, et je le fume avec la satisfaction béate d’un amateur, et aussi le regret d’un homme qui n’en trouvera pas de pareil dans toute la Chine.
Sir Francis Trevellyan a vu la lueur qui brille au bout de mon cigare, et il s’avance vers moi.
Je pense qu’il va me demander du feu, ou plutôt «de la lumière», comme disent les Anglais, et j’attends le some light traditionnel.
Le gentleman se borne à tendre sa main, et, machinalement, je lui présente mon cigare.
Il le prend alors entre le pouce et l’index, il en fait tomber la cendre blanche, il y allume le sien, et alors je m’imagine que si je n’ai point entendu le some light, je vais entendre le thank you, sir!
Point! Dès qu’il a humé quelques bouffées de son cigare, sir Francis Trevellyan jette nonchalamment le mien sur le quai. Puis, sans saluer, prenant sa gauche en véritable Londonien, il s’en va d’un pas mesuré, et quitte la gare.
Comment, vous n’avez rien dit?… Non! Je suis demeuré stupide… Il ne m’est venu ni une parole ni un geste… J’ai été complètement interloqué devant cette impolitesse ultra-britannique, tandis que le major Noltitz n’a pu retenir un franc éclat de rire.
Ah! si je le retrouve, ce gentleman… Mais jamais plus je n’ai revu sir Francis Trevellyan de Trevellyan-Hall, Trevellyanshire!
Une demi-heure après, nous sommes installés à l’Hôtel des Dix mille Songes. Là, on nous sert un dîner confectionné suivant les règles de l’invraisemblable cuisine céleste. Le repas terminé, dès la deuxième veille – pour employer le langage chinois – couchés dans des lits trop étroits au milieu de chambres peu confortables, nous nous endormons, non du sommeil du juste, mais du sommeil des éreintés, – qui le vaut bien.
Je ne me suis pas réveillé avant dix heures, et peut-être aurais-je dormi toute la matinée, si la pensée ne m’était revenue que j’avais un devoir à remplir. Et quel devoir! Me rendre à l’Avenue Cha-Coua, avant que livraison de la funeste caisse ait été faite à sa destinataire, Mlle Zinca Klork.
Je me lève donc. Ah! si Kinko n’avait pas succombé, je serais retourné à la gare… j’aurais assisté, comme je le lui avais promis au déchargement du colis précieux… j’aurais veillé à ce qu’il fût arrimé comme il fallait sur le camion… je l’aurais accompagné jusqu’à l’avenue Cha-Coua… j’eusse même aidé à le transporter dans la chambre de Mlle Zinca Klork!… Et quelle double explosion de joie, lorsque le fiancé se serait élancé à travers le panneau pour tomber dans les bras de la jolie Roumaine…
Mais non! Et lorsque cette caisse arrivera, elle sera vide, – vide comme un cœur dont tout le sang s’est échappé!
Je quitte l’Hôtel des Dix milles Songes vers onze heures, j’avise une de ces voitures chinoises qui ressemblent à des palanquins à roues, je donne l’adresse de Mlle Zinca Klork, et me voici en route.
On le sait, parmi les dix-huit provinces de la Chine, la province de Petchili est celle qui occupe la position la plus septentrionale. Formée de neuf départements, elle a pour capitale Pékin, autrement dit Chim-Kin-Fo, appellation qui signifie «ville du premier ordre obéissant au ciel».
Je ne sais si cette capitale obéit réellement au ciel, mais elle obéit aux lois de la géométrie rectiligne. Il y a quatre villes, carrées ou rectangulaires, l’une dans l’autre: la ville chinoise qui contient la ville tartare, laquelle contient la ville jaune ou Houng-Tching, laquelle contient la Ville-Rouge ou Tsen-Kai-Tching, c’est-à-dire «la ville interdite». Et, dans cette enceinte symétrique de six lieues, l’on compte plus de deux millions de ces habitants, Tartares ou Chinois, qu’on a appelés «les Germains de l’Orient», sans parler de quelques milliers de Mongols et de Tibétains.
Qu’il y ait un nombreux va-et-vient de passants à travers les rues, je m’en aperçois aux obstacles que ma voiture rencontre à chaque pas, des marchands ambulants, des charrettes pesamment chargées, des mandarins et leur suite bruyante. Et je ne parle pas de ces abominables chiens errants, moitié chacals, moitié loups, pelés et galeux, à l’œil faux, aux crocs menaçants, n’ayant d’autre nourriture que d’immondes détritus, et qui détestent les étrangers. Heureusement, je ne suis point à pied, je n’ai affaire ni dans la Ville-Rouge, où il est défendu de pénétrer, ni dans la ville jaune, ni même dans la ville tartare.
La ville chinoise forme un parallélogramme rectangle, divisé du nord au sud par la Grande-Avenue, allant de la porte Houng-Ting à la porte Tien, et traversée de l’est à l’ouest par l’avenue Cha-Coua, qui va de la porte de ce nom à la porte Couan-Tsa. Avec cette indication, rien de plus facile que de trouver la demeure de Mlle Zinca Klork, mais rien de moins commode que de se diriger, étant donné l’encombrement des rues de cette première enceinte.
Enfin, un peu avant midi, j’arrive à destination. La voiture s’arrête devant une maison de modeste apparence, qui est occupée par des artisans en chambre, et ainsi que l’indique l’enseigne, plus particulièrement par des étrangers.
C’est au premier étage, dont la fenêtre s’ouvre sur l’avenue, que loge la jeune Roumaine, laquelle, on ne l’a point oublié, après avoir appris son métier de modiste à Paris, est venue exercer à Pékin et possède déjà une certaine clientèle.
Je monte à ce premier étage. Je lis le nom de Mlle Zinca Klork sur une porte. Je frappe. On m’ouvre.
Me voici en présence d’une jeune fille tout à fait charmante, comme le disait Kinko. C’est une blonde de vingt-deux à vingt-trois ans, avec les yeux noirs du type roumain, une taille agréable, une physionomie gracieuse et souriante. En effet, n’a-t-elle pas été informée que le train du Grand-Transasiatique est en gare depuis la veille au soir en dépit des péripéties du voyage, et n’attend-elle pas son fiancé d’un instant à l’autre?
Et moi, d’un mot, je vais éteindre cette joie, je vais souffler sur ce sourire…
Mile Zinca Klork est très surprise de voir un étranger apparaître au seuil de sa porte. Comme elle a vécu plusieurs années en France, elle n’hésite pas à me reconnaître pour un Français, et demande ce qui lui procure l’avantage de me voir.
Il faut que je prenne garde à mes paroles, car je risquerais de la tuer, la pauvre enfant!
«Mademoiselle Zinca… dis-je.
– Vous savez mon nom?… s’écrie-t-elle.
– Oui, mademoiselle… Je suis arrivé hier par le train du Grand-Transasiatique…»
La jeune fille pâlit, ses jolis yeux se troublent. Il est évident qu’elle a lieu de craindre… Kinko a-t-il été surpris dans sa caisse, la fraude a-t-elle été découverte… est-il arrêté… est-il en prison?…
Je me hâte d’ajouter:
«Mademoiselle Zinca… certaines circonstances… m’ont mis au courant… du voyage d’un jeune Roumain…
– Kinko… mon pauvre Kinko… on l’a trouvé?… répond-elle d’une voix tremblante.
– Non… non… dis-je en hésitant. Personne n’a su, si ce n’est moi… Et je lui ai rendu souvent visite dans le fourgon… la nuit… Nous sommes devenus deux compagnons… deux amis… Je lui portais quelques provisions…
– Oh! merci, monsieur! dit Mlle Zinca Klork en me prenant les mains. Avec un Français, Kinko était sûr de n’être point trahi, et même de recevoir assistance!… Merci… merci!»
Je me sens de plus en plus effrayé de ce que j’ai la mission d’apprendre à cette jeune fille.
«Et personne n’a jamais soupçonné la présence de mon cher Kinko?… me demande-t-elle.
– Personne.
– Que voulez-vous, monsieur, nous ne sommes pas riches… Kinko était sans argent… là-bas… à Tiflis… et je n’en avais pas encore assez pour lui envoyer le prix du voyage… Mais enfin le voici… il se procurera du travail, car c’est un bon ouvrier, et dès que nous pourrons rembourser la Compagnie…
– Oui… je sais… je sais…
– Et puis, nous allons nous marier, monsieur… Il m’aime tant, et je le lui rends bien!… C’est à Paris que nous avons fait connaissance, – deux pays comme vous dites là-bas… Il était si obligeant pour moi!… Alors, quand il a été de retour à Tiflis, je l’ai tant prié de venir qu’il a imaginé de s’enfermer dans une caisse… Le pauvre garçon, devait-il être mal!…
– Mais non, mademoiselle Zinca… mais non…
– Ah! que je serai heureuse de payer le port de mon cher Kinko…
– Oui… payer le port…
– Cela ne peut tarder maintenant?…
– Non… et dans l’après-midi… sans doute…»
Je ne sais plus que répondre.
«Monsieur, me dit Zinca Klork, nous devons nous marier, Kinko et moi, dès que les formalités seront remplies, et, si ce n’est pas abuser de votre complaisance, vous nous feriez plaisir et honneur en assistant à notre mariage.
– A votre mariage… assurément. Je l’ai promis à mon ami Kinko…»
Pauvre fille!… je ne puis la laisser dans cette situation. Il faut tout dire… tout.
«Mademoiselle Zinca… Kinko…
– C’est lui, monsieur, qui vous a prié de me prévenir de son arrivée?…
– Oui… mademoiselle Zinca! Mais… vous comprenez… Kinko est… assez fatigué… après un si long parcours…
– Fatigué?…
– Oh! ne vous effrayez pas!
– Est-ce qu’il serait malade?…
– Oui… un peu… malade…
– Alors, je vais… Il faut que je le vois… Monsieur, je vous en supplie, accompagnez-moi à la gare…
– Non! ce serait une imprudence, mademoiselle Zinca!… Restez ici… restez!»
Zinca Klork me regarde fixement.
«La vérité, monsieur, la vérité! dit-elle. Ne me cachez rien… Kinko…
– Oui… j’ai une triste nouvelle… à vous communiquer…»
Zinca Klork est défaillante… Ses lèvres tremblent… A peine peut-elle parler…
«Il a été découvert!… dit-elle. Sa fraude est connue!… On l’a arrêté…
– Plût au ciel qu’il n’en fût que cela!… Mademoiselle… nous avons eu des accidents… en route… Le train a failli périr… Une épouvantable catastrophe…
– Il est mort!… Kinko est mort!»
La malheureuse Zinca tombe sur une chaise, et – pour employer la phraséologie imagée des Célestes – «ses larmes coulent comme la pluie par une nuit d’automne». Jamais je n’ai rien vu de si lamentable! Mais il ne faut pas la laisser en cet état, la pauvre fille!… Elle va perdre connaissance… Je ne sais où j’en suis… Je lui prends les mains… Je répète:
«Mademoiselle Zinca… mademoiselle Zinca…»
En ce moment, un gros tumulte se produit devant la maison. Des cris se font entendre, un brouhaha de foule les accompagne, et, au milieu de ce tumulte, une voix…
Grand Dieu… je ne me trompe pas!… c’est la voix de Kinko!… Je l’ai reconnue!… Suis-je dans mon bon sens?…
Zinca Klork, qui s’est relevée, se précipite vers la fenêtre, elle l’ouvre et nous regardons tous les deux…
Un camion est arrêté au seuil de la porte. La caisse, avec ses multiples inscriptions: Haut, Bas, Fragile, Glaces, Craint l’humidité, est là… à demi brisée. Le camion venait d’être heurté par une charrette à l’instant où on déchargeait la caisse… Elle a glissé à terre… elle s’est défoncée… et Kinko a jailli comme un diable d’une boîte à surprise… mais vivant, bien vivant!…
Je ne puis en croire mes yeux!… Comment, mon jeune Roumain n’a pas péri dans l’explosion?… Non! Ainsi que je vais bientôt l’apprendre de sa bouche, ayant été jeté sur la voie à l’instant où la chaudière éclatait, il est d’abord resté inerte; puis, sentant qu’il n’était pas blessé, – un vrai miracle! – il s’est tenu à l’écart jusqu’au moment où il a pu rentrer dans le fourgon sans être aperçu. Quant à moi, j’en étais déjà sorti, et, après l’y avoir inutilement cherché, je ne pouvais douter qu’il eût été la première victime de la catastrophe.
Donc, ô ironie du sort! – avoir accompli un parcours de six mille kilomètres sur le railway du Grand-Transasiatique, enfermé dans une boîte parmi les bagages, avoir échappé à tant de dangers, attaque de bandits, explosion de machine, et voici qu’un accident bête, le choc d’une charrette au milieu d’une rue de Pékin, fait perdre en un instant à Kinko tout le bénéfice de son voyage… frauduleux, soit! mais vraiment si… Je ne trouve pas d’épithète digne de qualifier ce tour de force.
Le camionneur a poussé des cris à la vue de l’être vivant qui venait d’apparaître. En un instant, la foule s’est amassée, la fraude est découverte, les agents de police arrivent… Et que voulez-vous que fasse ce jeune Roumain qui ne sait pas un mot de chinois, et n’a pour s’expliquer que l’insuffisante langue des gestes? Aussi ne parvient-il pas à se faire comprendre, et, d’ailleurs, quelle explication aurait-il pu donner?…
Zinca Klork et moi, nous étions près de lui.
«Ma Zinca… ma chère Zinca! s’écrie-t-il en pressant la jeune fille sur son cœur.
– Mon Kinko… mon cher Kinko! répond-elle, tandis que ses larmes se mêlent aux siennes.
– Monsieur Bombarnac… dit le pauvre garçon, qui n’a plus d’espoir que dans mon intervention.
– Kinko, ai-je répondu, ne vous désolez pas, et comptez sur moi!… Vous êtes vivant, vous que nous croyions mort…
– Eh! je n’en vaux guère mieux!» murmure-t-il.
Erreur! Tout vaut mieux que d’être mort, – même alors qu’on se voit menacé d’aller en prison, fût-ce une prison chinoise. Et c’est bien ce qui a eu lieu, malgré les supplications de la jeune fille auxquelles je joignis les miennes, sans parvenir à me faire comprendre, tandis que Kinko était entraîné par les agents de police à travers les rires et les huées de la foule…
Mais je ne l’abandonnerai pas… Non! Dusse-je remuer ciel et terre, je ne l’abandonnerai pas!
![]()
![]() i jamais l’expression «échouer au port» peut être employée au sens le plus précis, c’est évidemment en cette circonstance, et l’on m’excusera de m’en servir. Toutefois, de ce qu’un navire échoue en vue des jetées, il ne faut pas en conclure qu’il est perdu. Que la liberté de Kinko soit compromise, au cas que mon intervention et celle de nos compagnons de voyage seraient inefficaces, d’accord. Il est vivant, et c’est l’essentiel.
i jamais l’expression «échouer au port» peut être employée au sens le plus précis, c’est évidemment en cette circonstance, et l’on m’excusera de m’en servir. Toutefois, de ce qu’un navire échoue en vue des jetées, il ne faut pas en conclure qu’il est perdu. Que la liberté de Kinko soit compromise, au cas que mon intervention et celle de nos compagnons de voyage seraient inefficaces, d’accord. Il est vivant, et c’est l’essentiel.
Du reste, il n’y a pas à différer d’une heure, car si la police laisse à désirer en Chine, du moins est-elle prompte et expéditive. Aussitôt pris, aussitôt pendu, et il ne faut pas que l’on pende Kinko… même au figuré.
J’offre donc mon bras à Mlle Zinca Klork, je la conduis à ma voiture, et nous revenons tous deux rapidement vers l’Hôtel des Dix mille Songes.
Là, je retrouve le major Noltitz, M. et Mme Caterna, et, par le plus heureux hasard, le jeune Pan-Chao, débarrassé du docteur Tio-King, cette fois. Pan-Chao ne demandera pas mieux que de se faire notre interprète vis-à-vis des autorités chinoises.
Et alors, devant l’éplorée Zinca, j’apprends à mes compagnons tout ce qui est relatif à son fiancé, dans quelles conditions a voyagé Kinko, et comment j’ai fait sa connaissance en route. Je leur dis que s’il a fraudé la Compagnie du Transasiatique, c’est grâce à cette fraude qu’il a pu prendre le train à Ouzoun-Ada. Et, s’il ne l’avait pas pris, nous serions actuellement engloutis dans les abîmes de la vallée de Tjou…
Et je précise les faits que je suis seul à connaître: C’est moi qui ai surpris ce bandit de Faruskiar au moment où il allait accomplir son crime, mais c’est Kinko qui, au péril de sa vie, avec un sang-froid et un courage surhumains, a chargé de combustible le foyer de la locomotive, s’est suspendu aux leviers des soupapes, a produit l’arrêt du train en faisant sauter la machine.
Quelle explosion de Oh! de Ah! exclamatifs, lorsque j’ai achevé mon récit, et, dans un élan de reconnaissance un peu cabotine, notre trial de crier:
«Hurrah pour Kinko… Qu’on le décore!»
En attendant que le Fils du Ciel octroie à ce héros un Dragon-Vert quelconque, Mme Caterna prend les mains de Zinca Klork, elle l’attire sur son cœur, elle l’embrasse… elle l’embrasse sans pouvoir retenir ses larmes de dugazon, des premières amoureuses au besoin… Songez donc, un roman d’amour interrompu au chapitre final…
Mais allons au plus pressé, et, comme le crie M. Caterna: «Tout le monde en scène pour le cinq!» – ce cinquième acte, où les drames se dénouent d’habitude.
«Nous ne pouvons laisser condamner ce brave garçon! dit le major Noltitz. Il faut nous rendre chez le directeur du Grand-Transasiatique, et quand il connaîtra les faits, il sera le premier à empêcher les poursuites.
– Sans doute, ai-je dit, car on ne peut nier que Kinko ait sauvé avec le train tous les voyageurs…
– Sans parler du trésor impérial, ajoute M. Caterna, les millions de Sa Majesté!
– Rien de plus vrai, dit Pan-Chao. Par malheur, Kinko est tombé entre les mains de la police, on l’a conduit en prison, et il est bien difficile de sortir d’une prison chinoise!
– Hâtons-nous, ai-je répondu, et courons chez le directeur de la Compagnie.
– Voyons, dit Mme Caterna, est-ce qu’on ne pourrait pas se cotiser pour rembourser le prix de la place?…
– Cette proposition t’honore, Caroline! s’écrie le trial en portant la main à son gousset.
– Messieurs, messieurs, répond Zinca Klork, dont les jolis yeux sont baignés de larmes, sauvez mon fiancé avant qu’il ait été condamné…
– Oui, ma mignonne, réplique Mme Caterna, oui, mon cœur, on le sauvera, votre fiancé, et, s’il faut donner une représentation à son bénéfice…
– Bravo, Caroline, bravo!» s’écrie M. Caterna qui applaudit avec la vigueur d’un sous-chef de claque.
Nous laissons la jeune Roumaine aux caresses aussi exagérées que sincères de l’excellente dugazon. Mme Caterna ne veut plus la quitter, déclarant qu’elle la considère comme sa fille, et qu’elle la défendra avec les entrailles d’une mère. Puis Pan-Chao, le major Noltitz, M. Caterna et moi, nous revenons à la gare, où sont les bureaux du directeur du Grand-Transasiatique.
Le directeur est dans son cabinet, et, sur la demande de Pan-Chao, on nous introduit près de lui.
C’est un Chinois dans toute l’acception du mot, et capable de toutes les chinoiseries administratives, – un fonctionnaire qui fonctionne, je vous prie de le croire, et qui en remontrerait à ses collègues de la vieille Europe.
Pan-Chao lui raconte l’affaire, et, comme il comprend assez couramment le russe, le major et moi nous pouvons prendre part à la discussion.
Oui! il y a eu discussion. Cet invraisemblable Céleste ne craint pas de soutenir que le cas de Kinko est des plus graves… Une fraude entreprise en ces conditions… une fraude qui s’exerce sur un parcours de six mille kilomètres… une fraude qui fait tort d’un millier de francs à la Compagnie du Grand-Transasiatique, à ses actionnaires…
On répond à ce Chinois chinoisant que tout cela est vrai, mais qu’en somme le dommage eût été bien autrement considérable si le fraudeur ne se fût trouvé dans le train, puisqu’il l’avait sauvé au risque de sa vie, et, en même temps que le matériel, l’existence des voyageurs…
Eh bien, le croirait-on? Ce magot de porcelaine vivante nous donne à entendre qu’à un certain point de vue, mieux eût valu avoir à regretter la mort d’une centaine de victimes…
Oui! nous connaissons cela! Périssent les colonies et tous les voyageurs d’un train plutôt qu’un principe!
Bref, nous n’avons rien pu obtenir. La justice suivra son cours contre le fraudeur Kinko.
Nous nous sommes retirés, pendant que M. Caterna déversait toutes les locutions de son vocabulaire de marine et de coulisses sur cet imbécile.
Que faire?
«Messieurs, nous dit Pan-Chao, je sais comment les choses se passent à Pékin et dans le Céleste-Empire. Il ne s’écoulera pas deux heures entre le moment où Kinko a été arrêté et le moment où il sera traduit devant le juge d’arrondissement, chargé de connaître de ces sortes de délits. Il y va pour lui non seulement de la prison, mais de la bastonnade…
– La bastonnade… comme à cet idiot de Zizel de Si j’étais Roi? s’écrie notre trial.
– Précisément, répond Pan-Chao.
– Il faut empêcher cette abomination… dit le major Noltitz.
– Il faut l’essayer du moins, répond Pan-Chao. Aussi je vous propose d’aller devant le tribunal, où j’essaierai de défendre le fiancé de la charmante Roumaine, et que je perde la face,1 si je ne le tire pas de là à son honneur!»
C’est le meilleur, c’est même le seul parti à prendre. Nous sortons de la gare, nous envahissons une voiture, et nous arrivons en vingt minutes devant la bicoque d’assez minable apparence, où fonctionne le tribunal d’arrondissement.
Il y a foule. L’affaire s’est ébruitée. On sait qu’un fraudeur s’est fait expédier en caisse dans un fourgon du Grand-Transasiatique, et qu’il a fait le voyage gratis de Tiflis à Pékin. Chacun veut le voir, chacun veut connaître les traits de cet original… On ne sait pas encore que c’est tout simplement un héros!
Il est là, notre brave compagnon, il est là entre deux agents à figure rébarbative, jaunes comme des coings. Ces dogues sont prêts à reconduire le prisonnier en prison sur l’ordre du juge, et à lui appliquer quelques douzaines de coups de rotin sous la plante des pieds, s’il est condamné à ce surcroît de peine.
Kinko est tout déconfit, tout honteux, – ce qui m’étonne de la part d’un garçon que je sais si énergique. Mais, dès qu’il nous aperçoit, sa physionomie s’éclaire d’un rayon d’espoir.
En ce moment, le camionneur, appuyé par le témoignage des agents, racontait l’affaire à une sorte de bonhomme à lunettes, qui hochait la tête d’une façon peu rassurante pour l’inculpé, – lequel, d’ailleurs, quand même il eût été aussi innocent que l’enfant qui va naître, n’aurait jamais pu se défendre, puisqu’il ne savait pas un mot de chinois.
C’est alors que Pan-Chao se présente. Le juge le connaît, il lui sourit.
En effet, notre compagnon est le fils d’un riche marchand de Pékin, fournisseur attitré des débits de thé de Toung-Tien et de Soung-Foug-Cao. Aussi les hochements de tête du juge prennent-ils une signification plus sympathique.
Il est vraiment pathétique et spirituel, notre jeune avocat! Il intéresse le juge, il émeut l’auditoire par le récit de ce voyage, il en raconte les péripéties, il fait l’offre de rembourser à la Compagnie ce qui lui est dû…
Malheureusement, le juge ne peut y consentir… Il y a eu un dommage matériel, avec un dommage moral, etc., etc.
Là-dessus, Pan-Chao s’anime, et, bien que nous ne comprenions rien à son discours, nous devinons qu’il parle du courage de Kinko, du sacrifice qu’il a fait de sa vie pour le salut des voyageurs, et enfin, comme suprême argument, il plaide que son client a sauvé le trésor impérial.
Éloquence inutile! En effet, les arguments sont sans force devant ce magistrat impitoyable, qui n’a pas absous dix accusés pendant le cours de sa longue carrière. Il veut bien épargner la bastonnade au délinquant, mais il lui applique six mois de prison avec dommages-intérêts envers la Compagnie du Grand-Transasiatique. Puis, à un signe de cette machine à condamner, on emmène le pauvre Kinko.
Que les lecteurs du XXe Siècle ne s’apitoyent pas sur le sort de Kinko! Dusse-je y perdre cent lignes de reportage, j’aime mieux dire dès à présent que tout s’est arrangé.
Le lendemain, Kinko fait une entrée triomphante dans la maison de l’avenue Cha-Coua, où nous étions réunis, tandis que Mme Caterna prodiguait ses consolations maternelles à la malheureuse Zinca Klork.
Les journaux s’étaient emparés de l’affaire. Le Chi-Bao de Pékin et le Chinese-Times de Tien-Tsin avaient réclamé la grâce du jeune Roumain. Ces cris de miséricorde étaient arrivés aux pieds du Fils du Ciel, – à l’endroit même où sont placées ses impériales oreilles. D’ailleurs, Pan-Chao a fait parvenir à Sa Majesté une supplique relatant les incidents du voyage en insistant sur ce point que, sans le dévouement de Kinko, l’or et les pierres précieuses du trésor seraient au pouvoir de Faruskiar et de ses bandits. Et, par Bouddha! cela valait autre chose que six mois de prison!
Oui! Cela valait quinze mille taels, c’est-à-dire plus de cent mille francs, et, dans un accès de générosité, le Fils du Ciel venait de les envoyer à Kinko avec la remise de sa peine.
Je renonce à dépeindre la joie, le bonheur, l’ivresse, que cette nouvelle, apportée par Kinko en personne, cause à tous ses amis, et en particulier à la jolie Zinca Klork. Ces choses-là ne sauraient s’exprimer en aucune langue, – même en langue chinoise, bien que celle-là se prête si généreusement aux plus invraisemblables métaphores.
Et maintenant, que les abonnés du XXe Siècle me permettent d’en finir avec les compagnons de voyage dont les numéros ont figuré sur mon carnet de reporter.
Numéros 1 et 2, Fulk Ephrinell et miss Horatia Bluett: n’ayant pu s’entendre sur les divers tantièmes stipulés dans leur association matrimoniale, ils ont divorcé trois jours après leur arrivée à Pékin. C’est comme si le mariage n’eût jamais été célébré sur le parcours du Grand-Transasiatique, et miss Horatia Bluett est restée miss Horatia Bluett. Dieu fasse la grâce à la sèche courtière de récolter des cargaisons de cheveux sur les têtes chinoises, et au pratique courtier de meubler de ses dents artificielles tous les «palais» du Céleste-Empire!
Numéro 3, le major Noltitz: Il s’occupe des travaux de l’hospice qu’il est venu fonder à Pékin pour le compte du gouvernement russe, et, lorsque l’heure de la séparation a sonné, j’ai senti que je laissais un véritable ami en ces contrées lointaines.
Numéros 4 et 5, M. et Mme Caterna: Au bout de trois semaines de séjour dans la capitale du Céleste-Empire, le sympathique trial et la charmante dugazon sont partis pour Shangaï, où ils font actuellement les délices de la résidence française.
Numéro 6, le baron Weissschnitzerdörfer, dont j’écris pour la dernière fois le nom incommensurable: Eh bien, non seulement ce globe-trotter a manqué le paquebot à Tien-Tsin, mais, un mois plus tard, il a manqué le paquebot à Yokohama; puis, six semaines après, il a fait naufrage près du littoral de la Colombie anglaise; enfin, par suite d’un déraillement sur la ligne de San-Francisco à New-York, ce n’est pas sans peine qu’il est parvenu à achever son tour du monde… en cent quatre-vingt-sept jours au lieu de trente-neuf.
Numéros 9 et 10, Pan-Chao et le docteur Tio-King: Que vous dirai-je, si ce n’est que Pan-Chao est toujours le Parisien que vous connaissez, et, toutes les fois qu’il vient en France, un dîner nous réunit chez Durand ou chez Marguery. Quant au docteur, il en est arrivé à ne plus manger qu’un jaune d’œuf par jour, comme son maître Cornaro, et il espère vivre jusqu’à cent deux ans à l’exemple du noble Vénitien.
Numéro 8, sir Francis Trevellyan, et numéro 12, le seigneur Faruskiar: Je n’ai jamais revu l’un, qui me doit une réparation et un cigare, ni jamais entendu dire qu’on ait pendu l’autre. Sans doute, l’illustre bandit, ayant donné sa démission d’administrateur du Grand-Transasiatique, continue sa fructueuse carrière au sein des provinces mongoles.
C’est enfin Kinko, mon numéro 11: Je n’ai pas besoin de vous dire que mon numéro 11 a épousé Mlle Zinca Klork en grande cérémonie. Nous avons tous assisté à leur mariage, et, si le Fils du Ciel a richement doté le jeune Roumain, la jeune Roumaine a reçu un magnifique cadeau au nom des voyageurs du train sauvé par son fiancé.
Voilà le récit fidèle de ce voyage. J’ai fait de mon mieux pour remplir mes devoirs de reporter tout le long de la route, et puisse la direction du XXe Siècle se déclarer satisfaite, malgré les impairs et les gaffes que l’on sait!
Quant à moi, après trois semaines passées à Pékin, je suis revenu en France par la voie de mer.
Maintenant, il me reste à faire un aveu pénible pour mon amour-propre: dès le lendemain de mon arrivée dans la capitale du Céleste-Empire, j’avais reçu une dépêche ainsi conçue en réponse à mon télégramme de Lan-Tchéou:
«Claudius Bombarnac Pékin Chine
«Direction XXe Siècle charge son correspondant Claudius Bombarnac de présenter compliments et hommages à héroïque seigneur Faruskiar.»
Mais j’ai toujours soutenu que cette dépêche n’était pas parvenue à son destinataire – ce qui lui a épargné le désagrément d’y répondre.
FIN
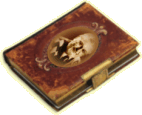
1 Locution chinoise qui veut dire: être déshonoré.