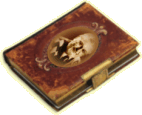Jules Verne
Mistress Branican
(Chapitre XIII-XVI)
83 dessins de L. Benett
12 grandes gravures en chromotypographie
2 grandes cartes en chromolithographie
Bibliothèque D’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
Chez les Indas
![]() a tribu des Indas, composée de plusieurs centaines d’indigènes, hommes, femmes, enfants, occupait à cotte époque les bords de la Fitz-Roy, à cent quarante milles environ de son embouchure. Ces indigènes revenaient des régions de la Terre de Tasman, arrosées par le haut cours de la rivière. Depuis quelques jours, les hasards de leur vie nomade les avaient précisément ramenés à vingt-cinq milles de cette partie du Great-Sandy-Desert, où la caravane venait d’achever sa dernière halte, après un enchaînement de misères [qui dépassaient la limite des forces humaines.
a tribu des Indas, composée de plusieurs centaines d’indigènes, hommes, femmes, enfants, occupait à cotte époque les bords de la Fitz-Roy, à cent quarante milles environ de son embouchure. Ces indigènes revenaient des régions de la Terre de Tasman, arrosées par le haut cours de la rivière. Depuis quelques jours, les hasards de leur vie nomade les avaient précisément ramenés à vingt-cinq milles de cette partie du Great-Sandy-Desert, où la caravane venait d’achever sa dernière halte, après un enchaînement de misères [qui dépassaient la limite des forces humaines.
C’était chez ces Indas que le capitaine John et son second Harry Felton avaient vécu pendant neuf années. A la faveur des événements qui vont suivre, il a été possible de reconstituer leur histoire durant cette longue période, en complétant le récit fait par Harry Felton à son lit de mort.
Entre ces deux années 1875 et 1881, – on ne l’a point oublié, – l’équipage du Franklin avait eu pour refuge une île de l’océan Indien, l’île Browse, située à deux cent cinquante milles environ de York-Sound, le point le plus rapproché de ce littoral qui s’arrondit au nord-ouest du continent australien. Deux des matelots ayant péri pendant la tempête, les naufragés, au nombre de douze, avaient vécu six ans dans cette île, sans aucun moyen de pouvoir se rapatrier, lorsqu’une chaloupe en dérive vint atterrir sur la côte.
Le capitaine John, voulant employer cette chaloupe au salut commun, la fît mettre en état d’atteindre la terre australienne, et l’approvisionna pour une traversée de quelques semaines. Mais cette chaloupe ne pouvant contenir que sept passagers, le capitaine John et Harry Felton s’y embarquèrent avec cinq de leurs compagnons, laissant les cinq autres sur l’île Browse, où ils devaient attendre qu’un navire leur fût expédié. On sait comment ces infortunés succombèrent avant d’avoir été recueillis, et dans quelles conditions le capitaine Ellis retrouva leurs restes, lors de la deuxième campagne du Dolly-Hope en 1883.
Après une traversée périlleuse au milieu de ces détestables parages de l’océan Indien, la chaloupe accosta le continent à la hauteur du cap Lévêque, et parvint à pénétrer dans le golfe même où se jette la rivière Fitz-Roy. Mais la mauvaise fortune voulut que le capitaine John fut attaqué par les indigènes, – attaque pendant laquelle quatre de ses hommes furent tués en se défendant.
Ces indigènes, appartenant à la tribu des Indas, entraînèrent vers l’intérieur le capitaine John, le second Harry Felton et le dernier matelot échappé au massacre. Ce matelot, qui avait été blessé, ne devait pas guérir de ses blessures. Quelques semaines plus tard, John Branican et Harry Felton étaient les seuls survivants de la catastrophe du Franklin.
Alors commença pour eux une existence qui, dans les premiers jours, fut sérieusement menacée. On l’a dit, ces Indas, ainsi que toutes les tribus errantes ou sédentaires de l’Australie septentrionale, sont farouches et sanguinaires. Les prisonniers qu’ils font dans leurs guerres incessantes de tribus à tribus, ils les tuent impitoyablement et les dévorent. Il n’existe pas de coutume plus profondément invétérée que le cannibalisme chez ces aborigènes, de véritables bêtes fauves.
Pourquoi le capitaine John et Harry Felton furent-ils épargnés? Cela tint aux circonstances.
On n’ignore pas que, parmi les indigènes de l’intérieur et du littoral, l’état de guerre se perpétue de générations en générations. Les sédentaires s’attaquent de village à village, se détruisent et se repaissent des prisonniers qu’ils ont faits. Mêmes coutumes chez les nomades: ils se poursuivent de campement en campement, et la victoire finit toujours par d’épouvantables scènes d’anthropophagie. Ces massacres amèneront inévitablement la destruction de la race australienne, et aussi sûrement que les procédés anglo-saxons, bien qu’en certaines circonstances, ces procédés aient été d’une barbarie inavouable. Comment qualifier autrement de pareils actes, – les noirs, chassés par les blancs comme un gibier, avec toutes les émotions raffinées que peut procurer ce genre de sport; les incendies propagés largement, afin que les habitants ne soient pas plus épargnés que les «gunyos» d’écorce, qui leur servent de demeures? Les conquérants ont même été jusqu’à se servir de l’empoisonnement cri masse par la strychnine, ce qui permettait d’obtenir une destruction plus rapide. Aussi a-t-on pu citer cette phrase, échappée à la plume d’un colon australien: «Tous les hommes que je rencontre sur mes pâturages, je les tue à coups de fusil, parce que ce sont des tueurs de bétail, toutes les femmes, parce qu’elles mettent au monde des tueurs de bétail, et tous les enfants, parce qu’ils deviendraient des tueurs de bétail!»
On comprend des lors la haine que les Australiens ont vouée à leurs bourreaux, – haine conservée par voie d’atavisme. Il est rare que les blancs qui tombent entre leurs mains ne soient pas massacrés sang merci. Pourquoi donc les naufragés du Franklin avaient-ils été épargnés par les Indas?
Très probablement, s’il ne fût mort peu de temps après avoir été fait prisonnier, le matelot aurait subi le sort commun. Mais le chef de la tribu, un indigène nomme Willi, ayant eu des relations avec les colons du littoral, les connaissait assez pour avoir remarqué que le capitaine John et Harry Felton étaient deux officiers, dont il aurait peut-être à tirer un double parti. En sa qualité de guerrier, Willi pourrait mettre leurs talents à profit dans ses luttes avec les tribus rivales; en sa qualité de négociant, qui s’entendait aux choses du négoce, il entrevoyait une lucrative affaire, c’est-à-dire une belle et bonne rançon, que lui vaudrait la délivrance des deux prisonniers. Ceux-ci eurent donc la vie sauve, mais durent se plier à cette existence des nomades qui leur fut d’autant plus pénible que les Indas les soumettaient à une surveillance incessante. Gardés à vue jour et nuit, ne pouvant s’éloigner des campements, ils avaient vainement tenté deux ou trois fois de s’évader, ce qui avait failli même leur coûter la vie.
Entre temps, lors de ces fréquentes rencontres de tribus à tribus, ils étaient mis en demeure d’intervenir au moins par leurs conseils – conseils réellement précieux, et dont Willi tira grand avantage, puisque la victoire lui fut désormais assurée. Grâce à ses succès, cette tribu était actuellement l’une des plus puissantes de celles qui fréquentent les divers territoires de l’Australie occidentale.
Ces populations du nord-ouest appartiennent vraisemblablement aux races mélangées des Australiens et des indigènes de la Papouasie. A l’exemple de leurs congénères, les Indas portent les cheveux longs et bouclés; leur teint est moins foncé que celui des indigènes des provinces méridionales, qui semblent former une race plus vigoureuse; leur taille, de proportion plus modeste, se tient en moyenne entre un mètre treize et un mètre trente. Les hommes sont physiquement mieux constitués que les femmes; si leur front est un peu fuyant, il domine des arcades sourcilières assez proéminentes, – ce qui est signe d’intelligence, à en croire les ethnologistes; leurs yeux, dont l’iris est foncé, ont la pupille enflammée d’un feu ardent; leurs cheveux, de couleur très brune, ne sont pas crépus comme ceux des nègres africains; toutefois leur crâne est peu volumineux, et la nature n’y a pas généreusement prodigué la matière cérébrale. On les appelle des «noirs», bien qu’ils ne soient point d’un noir de Nubiens: ils sont «chocolatés», s’il est permis de fabriquer ce mot, qui donne exactement la nuance de leur coloration générale.
Le nègre australien est doué d’un odorat extraordinaire, qui rivalise avec celui des meilleurs chiens de chasse. Il reconnaît les traces d’un être humain ou d’un animal rien qu’en humant le sol, en flairant les herbes et les broussailles. Son nerf auditif est également d’une extrême sensibilité, et il peut percevoir, parait-il, le bruit des fourmis qui travaillent au fond d’une fourmilière. Quant à ranger ces indigènes dans l’ordre des grimpeurs, cette classification ne manquerait pas de justesse, car il n’est pas de gommier si haut et si lisse, dont ils ne puissent atteindre la cime en se servant d’un roseau de rotang flexible auquel ils donnent le nom de «kâmin,» et grâce à la conformation légèrement préhensile de leurs orteils.
Ainsi que cela a été noté déjà à propos des indigènes do la Finke river, la femme australienne vieillit vite et n’atteint guère la quarantaine, que les hommes dépassent communément d’une dizaine d’années en certaine partie du Queensland. Ces malheureuses créatures ont pour fonction d’accomplir les plus rudes travaux du ménage: ce sont des esclaves, courbées sous le joug de maîtres d’une impitoyable dureté, contraintes de porter les fardeaux, les ustensiles, les armes, de chercher les racines comestibles, les lézards, les vers, les serpents, qui servent à la subsistance de la tribu. Mais, s’il en est reparlé ici, c’est pour dire qu’elles soignent avec affection leurs enfants, dont les pères se soucient médiocrement, car un enfant est une charge pour sa mère, qui ne peut plus s’adonner exclusivement aux soins de cette existence nomade, dont la responsabilité repose sur elle. Aussi, chez certaines peuplades, a-t-on vu les nègres obliger leurs femmes à se couper les seins, afin de se mettre dans l’impossibilité de nourrir. Et, cependant, – coutume horrible et qui semble en désaccord avec cette précaution prise pour en diminuer le nombre, – ces petits êtres, en temps de disette, sont mangés dans certaines tribus indigènes, où le cannibalisme est encore porté aux derniers excès.
C’est que, chez ces nègres australiens, – à peine dignes d’appartenir à l’humanité, – la vie est concentrée sur vin acte unique. «Ammeri!… Ammeri!» ce mot revient incessamment dans la langue indigène, et il signifie: faim. Le geste le plus fréquent de ces sauvages consiste à se frapper le ventre, car leur ventre n’est que trop souvent vide. Dans ces pays sans gibier et sans culture, on mange à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, lorsque l’occasion se présente, avec cette préoccupation constante d’un jeûne prochain et prolongé. Et, en effet, de quoi peuvent se nourrir ces indigènes – les plus misérables certainement de tous ceux que la nature a dispersés à la surface des continents? D’une sorte de grossière galette, nommée «damper», faite d’un peu de blé sans levain, cuite non pas au four, mais sous des cendres brûlantes, – du miel, qu’ils récoltent parfois, à la condition d’abattre l’arbre au sommet duquel les abeilles ont établi leur ruche, – de ce «kadjerah», espèce de bouillie blanche, obtenue par l’écrasement des fruits du palmier vénéneux, dont le poison a été extrait à la suite d’une délicate manipulation, – de ces oeufs de poules de jungles, enfouis dans le sol et que la chaleur fait éclore artificiellement, – de ces pigeons particuliers à l’Australie, qui suspendent leurs nids à l’extrémité des branches d’arbres. Enfin, ils utilisent encore certaines sortes de larves de coléoptères, les unes recueillies entre la ramure des acacias, les autres déterrées au milieu des pourritures ligneuses, qui encombrent le dessous des fourrés… Et, c’est tout.
Voilà pourquoi, dans cette lutte de chaque heure pour l’existence, le cannibalisme s’explique avec toutes ses horribles monstruosités. Ce n’est pas même l’indice d’une férocité naturelle, ce sont les conséquences d’un besoin impérieux que la nature pousse le noir australien à satisfaire, car il meurt de faim. Aussi, dans ces conditions, que se passe-t-il?
Sur le cours inférieur du Murray et chez les peuples de la région du nord, la coutume est de tuer les enfants pour s’en repaître, et même on coupe aux mères une phalange du doigt à chaque enfant qu’elle est contrainte de livrer à ces festins d’anthropophages. Détail épouvantable: lorsqu’elle n’a plus rien à manger, la mère va jusqu’à dévorer le petit être sorti de ses entrailles, et des voyageurs ont entendu ces malheureuses parler de cette abomination comme de l’acte le plus naturel!
Toutefois, ce n’est pas uniquement la faim qui pousse les Australiens au cannibalisme: ils ont un goût très prononce pour la chair humaine – cette chair qu’ils appellent «talgoro», «la viande qui parle», suivant une de leurs expressions d’un effrayant réalisme. S’ils ne s’abandonnent pas à ce désir entre gens de la même tribu, ils n’en font pas moins la chasse à l’homme. Grâce à ces guerres incessantes, ces expéditions n’ont d’autre but que de se procurer le talgoro, aussi bien celui que l’on mange fraîchement tué que celui qui est mis en réserve. Et, voici ce qu’affirmé le docteur Carl Lumholtz: pendant son audacieux voyage à travers les provinces du nord-est, les noirs de son escorte ne cessaient de traiter cette question de nourriture, disant: «Pour les Australiens, rien ne vaut la chair humaine.» Et encore faut-il que ce ne soit pas la chair des blancs, car ils lui trouvent un arrière-goût de sel fort désagréable.
Il y a d’ailleurs un autre motif qui prédispose ces tribus à s’entre-détruire. Les Australiens sont extraordinairement crédules. Ils s’effraient de la voix du «kvin’gan’,» du mauvais esprit, qui court les campagnes et fréquente les gorges des contrées montagneuses, bien que cette voix ne soit que le chant mélancolique d’un charmant oiseau, l’un des plus curieux de l’ornithologie australienne. Cependant, s’ils admettent l’existence d’un être supérieur et méchant, d’après les voyageurs les plus autorisés, jamais un indigène ne fait une prière et nulle part on ne trouve des vestiges de pratiques religieuses.
En réalité, ils sont très superstitieux, et, comme ils ont cette ferme croyance que leurs ennemis peuvent les faire périr par sortilèges, ils se hâtent de les tuer, – ce qui, joint aux habitudes de cannibalisme, soumet ces contrées à un régime de destruction sans limites.
On notera, en passant, que les Australiens ont le respect des morts. Ils ne les mettent point en contact avec la terre; ils entourent les corps de bandelettes de feuillage ou d’écorce, et les déposent dans des fosses peu profondes, les pieds tournés vers le levant, à moins qu’ils ne les enterrent debout, ainsi que cela se pratique chez certaines tribus. La tombe d’un chef est alors recouverte d’une hutte, dont l’entrée est orientée vers l’est. Il faut aussi ajouter que, parmi les moins sauvages, on relève cette croyance bizarre: c’est que les morts doivent renaître sous la forme d’hommes blancs, et, suivant l’observation de Carl Lumholtz, la langue du pays emploie le même mot pour désigner «l’esprit et l’homme de couleur blanche». Selon une autre superstition indigène, les animaux auraient été antérieurement des créatures humaines – ce qui est de la métempsycose à rebours.
Telles sont ces tribus du continent australien, destinées sans doute à disparaître un jour comme ont disparu les habitants de la Tasmanie. Tels étaient ces Indas, entre les mains desquels étaient tombés John Branican et Harry Felton.
Après la mort du matelot, John Branican et Harry Felton avaient dû suivre les Indas dans leurs pérégrinations continues au milieu des régions du centre et du nord-ouest. Tantôt attaquant les tribus hostiles, tantôt attaqués par elles, ils obtenaient une incontestable supériorité sur leurs ennemis, grâce à ces conseils de leurs prisonniers dont Willi tenait bon compte. Des centaines de milles furent franchis depuis le Golfe du Roi jusqu’au golfe de Van Diemen, entre la vallée de la Fitz-Roy river et la vallée de la Victoria, et jusqu’aux plaines de la Terre Alexandra. C’est ainsi que le capitaine John et son second traversèrent ces contrées inconnues des géographes, restées en blanc sur les cartes modernes, dans l’est de la Terre de Tasman, de la Terre d’Arnheim et des territoires du Great-Sandy-Desert.
Si ces interminables voyages leur paraissaient extrêmement pénibles, les Indas ne s’en préoccupaient même pas. Leur habitude est de vivre ainsi, sans souci des distances ni même du temps, dont ils ont à peine une notion exacte. En effet, sur tel événement qui ne doit s’accomplir que dans cinq ou six mois, par exemple, l’indigène répond de très bonne foi qu’il arrivera dans deux, dans trois jours… ou la semaine prochaine. L’âge qu’il a, il l’ignore; l’heure qu’il est, il ne le sait pas davantage. Il semble que l’Australien soit d’une espèce spéciale dans l’échelle des êtres – comme le sont certains animaux de son pays.
C’est à de telles mœurs que John Branican et Harry Felton furent contraints de se conformer. Ces fatigues, provoquées par des déplacements quotidiens, ils durent les subir. Cette nourriture, si insuffisante quelquefois, si répugnante toujours, ils durent s’en contenter. Et cela, sans parler des épouvantables scènes de cannibalisme dont ils ne purent jamais empêcher les horreurs, après ces batailles où les ennemis étaient tombés par centaines.
En se soumettant ainsi, l’intention bien arrêtée du capitaine John et de Harry Felton était d’endormir la vigilance de la tribu, afin de s’enfuir dès que l’occasion s’en présenterait. Et pourtant, ce qu’une évasion au milieu des déserts du nord-ouest présente de mauvaises chances, on l’a vu en ce qui concerne le second du Franklin. Mais les deux prisonniers étaient surveillés de si près que les occasions de fuir furent extrêmement rares, et c’est à peine si, dans le cours de neuf ans, John et son compagnon purent essayer de les mettre à profit. Une seule fois, – c’était l’année même qui avait précédé l’expédition de Mrs. Branican en Australie, – une seule fois, l’évasion aurait pu réussir. Voici dans quelles circonstances.
A la suite de combats avec des tribus de l’intérieur, les Indas occupaient alors un campement sur les bords de lac Amédée, au sud-ouest de la Terre Alexandra. Il était rare qu’ils se fussent aussi profondément engagés dans le centre du continent. Le capitaine John et Harry Felton, sachant qu’ils n’étaient qu’a trois cents milles de l’Overland-Telegraf-Line, crurent l’occasion favorable et résolurent d’en profiter. Après réflexion, il leur parut convenable de s’évader séparément, quitte à se rejoindre quelques milles au delà du campement. Après avoir déjoué la surveillance des indigènes, Harry Felton heureux pour gagner l’endroit ou il devait attendre son compagnon. Par malheur, John venait d’être mandé près de Willi, qui réclamait ses soins à propos d’une blessure, reçue dans la dernière rencontre. John ne put donc s’éloigner, et Harry Felton l’attendit vainement pendant quelques jours… Alors, dans la pensée que s’il parvenait à gagner une des bourgades de l’intérieur ou du littoral, il pourrait organiser une expédition en vue de délivrer son capitaine. Harry Felton prit la direction du sud-est. Mais ce qu’il eut à supporter de fatigues, de privations, de misères, fut tel que, quatre mois après son départ, il vint tomber mourant sur le bord du Parru, dans le district d’Ulakarara de la Nouvelle-Galles du Sud. Ramené à l’hôpital de Sydney, il y avait langui pendant plusieurs semaines, puis il était mort, après avoir pu dire à Mrs. Branican tout ce qui concernait le capitaine John.
Terrible épreuve pour John de n’avoir plus son compagnon près de lui, et il fallait que son énergie morale fût à la hauteur de son énergie physique pour qu’il ne s’abandonnât pas au désespoir. A qui parlerait-il désormais de ce qui lui était si cher, de son pays, de San-Diégo, des êtres adorés qu’il avait laissés là-bas, de sa courageuse femme, de son fils Wat qui grandissait loin de lui et qu’il ne connaîtrait jamais peut-être, de M. William Andrew, de tous ses amis enfin?… Depuis neuf ans déjà, John était prisonnier des Indas, et combien d’années s’écouleraient, avant que la liberté lui fût rendue? Cependant, il ne perdit pas espoir, étant soutenu par cette pensée que s’il réussissait à gagner une des villes du littoral australien, Harry Felton ferait tout ce qu’il est humainement possible de faire pour délivrer son capitaine…
Pendant les premiers temps de sa captivité, John avait appris à parler la langue indigène, qui, par la logique de sa grammaire, la précision de ses termes, la délicatesse de ses expressions, semble témoigner que l’indigénat australien aurait joui autrefois d’une certaine civilisation. Aussi avait-il souvent entretenu Willi des avantages qu’il aurait à laisser ses prisonniers libres de retourner au Queensland ou dans l’Australie méridionale, d’où ils seraient en mesure de lui faire parvenir telle rançon qu’il exigerait. Mais, de nature très défiante, Willi n’avait rien voulu entendre à ce propos. Si la rançon arrivait, il rendrait la liberté au capitaine John et à son second. Quant à s’en rapporter à leurs promesses, jugeant probablement les autres d’après lui-même, jamais il n’avait voulu y consentir.
Il s’ensuit donc que l’évasion de Harry Felton, qui lui causa une violente irritation, rendit Willi plus sévère encore envers le capitaine John, On lui interdit d’aller et de venir pendant les haltes ou pendant les marches, et il dut subir la garde d’un indigène qui en répondait sur sa tête.
De longs mois s’écoulèrent sans que le prisonnier eût reçu aucune nouvelle de son compagnon. Et n’était-il pas fondé à croire que Harry Felton avait succombé en route? Si le fugitif eut réussi à gagner le Queensland ou la province d’Adélaïde, est-ce qu’il n’aurait pas déjà fait une tentative pour l’arracher aux mains des Indas?
Pendant le premier trimestre de l’année 1891 – c’est-à-dire au commencement de l’été australien – la tribu était revenue vers la vallée de la Fitz-Roy, où Willi passait habituellement la partie la plus chaude de la saison, et dans laquelle il trouvait les ressources nécessaires à sa tribu.
C’est là que les Indas se trouvaient encore dans les premiers jours d’avril, et leur campement occupait un coude de la rivière, à un endroit où venait se jeter un petit affluent, qui descendait des plaines du nord.
Depuis que la tribu était fixée en cet endroit, le capitaine John, n’ignorant pas qu’il devait être assez rapproché du littoral, avait songé à l’atteindre. S’il y parvenait, il ne lui serait peut-être pas impossible de se réfugier dans les établissements situés plus au sud, là où le colonel Warburton avait pu terminer son voyage.
John était décidé à tout risquer pour en finir avec cette odieuse existence, fût-ce par la mort.
Malheureusement, une modification, apportée aux projets des Indas, vint mettre à néant les espérances que le prisonnier avait pu concevoir. En effet, dans la seconde quinzaine d’avril, il fut manifeste que Willi se préparait à partir, afin de reporter son campement d’hiver sur le haut cours du fleuve.
Que s’était-il passé, et à quelles causes fallait-il attribuer ce changement des habitudes de la tribu?
Le capitaine John parvint à le savoir, mais ce ne fut pas sans peine: si la tribu cherchait à remonter le cours d’eau plus à l’est, c’est que la police noire venait d’être signalée sur le cours inférieur de la Fitz-Roy.
On n’a pas oublié ce que Tom Marix avait dit de cette police noire, qui, depuis les révélations fournies par Harry Felton sur le capitaine John, avait reçu ordre de se transporter sur les territoires du nord-ouest.
Cette police, très redoutée des indigènes, déploie un acharnement dont on ne peut se faire idée, quand elle a lieu de les poursuivre. Elle est commandée par un capitaine, appelé «mani», ayant sous ses ordres un sergent, une trentaine d’agents de race blanche et quatre-vingts agents de race noire, montés sur de bons chevaux, armés de fusils, de sabres et de pistolets. Cette institution, connue sous le nom de «native police», suffit à garantir la sécurité des habitants dans les régions qu’elle visite à diverses époques. Impitoyable dans les répressions qu’elle exerce sur les indigènes, si elle est blâmée par les uns au nom de l’humanité, elle est approuvée par les autres au nom de la sécurité publique. Le service qu’elle fait est très actif, et son personnel se transporte avec une rapidité incroyable d’un point du territoire à l’autre. Aussi les tribus nomades redoutent-elles de la rencontrer, et voilà pourquoi Willi, ayant appris qu’elle se trouvait dans le voisinage, se disposait à remonter le cours de la Fitz-Roy.
Mais ce qui était un danger pour les Indas, pouvait être le salut pour le capitaine John. S’il parvenait à rejoindre un détachement de cette police, c’était sa délivrance assurée, son rapatriement certain. Or, pendant la levée du campement, peut-être ne lui serait-il pas impossible de tromper la surveillance des indigènes?
Willi se douta-t-il des projets de son prisonnier, on pourrait le croire, puisque le matin du 20 avril, la porte de la hutte où John était enfermé ne s’ouvrit pas à l’heure habituelle. Un indigène était de garde près de cette hutte. Aux Questions que John adressa, on ne fit aucune réponse. Lorsqu’il demanda à être conduit près de Willi, on refusa d’accéder à sa demande, et le chef ne vint même pas lui rendre visite.
Qu’était-il donc arrivé? Les Indas faisaient-ils en hâte leurs préparatifs pour quitter le campement? C’était probable, et John entendait les allées et venues tumultueuses autour de sa hutte, où Willi s’était contenté de lui envoyer quelques aliments.
Un jour entier s’écoula, puis un autre. Nul changement ne se produisit dans la situation. Le prisonnier était toujours étroitement surveillé. Mais, pendant la nuit du 22 au 23 avril, il put constater que les rumeurs du dehors avaient cessé, et il se demanda si les Indas venaient d’abandonner définitivement le campement de la Fitz-Roy river.
Le lendemain, dès l’aube, la porte de la hutte s’ouvrit brusquement.
Un homme – un blanc – parut devant le capitaine John.
C’était Len Burker.
![]()
Le jeu de Len Burker
![]() l y a avait trente-deux jours – depuis la nuit du 22 au 23 mars – que Len Burker s’était séparé de Mrs. Branican et de ses compagnons. Ce simoun, si fatal à la caravane, lui avait fourni l’occasion d’exécuter ses projets. Entraînant Jane, et suivi des noirs de l’escorte, il avait poussé devant lui les chameaux valides et entre autres ceux qui portaient la rançon du capitaine John.
l y a avait trente-deux jours – depuis la nuit du 22 au 23 mars – que Len Burker s’était séparé de Mrs. Branican et de ses compagnons. Ce simoun, si fatal à la caravane, lui avait fourni l’occasion d’exécuter ses projets. Entraînant Jane, et suivi des noirs de l’escorte, il avait poussé devant lui les chameaux valides et entre autres ceux qui portaient la rançon du capitaine John.
Len Burker se trouvait dans des conditions plus favorables que Dolly pour rejoindre les Indas dans la vallée arrosée par la Fitz-Roy. Déjà, pendant sa vie errante, il avait eu de fréquents rapports avec les Australiens nomades, dont il connaissait la langue et les habitudes. La rançon volée lui assurait bon accueil de Willi. Le capitaine John, une fois délivré, serait en son pouvoir, et, cette fois…
Après avoir abandonné la caravane, Len Burker s’était hâté de prendre la direction du nord-ouest, et au lever du jour, ses compagnons et lui étaient à une distance de plusieurs milles.
Jane voulut alors implorer son mari, le supplier de ne point abandonner Dolly et les siens au milieu de ce désert, lui rappeler que c’était un crime ajouté au crime commis à la naissance de Godfrey, le prier de racheter son abominable conduite en rendant cet enfant à sa mère, en joignant ses efforts à ceux qu’elle faisait pour retrouver le capitaine John…
Jane n’obtint rien. Ce fut en vain. Empêcher Len Burker de marcher à son but, cela n’était au pouvoir de personne. Encore quelques jours, et il l’aurait atteint. Dolly et Godfrey morts de privations et de misères, John Branican disparu, l’héritage d’Edward Starter passerait entre les mains de Jane, c’est-à-dire entre les siennes, et, de ces millions, il saurait faire bon usage!
Il n’y avait rien à attendre de ce misérable. Il imposa silence à sa femme, qui dut se courber sous ses menaces, sachant bien que, s’il n’avait eu besoin d’elle pour entrer en possession de la fortune de Dolly, il l’aurait abandonnée depuis longtemps, et peut-être pis encore. Quant à s’enfuir, à tenter de rejoindre la caravane, comment aurait-t-elle pu y songer? Seule, que serait-elle devenue? D’ailleurs, deux des noirs ne devaient pas la quitter d’un instant.
Il n’y a pas lieu d’insister sur les incidents qui marquèrent le voyage de Len Burker. Ni les bêtes de somme ni les vivres ne lui faisaient défaut. Dans ces conditions, il put fournir de longues étapes en se rapprochant de la Fitz-Roy, avec des gens habitués à cette existence et qui avaient été moins éprouvés que les blancs depuis le départ d’Adélaïde.
En dix-sept jours, à la date du 8 avril, Len Burker eut atteint la rive gauche de la rivière, précisément le jour où Mrs. Branican et ses compagnons tombaient à leur dernière halte.
En cet endroit, Len Burker fit la rencontre de quelques indigènes, et il obtint d’eux des renseignements sur la situation actuelle des Indas. Ayant appris que la tribu avait suivi la vallée plus à l’ouest, il résolut de la redescendre, afin de se mettre en rapport avec Willi.
Le cheminement n’offrait plus aucune difficulté. Pendant ce mois d’avril, dans la province de l’Australie septentrionale, le climat de ces régions est moins excessif, quelque bas qu’elle soit située en latitude. Il était évident que si la caravane de Mrs. Branican avait pu atteindre la Fitz-Roy, elle eût été au terme de ses misères. Quelques jours après, elle serait entrée en communication avec les Indas, car c’est à peine si quatre-vingt-cinq milles séparaient alors John et Dolly l’un de l’autre.
Lorsque Len Burker eut la certitude qu’il n’était plus qu’à deux ou trois journées de marche, il prit le parti de s’arrêter. Emmener Jane avec lui chez les Indas, la mettre en présence du capitaine John, courir le risque d’être dénoncé par elle, cela ne pouvait lui convenir. Par ses ordres, une halte fut organisée sur la rive gauche, et malgré ses supplications, c’est là que la malheureuse femme fut abandonnée à la garde des deux noirs.
Cela fait, Len Burker, suivi de ses compagnons, continua de se diriger vers l’ouest, avec les chameaux de selle et les deux bêtes chargées des objets d’échange.
Ce fut le 20 avril que Len Burker rencontra la tribu, alors que les Indas se montraient si inquiets du voisinage de la police noire, dont la présence avait été signalée à une dizaine de milles en aval. Déjà même Willi se préparait à quitter son campement, afin de chercher refuge dans les hautes régions de cette Terre d’Arnheim, qui appartient à la province de l’Australie septentrionale.
En ce moment, sur les injonctions de Willi, et dans le but de prévenir toute tentative d’évasion de sa part, John était enfermé dans une hutte. Aussi ne devait-il rien apprendre des communications, qui allaient s’établir préalablement entre Len Burker et le chef des Indas.
Ces communications ne donnèrent lieu à aucune difficulté. Antérieurement, Len Burker avait été en rapport avec ces indigènes. Il connaissait leur chef, et n’eut qu’à traiter la question de rachat du capitaine John.
Willi se montra très disposé à rendre son prisonnier contre rançon. L’étalage que lui fit Len Burker des étoffes, des bimbeloteries, et surtout la provision do tabac qui lui était offerte, l’impressionnèrent favorablement. Toutefois, en négociant avisé, il fit valoir qu’il ne se séparerait pas sans regret d’un homme aussi important que le capitaine John qui depuis tant d’années vivait au milieu de la tribu et lui rendait de réels services, etc., etc. D’ailleurs, il savait que le capitaine était Américain, et n’ignorait même pas qu’une expédition avait été formée en vue d’opérer sa délivrance – ce que Len Burker confirma en disant qu’il était précisément le chef de cette expédition. Puis, lorsque celui-ci apprit que Willi s’inquiétait de la présence de la police noire sur le cours inférieur de la Fitz-Roy river, il profita de cette circonstance pour l’engager à traiter sans retard. En effet, dans son intérêt à lui, Burker, il importait que la délivrance du capitaine demeurât secrète, et, en éloignant les Indas, il y avait toute probabilité que ses agissements resteraient ignorés. La disparition définitive de John Branican ne pourrait jamais lui être imputée, si les gens de son escorte se taisaient à cet égard, et il saurait s’assurer leur silence.
Il suit de là que la rançon ayant été acceptée par Willi, ce marché fut terminé dans la journée du 22 avril. Le soir même, les Indas abandonnaient leur campement et remontaient le cours de la Fitz-Roy river.
Voilà ce qu’avait fait Len Burker, voilà comment il était arrivé à son but, et, maintenant, on va voir quel parti il allait tirer de cette situation.
C’était vers huit heures du matin, le 23, que la porte de la hutte s’était ouverte. John Branican venait de se trouver en présence de Len Burker.
Quatorze ans s’étaient écoulés depuis le jour où le capitaine lui avait serré une dernière fois la main au départ du Franklin du port de San-Diégo. Il ne le reconnut pas, mais Len Burker fut frappé de ce que John eût si peu changé relativement. Vieilli, sans doute, – il avait quarante-trois ans alors, – mais moins qu’on aurait pu le croire après un sa long séjour chez les indigènes, il avait toujours ses traits accentués, ce regard résolu dont le feu ne s’était point éteint, son épaisse chevelure, blanchie il est vrai. Resté solide et robuste, John, mieux que Harry Felton peut-être, eût supporté les fatigues d’une évasion à travers les déserts australiens, – fatigues auxquelles son compagnon avait succombé.
En apercevant Len Burker, le capitaine John recula tout d’abord. C’était la première fois qu’il se trouvait en face d’un blanc depuis qu’il était prisonnier des Indas. C’était la première fois qu’un étranger allait lui adresser la parole.
«Qui êtes-vous? demanda-t-il.
– Un Américain de San-Diégo.
– De San-Diégo?…
– Je suis Len Burker…
– Vous!»
Le capitaine John s’élança vers Len Burker, il lui prit les mains, il l’entoura de ses bras… Quoi?… Cet homme était Len Burker… Non!… c’était impossible… Il n’y avait là qu’une apparence… John avait mal entendu… Il était sous l’influence d’une hallucination… Len Burker… le mari de Jane…
Et, en ce moment, le capitaine John ne songeait guère à l’antipathie que Len Burker lui inspirait autrefois, à l’homme qu’il avait si justement suspecté!
«Len Burker! répéta-t-il.
– Moi-même, John.
– Ici… dans cette région!… Ah!… vous aussi, Len… vous avez été fait prisonnier…»
Comment John aurait-il pu s’expliquer autrement la présence de Len Burker au campement des Indas?
«Non, se hâta de répondre Len Burker, non, John, et je ne suis venu que pour vous racheter au chef de cette tribu… pour vous délivrer…
– Me délivrer!»
Le capitaine John ne parvint à se dominer qu’au prix d’un violent effort. Il lui semblait qu’il allait devenir fou, que sa raison était sur le point de l’abandonner…
Enfin, lorsqu’il fut redevenu maître de lui, il eut la pensée de se jeter hors de la hutte… Il n’osa pas… Len Burker lui avait parlé de sa délivrance!… Mais était-il libre?… Et Willi!… Et les Indas?…
«Parlez, Len, parlez!» dit-il, après s’être croisé les bras, comme s’il eût voulu empêcher sa poitrine d’éclater.
Alors Len Burker, fidèle au plan qu’il avait formé de ne dire qu’une partie des choses et de s’attribuer tout le mérite de cette campagne, allait raconter les faits à sa façon, lorsque John, d’une voix étranglée par l’émotion, s’écria:
«Et Dolly?… Dolly?…
– Elle est vivante, John.
– Et Wat… mon enfant?…
– Vivants… tous deux… et tous deux… à San-Diégo.
– Ma femme… mon fils!…» murmura John, dont les yeux se noyèrent de larmes.
Puis il ajouta:
«Maintenant, parlez… Len… parlez!… J’ai la force de vous entendre!»
Et Len Burker, poussant l’effronterie jusqu’à le regarder en face, lui dit:
«John, il y a quelques années, lorsque personne ne pouvait plus mettre en doute la perte du Franklin, ma femme et moi nous dûmes quitter San-Diégo et l’Amérique. De graves intérêts m’appelaient en Australie, et je me rendis à Sydney, où j’avais fondé un comptoir. Depuis notre départ, Jane et Dolly ne cessèrent jamais de rester en correspondance, car vous savez quelle affection les unissait l’une à l’autre, affection que ni le temps ni la distance ne pouvaient affaiblir.
– Oui… je sais! répondit John. Dolly et Jane étaient deux amies, et la séparation a dû leur paraître cruelle!
– Très cruelle, John, reprit Len Burker, mais, après quelques années, le jour était arrivé où cette séparation allait prendre fin. Il y a onze mois environ, nous nous préparions à quitter l’Australie pour retourner à San-Diégo, lorsqu’une nouvelle inattendue suspendit nos projets de départ. On venait d’apprendre ce qu’était devenu le Franklin, en quels parages il s’était perdu, et, en même temps, le bruit se répandait que le seul survivant du naufrage était prisonnier d’une tribu australienne, que c’était vous, John…
– Mais comment a-t-on pu savoir, Len?… Est-ce que Harry Felton?…
– Oui, cette nouvelle avait été rapportée par Harry Felton. Presque au terme de son voyage, votre compagnon avait été recueilli sur les bords du Parru, dans le sud du Queensland, et transporté à Sydney…
– Harry… mon brave Harry!… s’écria le capitaine John. Ah! je savais bien qu’il ne m’oublierait pas!… Dès qu’il a été rendu à Sydney, il a organisé une expédition…
– Il est mort, répondit Len Burker, mort des fatigues qu’il avait éprouvées!
– Mort!… répéta John. Mon Dieu… mort!… Harry Felton… Harry!»
Et des larmes coulèrent de ses yeux.
«Mais, avant de mourir, reprit Len Burker, Harry Felton avait pu raconter les événements qui suivirent la catastrophe du Franklin, le naufrage sur les récifs de l’île Browse, dire comment vous aviez atteint l’ouest du continent… C’est à son chevet que moi… j’ai tout appris de sa bouche… tout!… Puis, ses yeux se sont fermés, John, tandis qu’il prononçait votre nom…
– Harry!… mon pauvre Harry!…» murmurait John, à la pensée de ces effroyables misères auxquelles avait succombé ce fidèle compagnon qu’il ne devait plus revoir.
– John, reprit Len Burker, la perte du Franklin, dont on était sans nouvelles depuis quatorze ans, avait eu un retentissement considérable. Vous jugez de l’effet qui se produisit, lorsque le bruit se répandit que vous étiez vivant… Harry Felton vous avait laissé, quelques mois auparavant, prisonnier d’une tribu du nord… Je fis immédiatement passer un télégramme à Dolly, en la prévenant que j’allais me mettre en route pour vous retirer des mains des Indas, car ce ne devait être qu’une question de rançon, d’après ce qu’avait dit Harry Felton. Puis, ayant organisé une caravane dont j’ai pris la direction, Jane et moi nous avons quitté Sydney. Voilà de cela sept mois… Il ne nous a pas fallu moins que ce temps pour atteindre la Fitz-Roy… Enfin, Dieu aidant, nous sommes arrivés au campement des Indas…
– Merci, Len, merci!… s’écria le capitaine John. Ce que vous avez fait pour moi…
– Vous l’auriez fait pour moi en pareilles circonstances, répondit Len Burker.
– Certes!… Et votre femme, Len, cette courageuse Jane, qui n’a pas craint de braver tant de fatigues, où est-elle?…
– A trois jours de marche en amont, avec deux de mes hommes, répondit Len Burker.
– Je vais donc la voir…
– Oui, John, et si elle n’est pas ici, c’est que je n’ai pas voulu qu’elle m’accompagnât, ne sachant trop quel accueil les indigènes feraient à notre petite caravane…
– Mais vous n’êtes pas venu seul? demanda le capitaine John.
– Non, j’ai là mon escorte, composée d’une douzaine de noirs. Il y a deux jours que je suis arrivé dans cette vallée…
– Deux jours?…
– Oui, et je les ai employés à conclure mon marché. Ce Willi tenait à vous, mon cher John… Il connaissait votre importance… ou plutôt votre valeur… Il a fallu longuement discuter pour obtenir qu’il vous rendît la liberté contre rançon…
– Alors je suis libre?…
– Aussi libre que je le suis moi-même.
– Mais les indigènes?…
– Ils sont partis avec leur chef, et il n’y a plus que nous an campement.
– Partis?… s’écria John.
– Voyez!»
Le capitaine John s’élança d’un bond hors de la hutte.
En ce moment, sur le bord de la rivière, il n’y avait que les noirs de l’escorte de Len Burker: les Indas n’étaient plus là.
On voit ce qu’il y avait de vrai et de mensonger dans le récit de Len Burker. De la folie de mistress Branican, il n’avait rien dit. De la fortune qui était échue à Dolly par la mort d’Edward Starter, il n’avait pas parlé. Rien, non plus, des tentatives faites par le Dolly-Hope à travers les parages de la mer des Philippines et le détroit de Torrès pendant les années 1879 et 1882. Rien de ce qui s’était passé entre Mrs. Branican et Harry Felton à son lit de mort. Rien enfin de l’expédition organisée par cette intrépide femme, maintenant abandonnée au milieu du Great-Sandy-Desert, et dont lui, l’indigne Burker, s’attribuait le mérite. C’était lui qui avait tout fait, c’était lui qui, au risque de sa vie, avait délivré le capitaine John!
Et comment John aurait-il pu mettre en doute la véracité de ce récit? Comment n’aurait-il pas remercié avec effusion celui qui, après tant de périls, venait de l’arracher aux Indas, celui qui allait le rendre à sa femme et à son enfant?
C’est ce qu’il fit, et en termes qui auraient touché un être moins dénaturé. Mais le remords n’avait plus prise sur la conscience de Len Burker, et rien ne l’empêcherait d’aller jusqu’à l’accomplissement de ses criminels projets. Maintenant John Branican se hâterait de le suivre jusqu’au campement où Jane l’attendait… Pourquoi eût-il hésité?… Et, pendant ce trajet, Len Burker trouverait l’occasion de le faire disparaître, sans être soupçonné des noirs de son escorte, qui ne pourraient témoigner ultérieurement contre lui…
Le capitaine John étant impatient de partir, il fut convenu que le départ s’effectuerait le jour même. Son plus vif désir était de revoir Jane, l’amie dévouée de sa femme, de lui parler de Dolly et de leur enfant, de M. William Andrew, de tous ceux qu’il retrouverait à San-Diégo…
On se mit en route dans l’après-midi du 23 avril.
Len Burker avait des vivres pour quelques jours. Pendant le voyage, la Fitz-Roy devait fournir l’eau nécessaire à la petite caravane. Les chameaux, qui servaient de montures à John et à Len Burker, leur permettraient au besoin, de devancer leur escorte de quelques étapes. Cela faciliterait les desseins de Len Burker… Il ne fallait pas que le capitaine John arrivât au campement… et il n’y arriverait pas.
A huit heures du soir, Len Burker s’établit sur la rive gauche de la rivière pour y passer la nuit. Il était encore trop éloigné, pour mettre à exécution son projet de devancer l’escorte, au milieu de ces régions où quelques mauvaises rencontres étaient toujours à craindre.
Aussi, le lendemain, dès l’aube, reprit-il sa marche avec ses compagnons.
La journée suivante se partagea en deux étapes, qui ne furent interrompues que par une halte de deux heures. Il n’était pas toujours facile de suivre le cours de la Fitz-Roy, dont les berges étaient tantôt coupées de profondes entailles, tantôt barrées par des massifs inextricables de gommiers et d’eucalyptus, ce qui obligeait à faire de longs détours.
La journée avait été très dure, et, après leur repas, les noirs s’endormirent.
Quelques instants plus tard, le capitaine John était plongé dans un profond sommeil.
Il y avait peut-être là une occasion dont Len Burker aurait pu profiter, car il ne dormait pas, lui. Frapper John, traîner son cadavre à une vingtaine de pas, le précipiter dans la rivière, il semblait même que les circonstances se réunissaient pour faciliter la perpétration de ce crime. Puis, le lendemain, au moment du départ, on aurait vainement cherché le capitaine John…
Vers les deux heures du matin, Len Burker, se relevant sans bruit, rampa vers sa victime, un poignard à la main, et il allait le frapper, lorsque John se réveilla.
«J’avais cru vous entendre m’appeler? dit Len Burker.
– Non, mon cher Len, répondit John. Au moment où je me suis réveillé, je rêvais de ma chère Dolly et de notre enfant!»
A six heures, le capitaine John et Len Burker reprirent leur route le long de la Fitz-Roy.
Pendant la halte de midi, Len Burker, décidé à en finir puisqu’il devait arriver le soir même au campement, proposa à John de devancer leur escorte.
John accepta, car il lui tardait d’être près de Jane, de pouvoir lui parler plus intimement qu’il n’avait pu le faire avec Len Burker.
Tous deux allaient donc partir, lorsqu’un des noirs signala, à quelques centaines de pas, un blanc qui s’avançait, non sans prendre certaines précautions.
Un cri échappa à Len Burker…
Il avait reconnu Godfrey.
![]()
Le dernier campement
![]() ntraîné par une sorte d’instinct, sans presque avoir conscience de ce qu’il faisait, le capitaine John venait de se précipiter au devant du jeune garçon.
ntraîné par une sorte d’instinct, sans presque avoir conscience de ce qu’il faisait, le capitaine John venait de se précipiter au devant du jeune garçon.
Len Burker était resté immobile, comme si ses pieds eussent été cloués au sol.
Godfrey en face de lui… Godfrey, le fils de Dolly et de John! Mais, la caravane de Mrs. Branican n’avait donc pas succombé?… Elle était donc là… à quelques milles… à quelques centaines de pas… à moins que Godfrey fût le seul survivant de ceux que le misérable avait abandonnés?
Quoi qu’il en soit, cette rencontre si inattendue pouvait anéantir tout le plan de Len Burker. Si le jeune novice parlait, il dirait que Mrs. Branican était à la tête cette expédition… Il dirait que Dolly avait affronté mille fatigues, mille dangers au milieu des déserts australiens pour porter secours à son mari… Il dirait qu’elle était là… qu’elle le suivait en remontant le cours de la Fitz-Roy…
Et cela était, en effet.
Le matin du 22 mars, après l’abandon de Len Burker, la petite caravane s’était remise en marche dans la direction du nord-ouest. Le 8 avril, on le sait, ces pauvres gens, épuisés par la faim, torturés par la soif, étaient tombés à demi morts.
Soutenue par une force supérieure, Mrs. Branican avait essayé de ranimer ses compagnons, les suppliant de se remettre en marche, de faire un dernier effort pour atteindre cette rivière où ils pourraient trouver quelques ressources… C’était comme si elle se fût adressée à des cadavres, et Godfrey lui-même avait perdu connaissance.
Mais l’âme de l’expédition survivait en Dolly, et Dolly fit ce que ses compagnons ne pouvaient plus faire. C’était vers le nord-ouest qu’ils se dirigeaient, c’était de ce côté que Tom Marix et Zach Fren avaient tendu leurs bras défaillants… Dolly s’élança dans cette direction.
A travers la plaine qui se développait à perte de vue vers le couchant, sans vivres, sans moyens de transport, qu’espérait cette énergique femme?… Son but était-il de gagner la Fitz-Roy, d’aller chercher assistance soit chez les blancs du littoral, soit chez les indigènes nomades?… Elle ne savait, mais elle fit ainsi quelques milles, – une vingtaine en trois jours. Pourtant, ses forces la trahirent, elle tomba à son tour, et elle serait morte, si un secours ne lui fût arrivé – providentiellement, on peut dire.
Vers cette époque, la police noire battait l’estrade sur la limite du Great-Sandy-Desert. Après en avoir laissé une trentaine près de la Fitz-Roy, son chef, le mani, était venu opérer une reconnaissance dans cette partie de la province avec une soixantaine d’hommes.
Ce fut lui qui rencontra Mrs. Branican. Dès qu’elle eut repris connaissance, elle put dire où étaient ses compagnons, et on la ramena vers eux. Le mani et ses hommes parvinrent à ranimer ces pauvres gens, dont pas un n’eût été retrouvé vivant vingt-quatre heures plus tard.
Tom Marix, qui avait autrefois connu le mani dans la province du Queensland, lui fît le récit de ce qui s’était passé depuis le départ d’Adélaïde. Cet officier n’ignorait pas dans quel but une caravane, dirigée par Mrs. Branican, était alors engagée à travers les lointaines régions du nord-ouest, et, puisque la Providence voulait qu’il eût pu la secourir, il lui offrit de se joindre à elle. Et, lorsque Tom Marix eut parlé des Indas, le mani répondit que cette tribu occupait alors les bords de la Fitz-Roy, à moins de soixante milles.
Il n y avait pas de temps à perdre, si l’on voulait déjouer les projets de Len Burker, que le mani avait déjà eu mission de poursuivre, lorsqu’il courait avec une bande de bushrangers la province du Queensland. Il n’était pas douteux que si Len Burker parvenait à délivrer le capitaine John, qui n’avait aucune raison de se défier de lui, il serait impossible de retrouver leurs traces?
Mrs. Branican pouvait compter sur le mani et sur ses hommes, qui partagèrent leurs vivres avec ses compagnons et leur prêtèrent leurs chevaux. La troupe partit le soir même, et dans l’après-midi du 21 avril, les hauteurs de la vallée se montraient à peu près sur la limite du dix-septième parallèle.
En cet endroit, le mani retrouva ceux de ses agents qui étaient restés en surveillance le long de la Fitz-Roy. Ils lui apprirent que les Indas étaient alors campés à une centaine de milles sur le cours supérieur de la rivière. Ce qui importait, c’était de les rejoindre au plus tôt, bien que Mrs. Branican n’eût plus rien des objets d’échange destinés à la rançon du capitaine. D’ailleurs, le mani, renforcé de toute sa brigade, aidé de Tom Marix, de Zach Fren, de Godfrey, de Jos Meritt et de leurs compagnons, n’hésiterait pas à employer la force pour arracher John aux Indas. Mais, lorsqu’on eut remonté la vallée jusqu’au campement des indigènes, ceux-ci l’avaient déjà abandonné. Le mani les suivit d’étape en étape, et c’est ainsi que, dans l’après-midi du 25 avril, Godfrey, qui s’était porté d’un demi-mille en avant, se trouva soudain en présence du capitaine John.
Cependant Len Burker était parvenu à se remettre, regardant Godfrey, sans prononcer un mot, attendant ce que le jeune novice allait faire, ce qu’il allait dire.
Godfrey ne l’avait pas même aperçu. Ses regards ne pouvaient se détacher du capitaine. Bien qu’il ne l’eût jamais vu, il connaissait ses traits d’après le portrait photographique que Mrs. Branican lui avait donné. Nul doute possible… Cet homme était le capitaine John.
De son côté, John regardait Godfrey avec une émotion non moins extraordinaire. Bien qu’il ne pût deviner quel était ce jeune garçon, il le dévorait des yeux… il lui tendait ses mains… il l’appelait d’une voix tremblante… oui! il l’appelait comme si c’eût été son fils.
Godfrey se précipita dans ses bras, en s’écriant:
«Capitaine John!
– Oui… moi… c’est moi! répondit le capitaine John. Mais… toi…mon enfant… qui es-tu?… D’où viens-tu?… Comment sais-tu mon nom?…»
Godfrey ne put répondre. Il était devenu effroyablement pâle, en apercevant Len Burker, et, ne pouvant maîtriser l’horreur qu’il éprouvait à la vue de ce misérable:
«Len Burker!» s’écria-t-il.
Len Burker, après avoir réfléchi aux suites de cette rencontre, ne pouvait que s’en féliciter. N’était-ce pas le plus heureux des hasards, qui lui livrait à la fois Godfrey et John? N’était-ce pas une incroyable chance que d’avoir à sa merci le père et l’enfant? Aussi, s’étant retourné vers les noirs, leur fit-il signe de séparer Godfrey et John, de les saisir…
«Len Burker!… répéta Godfrey!
– Oui, mon enfant, répondit John, c’est Len Burker… celui qui m’a sauvé…
– Sauvé! s’écria Godfrey. Non, capitaine John, non, Len Burker ne vous a pas sauvé!… Il a voulu vous perdre, il nous a abandonnés, il a volé votre rançon à mistress Branican…»
A ce nom, John répondit par un cri, et, saisissant la main de Godfrey:
«Dolly?… Dolly?… répétait-il.
– Oui… mistress Branican, capitaine John, votre femme… qui est près d’ici!…
– Dolly?… s’écria John.
– Ce garçon est fou!… dit Len Burker, en s’approchant de Godfrey.
– Oui!… fou!… murmura le capitaine John. Le pauvre enfant est fou!
– Len Burker, reprit Godfrey, qui tremblait de colère, vous êtes un traître… vous êtes un assassin!… Et si cet assassin est ici, capitaine John, c’est qu’il veut se défaire de vous, après avoir abandonné mistress Branican et ses compagnons…
– Dolly!… Dolly!… s’écria le capitaine John. Non… Tu n’es pas un fou, mon enfant!… Je te crois… je te crois!… Viens!… viens!»
Len Burker et ses hommes se précipitèrent sur John et sur Godfrey, qui, prenant un revolver à sa ceinture, frappa un des noirs en pleine poitrine. Mais John et lui furent saisis, et les noirs les entraînèrent vers la rivière.
Heureusement, la détonation avait été entendue. Des cris lui répondirent à quelques centaines de pas en aval, et presque aussitôt, le mani et ses agents, Tom Marix et ses compagnons, Mrs. Branican, Zach Fren, Jos Meritt, Gîn-Ghi, se précipitaient de ce côté.
Len Burker et les noirs n’étaient pas en force pour résister, et, un instant après, John était entre les bras de Dolly.
La partie était perdue pour Len Burker. Si l’on s’emparait de lui il n’avait aucune grâce à attendre, et, suivi de ses noirs, il prit la fuite en remontant le cours d’eau.
Le mani, Zach Fren, Tom Marix, Jos Meritt et une douzaine d’agents se lancèrent à sa poursuite.
Comment peindre les sentiments, comment rendre l’émotion qui débordait du cœur de Dolly et de John? Ils pleuraient, et Godfrey se mêlait à leurs étreintes, à leurs baisers, à leurs larmes.
Tant de joie fit alors sur Dolly ce que tant d’épreuves n’avaient pu faire. Ses forces l’abandonnèrent, et elle tomba sans connaissance.
Godfrey, agenouillé près d’elle, aidait Harriett à la ranimer. John l’ignorait, mais ils savaient, eux, qu’une première fois Dolly avait perdu la raison sous l’excès de la douleur… Allait-elle donc la perdre une seconde fois sous l’excès contraire?
«Dolly!… Dolly!» répétait John.
Et Godfrey, prenant les mains de Mrs. Branican, s’écriait:
«Ma mère… ma mère!»
Les yeux de Dolly se rouvrirent, sa main serra la main de John, dont la joie débordait et qui tendit ses bras à Godfrey, en disant:
«Viens… Wat!… Viens, mon fils! «
Mais Dolly ne pouvait le laisser dans cette erreur, lui laisser croire que Godfrey fût son enfant…
«Non, John, dit-elle, non… Godfrey n’est pas notre fils!… Notre pauvre petit Wat est mort… mort peu de temps après ton départ!…
– Mort!» s’écria John, qui, cependant, ne cessait de regarder Godfrey.
Dolly allait lui dire quel malheur l’avait frappée quinze années auparavant, lorsqu’une détonation retentit du côté où le mani et ses compagnons s’étaient mis à la poursuite de Len Burker.
Est-ce que justice avait été faite du misérable, ou était-ce un nouveau crime que Len Burker avait eu le temps de commettre?
Presque aussitôt, tous reparurent en groupe sur la rive de la Fitz-Roy. Deux des agents rapportaient une femme, dont le sang s’échappait d’une large blessure et rougissait le sol.
C’était Jane.
Voici ce qui s’était passé.
Malgré la rapidité de sa fuite, ceux qui poursuivaient Len Burker ne l’avaient point perdu de vue, et quelques centaines de pas les séparaient encore de lui, lorsqu’il s’arrêta en apercevant Jane.
Depuis la veille, cette infortunée, étant parvenue à s’échapper, descendait le long de la Fitz-Roy. Elle allait comme au hasard et lorsque les premières détonations se firent entendre, elle n’était pas à un quart de mille de l’endroit où John et Godfrey venaient de se retrouver. Elle hâta sa course, et se vit bientôt en présence de son mari qui fuyait de ce côté.
Len Burker, l’ayant saisie par le bras, voulut l’entraîner. A la pensée que Jane rejoindrait Dolly, qu’elle lui dévoilerait le secret de la naissance de Godfrey, sa fureur fut portée au comble. Et, comme Jane résistait, il la renversa d’un coup de poignard.
A ce moment, éclata un coup de fusil, qui fut accompagné de ces mots – bien en situation, cette fois:
«Bien!… Oh!… Très bien!»
C’était Jos Meritt qui, après avoir tranquillement ajusté Len Burker, venait de le faire rouler dans les eaux de la Fitz-Roy.
C’était fini de ce misérable, frappé d’une balle au cœur par la main du gentleman.
Tom Marix s’élança vers Jane qui respirait encore, mais bien faiblement. Deux agents prirent la malheureuse femme entre leurs bras, et la rapportèrent près de Mrs. Branican.
Envoyant Jane dans cet état, Dolly poussa un cri déchirant. Penchée sur la mourante, elle cherchait à entendre les battements de son cœur, à surprendre le souffle qui s’échappait de sa bouche. Mais la blessure de Jane était mortelle, le poignard lui ayant traversé les poumons.
«Jane… Jane!…» répéta Dolly d’une voix forte.
A cette voix, qui lui rappelait les seules affections qu’elle eût jamais connues, Jane rouvrit les yeux, regarda Dolly, et lui sourit en murmurant:
«Dolly!… Chère Dolly!»
Soudain son regard s’anima. Elle venait d’apercevoir le capitaine John.
«John… vous… John! dit-elle, mais si bas qu’on put à peine l’entendre.
– Oui… Jane, répondit Je capitaine, c’est moi… moi que Dolly est venu sauver…
– John… John est là!… murmura-t-elle.
– Oui… près de nous, ma Jane! dit Dolly. Il ne nous quittera plus… nous le ramènerons avec toi… avec toi… la bas…»
Jane n’écoutait plus. Ses yeux semblaient chercher quelqu’un et elle prononça ce nom:
«Godfrey!… Godfrey!»
Et l’angoisse se peignit sur ses traits déjà décomposés par l’agonie.
Mrs. Branican fit signe à Godfrey, qui s approcha.
«Lui!… lui… enfin!» s’écria Jane, qui se redressa dans un dernier effort.
Puis, saisissant la main de Dolly:
«Approche… approche, Dolly, reprit-elle. John et toi, écoutez ce que j’ai encore à dire!»
Tous deux se penchèrent sur Jane de manière à ne pas perdre une seule de ses paroles.
«John, Dolly, dit-elle, Godfrey… Godfrey qui est là… Godfrey est votre enfant…
– Notre enfant!» murmura Dolly.
Et elle devint aussi pâle que l’était la mourante, tant le sang lui reflua violemment au cœur.
«Nous n’avons plus de fils! dit John. Il est mort…
– Oui, répondit Jane, le petit Wat… là-bas… dans la baie de San-Diégo… Mais vous avez eu un second enfant, et cet enfant… c’est Godfrey!»
En quelques phrases, entrecoupées par les hoquets de la mort. Jane put dire ce qui s’était passé après le départ du capitaine John, la naissance de Godfrey à Prospect-House, Dolly, privée de raison, devenue mère sans le savoir, le petit être exposé par ordre de Len Burker, recueilli quelques heures après, puis élevé plus tard à l’hospice de Wat-House sous le nom de Godfrey…
Et Jane ajouta:
«Si je suis coupable de n’avoir pas eu le courage de tout t’avouer, ma Dolly, pardonne-moi… pardonnez-moi, John!
– As-tu besoin de pardon, Jane… toi qui viens de nous rendre notre enfant…
– Oui… votre enfant! s’écria Jane. Devant Dieu… John, Dolly, je le jure… Godfrey est votre enfant!»
Et voyant que tous deux pressaient Godfrey dans leurs bras, Jane eut un sourire de bonheur, qui s’éteignit dans son dernier soupir.
![]()
Dénouement
![]() l est inutile de s’attarder aux incidents qui terminèrent cet aventureux voyage à travers le continent australien, et dans quelles conditions si différentes se fit ce retour vers la province d’Adélaïde.
l est inutile de s’attarder aux incidents qui terminèrent cet aventureux voyage à travers le continent australien, et dans quelles conditions si différentes se fit ce retour vers la province d’Adélaïde.
Tout d’abord avait été discutée une question: Devait-on gagner les établissements du littoral, en descendant la rivière Fitz-Roy – entre autres ceux de Rockbonne – ou se diriger vers le port du Prince-Frederik, dans le York-Sund. Mais bien du temps se fût écoulé, avant qu’un navire eût pu être expédié vers ce littoral, et il parut préférable de reprendre la route déjà parcourue. Escortée par les agents de la police noire, abondamment pourvue de vivres par les soins du mani, ayant à sa disposition les chameaux de selle et de bât repris à Len Burker, la caravane n’aurait rien à craindre des mauvaises rencontres.
Avant le départ, le corps de Jane Burker fut déposé dans une tombe, creusée au pied d’un groupe de gommiers. Dolly s’agenouilla sur cette tombe et pria pour l’âme de cette pauvre femme.
Le capitaine John, sa femme et leurs compagnons quittèrent le campement de la Fitz-Roy-river à la date du 25 avril, sous la direction du mani qui avait offert de l’accompagner jusqu’à la plus proche station de l’Overland-Telegraf-Line.
Tous étaient si heureux que l’on ne sentait même pas les fatigues du voyage, et Zach Fren, dans sa joie, répétait à Tom Marix.
«Eh bien, Tom, nous l’avons retrouvé le capitaine!
– Oui, Zach, mais à quoi cela a-t-il tenu?
– A un bon coup de barre que la Providence a donné à propos, Tom, et il faut toujours compter sur la Providence!…»
Cependant, il y avait un point noir à l’horizon de Jos Meritt. Si Mrs. Branican avait retrouvé le capitaine John, le célèbre collectionneur n’avait point retrouvé le chapeau, dont la recherche lui coûtait tant de peines et tant de sacrifices. Être allé jusque chez les Indas, et ne pas être entré en communication avec ce Willi, qui se coiffait peut-être du couvre-chef historique, quelle malchance! Ce qui consola un peu Jos Meritt, il est vrai, ce fut d’apprendre par le mani que la mode des coiffures européennes n’était pas parvenue chez les peuplades du nord-ouest, contrairement à ce que Jos Meritt avait observé déjà chez les peuplades du nord-est. Donc, son desideratum n’aurait pu se réaliser parmi les indigènes de l’Australie septentrionale. En revanche, il pouvait se féliciter du maître coup de fusil qui avait débarrassé la famille Branican «de cet abominable Len Burker!» comme disait Zach Fren.
Le retour s’opéra aussi rapidement que possible. La caravane n’eut pas trop à souffrir de la soif, caries puits étaient déjà remplis sous les larges averses de l’automne, et la température se maintenait à un degré supportable. D’ailleurs, sur l’avis du mani, on gagna directement les régions traversées par la ligne télégraphique, où ne manquent ni les stations suffisamment approvisionnées, ni les moyens de communication avec la capitale de l’Australie méridionale. Grâce au télégraphe, on sut bientôt dans le monde entier que Mrs. Branican avait mené à bonne fin son audacieuse expédition.
Ce fut à la hauteur du lac Wood que John, Dolly et leurs compagnons atteignirent l’une des stations de l’Overland-Telegraf-Line. Là, le mani et les agents de la police noire durent prendre congé de John et de Dolly Branican. Ils ne s’en séparèrent pas sans avoir reçu les chaleureux remerciements qu’ils méritaient – en attendant les récompenses que le capitaine leur fit parvenir dès son arrivée à Adélaïde.
Il n’y avait plus qu’à descendre les districts la Terre Alexandra jusqu’à la station d’Alice-Spring, où la caravane s’arrêta dans la soirée du 19 juin, après sept semaines de voyage.
Là, sous la garde de M. Flint, le chef de la station, Tom Marix retrouva le matériel qu’il y avait laissé, les bœufs, les chariots, les buggys, les chevaux destinés aux étapes qui restaient à parcourir.
Il s’ensuit donc que, le 3 juillet, tout le personnel atteignit le railway de Farina-Town, et le lendemain la gare d’Adélaïde.
Quel accueil fut fait au capitaine John et à sa courageuse compagne! Il y eut concours de toute la ville pour les recevoir, et lorsque le capitaine John Branican parut entre sa femme et son fils au balcon de l’hôtel de King-William-Street, les hips et les hurrahs éclatèrent avec une telle intensité que, suivant Gîn-Ghi, on avait dû les entendre de l’extrémité du Céleste-Empire.
Le séjour à Adélaïde ne fut pas de longue durée. John et Dolly Branican avaient hâte d’être de retour à San-Diégo, de revoir leurs amis, de retrouver leur chalet de Prospect-House, où le bonheur allait rentrer avec eux. On prit alors congé de Tom Marix et de ses hommes, qui furent généreusement récompensés, et dont on ne devait jamais oublier les services.
On n’oublierait pas non plus cet original de Jos Meritt, qui se décida, lui aussi, à quitter l’Australie avec son fidèle serviteur.
Mais enfin puisque «son chapeau» ne s’y trouvait pas, où donc se trouvait-il?
Où?… Dans une demeure royale, où il était conservé avec tout le respect qui lui était dû. Oui! Jos Meritt, égaré sur de fausses pistes, avait inutilement parcouru les cinq parties du monde, pour conquérir ce chapeau… qui se trouvait au château de Windsor, ainsi qu’on l’apprit six mois plus tard. C’était le chapeau que portait Sa Gracieuse Majesté lors de sa visite au roi Louis-Philippe en 1845, et il fallait être fou, atout le moins, pour imaginer que ce chef-d’œuvre d’une modiste parisienne aurait pu achever sa carrière sur le crâne crépu d’un sauvage de l’Australie!
Il en résulta donc que les pérégrinations de Jos Meritt cessèrent enfin à l’extrême joie de Gin-Ghi, mais à l’extrême déplaisir du célèbre bibelomane, qui revint à Liverpool, très dépité de n’avoir pu compléter sa collection par l’acquisition de ce chapeau unique au monde.
Trois semaines après avoir quitté Adélaïde, où ils s’étaient embarqués sur l’Abraham-Lincoln, John, Dolly et Godfrey Branican. accompagnés de Zach Fren et de la femme Harriett, arrivèrent à San-Diégo.
C’est là que M. William Andrew et le capitaine Ellis les reçurent, au milieu des habitants de cette généreuse cité, fière d’avoir retrouvé le capitaine John et de saluer en lui l’un de ses plus glorieux enfants.
FIN DE LA DEUXIÈME ET DERNIÈRE PARTIE.