Jules Verne
Le Chancellor
Journal du passager J.-R. Kazallon
(Chapitre XLV-LVII)
Illustré par Riou
Bibliothèque d’Éducation et de Recréation,1875
© Andrzej Zydorczak
– 16 janvier. – Nous sommes tous étendus sur les voiles. L’équipage d’un navire qui passerait croirait voir une épave couverte de morts.
Je souffre horriblement. Dans l’état où sont mes lèvres, ma langue, mon gosier, pourrais-je manger? je ne le crois pas, et cependant mes compagnons et moi, nous jetons les uns sur les autres des regards sauvages.
La chaleur, aujourd’hui, est d’autant plus forte que le ciel est orageux. Il y a de grosses vapeurs qui se lèvent, mais il me semble vraiment qu’il peut pleuvoir partout, excepté sur ce radeau.
Pourtant, chacun regarde monter les nuages d’un œil avide. Nos lèvres se tendent vers eux. M. Letourneur élève ses mains suppliantes vers ce ciel impitoyable!
J’écoute si quelque grondement lointain annonce un orage. Il est onze heures du matin. Les vapeurs ont arrêté les rayons solaires, mais déjà elles n’ont plus une apparence électrique. Il est évident que l’orage ne se déchaînera pas, car la masse a pris une teinte uniforme, et ses contours, si nettement arrêtés au lever du jour, se sont fondus dans un ensemble grisâtre. Ce n’est plus, maintenant, qu’un brouillard.
Mais la pluie ne peut-elle se dégager de ce brouillard, si peu que ce soit, quelques gouttes seulement!
«La pluie!»crie tout d’un coup Daoulas.
En effet, à un demi-mille du radeau, le ciel est rayé de hachures parallèles. La pluie tombe, et je vois les gouttelettes rebondir à la surface de l’Océan. Le vent, qui a fraîchi, porte sur nous. Pourvu que ce nuage ne s’épuise pas avant d’avoir passé sur notre tête!
Dieu a enfin pitié de nous. La pluie tombe à grosses gouttes, telles qu’en répandent les nuages orageux. Mais cette averse ne durera pas, et il faut recueillir tout ce qu’elle pourra donner, car déjà une vive traînée de lumière enflamme le nuage par son bord inférieur au-dessus de l’horizon.
Robert Kurtis a fait dresser la barrique brisée, de manière à retenir le plus d’eau possible, et les voiles sont déployées pour recevoir la pluie sur une plus grande surface.
Nous sommes couchés à la renverse, la bouche ouverte. L’eau arrose ma figure, mes lèvres, et je sens qu’elle glisse jusque dans ma gorge! Ah! jouissance inexprimable! C’est la vie qui coule en moi! Les muqueuses de mon gosier se lubréfient à ce contact. Je respire autant que je bois cette eau vivifiante, qui pénètre jusqu’au plus profond de mon être!
La pluie a duré vingt minutes environ; puis le nuage, à demi épuisé, s’est fondu dans l’espace.
Nous nous sommes relevés meilleurs, oui! «meilleurs». On se presse les mains, on parle! Il semble que nous soyons sauvés! Dieu, dans sa miséricorde, nous enverra d’autres nuages qui nous apporteront encore l’eau dont nous avons été si longtemps privés!
Et puis, cette eau qui est tombée sur le radeau ne sera pas perdue, La barrique et les voiles l’ont recueillie, mais il faudra la conserver précieusement et ne la distribuer que goutte à goutte.
En effet, la barrique a retenu environ deux à trois pintes d’eau, et, en exprimant celle qui imbibe les voiles, nous pourrons accroître notre réserve dans une certaine proportion.
Les matelots vont procéder à cette opération, d’un geste, Robert Kurtis les arrête.
«Un instant! dit-il. Cette eau est-elle potable?»
Je le regarde. Pourquoi cette eau, qui n’est que de l’eau de pluie, ne serait-elle pas potable?
Robert Kurtis exprime dans la tasse de ferblanc un peu de l’eau contenue dans les plis d’une voile; puis, il la goûte, et, à ma très-grande surprise, il la rejette immédiatement.
Je goûte à mon tour. Cette eau est plus que saumâtre! On dirait de l’eau de mer!
C’est que les voiles, depuis si longtemps exposées à l’action des lames, ont communiqué à l’eau recueillie une salure extrême. C’est un malheur irréparable! N’importe! Nous avons confiance. D’ailleurs, il reste quelques pintes potables dans la barrique! Et puis, la pluie est venue! Elle reviendra!
![]()
– 17 janvier. – Si notre soif s’est un instant calmée, la faim, par une conséquence naturelle, nous a repris avec plus de violence. N’y a-t-il donc aucun moyen, sans émérillon ni amorce, de s’emparer de l’un de ces requins qui fourmillent autour du radeau? Non, à moins de se jeter à la mer, pour attaquer ces monstres à coups de couteau et dans leur propre élément, ainsi que font les Indiens des pêcheries de perles. Robert Kurtis a songé à tenter l’aventure. Nous l’avons retenu. Les requins sont trop nombreux, et ce serait se dévouer, sans aucun profit, à une mort certaine.
J’observe ici que si l’on peut parvenir à tromper la soif, soit en se plongeant dans la mer, soit en mâchant quelque objet de métal, il n’en est pas ainsi de la faim, et que rien ne peut suppléer la substance nutritive. D’ailleurs, l’eau peut toujours être produite par un fait naturel, – la pluie par exemple. Donc, si l’on ne doit jamais complètement désespérer de boire, on peut absolument désespérer de manger.
Or, nous en sommes arrivés là! Pour tout avouer, quelques-uns de mes compagnons se regardent d’un œil avide. Que l’on comprenne sur quelle pente nos idées glissent, et à quelle sauvagerie la misère peut pousser des cerveaux obsédés par une préoccupation unique!
Depuis que les nuages orageux qui nous ont donné une demi-heure de pluie sont passés, le ciel est redevenu pur. Le vent a fraîchi un instant, mais bientôt il calmit, et la voile pend le long du mât. Le vent, d’ailleurs, nous ne le considérons plus comme un moteur. Où est le radeau? En quel point de l’Atlantique les courants l’ont-ils poussé? Nul ne peut le dire, ni souhaiter que le vent souffle de l’est plutôt que du nord ou du sud! Nous ne demandons qu’une chose à cette brise, c’est qu’elle rafraîchisse nos poitrines, c’est qu’elle mêle un peu de vapeur à l’air sec qui nous dévore, c’est qu’elle tempère enfin cette chaleur que verse du zénith un soleil de feu.
Le soir est arrivé, et la nuit sera obscure jusqu’à minuit, heure à laquelle se lèvera la lune, qui entre dans son dernier quartier. Les constellations, un peu embrumées, ne projettent pas cet étincellement superbe qui illumine les nuits froides.
En proie à une sorte de délire, sous l’impression d’une faim atroce qui habituellement redouble avec la chute du jour, je vais m’étendre sur un paquet de voiles jeté à tribord, et là, je me penche au-dessus des flots pour en aspirer la fraîcheur.
De mes compagnons qui sont couchés à leur place accoutumée, combien trouvent dans le sommeil un oubli de leurs souffrances? pas un peut-être. Quant à moi, mon cerveau vide est assiégé de cauchemars.
Cependant, un assoupissement maladif, qui n’est ni la veille ni le sommeil, s’est emparé de moi. Je ne saurais dire combien de temps je suis resté dans cet état de prostration. Tout ce que je me rappelle, c’est que, à un certain moment, une sensation particulière m’en a tiré.
Je ne sais si je rêve, mais mon odorat est frappé d’une odeur qu’il ne reconnaît pas d’abord. C’est comme une émanation vague, qu’un reste de brise m’apporte par instants. Mes narines s’enflent et aspirent. «Qu’est-ce que cette odeur?» suis-je tenté de m’écrier… Une sorte d’instinct me retient, et je cherche comme on cherche dans sa mémoire un mot ou un nom oubliés.
Quelques instants se passent. L’intensité de l’émanation, plus vivement accusée, provoque chez moi des aspirations plus vives.
«Mais, dis-je tout à coup et comme un homme qui se souvient, c’est une odeur de chair cuite!»
Une aspiration plus active m’assure que mes sens n’ont pu m’abuser, et cependant, sur ce radeau…
Je me relève sur les genoux, j’aspire de nouveau, – qu’on me pardonne l’expression, – je renifle l’air ambiant!… La même émanation vient encore frapper mes narines. Je suis donc sous le vent de l’objet qui produit cette odeur, et, par conséquent, cet objet se trouve à l’avant du radeau.
Me voilà donc, quittant ma place, rampant comme un animal, furetant, non des yeux, mais du nez, me glissant sous les voiles, entre les espars, avec la prudence d’un chat, et ne voulant à aucun prix éveiller l’attention de mes compagnons.
Pendant quelques minutes, je rampe ainsi dans tous les coins, me guidant à l’odorat, comme un limier. Tantôt la trace m’échappe, soit que je m’éloigne du but, soit que la brise tombe, et tantôt l’émanation m’arrive avec une intensité nouvelle. Enfin, je la tiens, cette trace, je la suis, et je sens que je vais droit à l’objet!
En ce moment, j’ai atteint l’angle de tribord, à l’avant du radeau, et je reconnais que cette odeur est celle d’un morceau de lard fumé. Je ne me trompe pas. Toutes les papilles de ma langue se hérissent d’envie!
Il me faut alors m’insinuer sous un épais pli de voiles. Personne ne me voit, personne ne m’entend. Je me glisse sur les genoux, sur les coudes. J’allonge le bras. Ma main saisit un objet enfermé dans un morceau de papier. Je le retire rapidement, et je regarde à la clarté de la lune qui jaillit, en ce moment, au-dessus de l’horizon.
Ce n’est point une illusion. J’ai là, dans la main, un morceau de lard, à peine un quart de livre, mais de quoi calmer pour tout un jour mes tortures! Je porte à ma bouche…
Une main saisit la mienne. Je me retourne, retenant à peine un rugissement. Je reconnais le maître d’hôtel Hobbart.
Tout s’explique, la situation particulière d’Hobbart, sa santé restée relativement meilleure, ses plaintes hypocrites. Au moment du naufrage, il a pu sauver quelques provisions, il les a mises en réserve, il s’est nourri, pendant que nous mourions de faim! Ah! le misérable!
Mais non! Hobbart a sagement agi. Je trouve que c’est un homme prudent, avisé, et, s’il a conservé quelque nourriture à l’insu de tous, tant mieux pour lui… et pour moi.
Hobbart ne l’entend pas ainsi. Il saisit ma main et cherche à me reprendre le morceau de lard, mais sans parler; il ne veut pas attirer l’attention de ses camarades.
J’ai le même intérêt que lui à nie taire. Il ne faut pas que d’autres viennent m’arracher cette proie! Je lutte donc silencieusement, mais avec d’autant plus de rage que j’entends Hobbart dire entre ses dents: «Mon dernier morceau! ma dernière bouchée!»
Sa dernière bouchée! Il me la faut à tout prix, je la veux, je l’aurai! Je prends à la gorge mon adversaire, qui râle sous ma main et reste bientôt sans mouvement!
Et moi, je broie ce morceau de lard entre mes dents, tandis que je tiens Hobbart renversé…
Puis, lâchant le malheureux, je rampe de nouveau, et je reviens prendre ma place à l’arrière.
Personne ne m’a vu. J’ai mangé!
![]()
– 18 janvier. – J’attends le jour dans une anxiété singulière! Que dira Hobbart? Il me semble qu’il aura le droit de me dénoncer! Non! C’est absurde. Si je raconte ce qui s’est passé, si je dis comment Hobbart a vécu pendant que nous mourions de faim, comment il s’est nourri à notre insu, à notre préjudice, ses compagnons le massacreront sans pitié.
N’importe! je voudrais être au grand jour.
La faim a été momentanément arrêtée en moi, quoique ce morceau de lard fût bien peu de chose, – une bouchée, «la dernière», comme a dit ce malheureux. Cependant, je ne souffre plus, et, je le dis du fond du cœur, j’ai comme un remords de ne pas avoir partagé ce misérable débris avec mes compagnons. J’aurais dû penser à miss Herbey, à André, à son père… et je n’ai songé qu’à moi!
Cependant, la lune monte sur l’horizon, et bientôt les premières blancheurs du matin la suivent. Le jour se fera rapidement, car nous sommes sous ces basses latitudes qui ne connaissent ni l’aube ni le crépuscule.
Je n’ai pas fermé l’œil. Dès les premières lueurs, il me semble que je vois une masse informe qui se balance à mi-mât.
Quel est cet objet? Je ne puis le distinguer encore, et je reste étendu sur le paquet de voiles.
Mais les premiers rayons du soleil glissent enfin sur la mer, et bientôt j’aperçois un corps qui, se balançant à un bout de corde, obéit aux mouvements du radeau.
Un irrésistible pressentiment m’entraîne vers ce corps, et j’arrive au pied du mât…
Ce corps est celui d’un pendu. Ce pendu, c’est le maître d’hôtel Hobbart! Ce malheureux, c’est moi, oui, moi! qui l’ai poussé au suicide!
Un cri d’horreur m’échappe. Mes compagnons se relèvent, voient le corps, se précipitent… Mais ce n’est pas pour savoir si quelque étincelle de vie lui reste encore!… D’ailleurs, Hobbart est bien mort, et son cadavre est déjà froid.
En un instant, la corde est coupée. Le bosseman, Daoulas, Jynxtrop, Falsten, d’autres sont là, penchés sur ce cadavre…
Non! je n’ai pas vu! Je n’ai pas voulu voir! Je n’ai pas pris part à cet horrible repas! Ni miss Herbey, ni André Letourneur, ni son père n’ont voulu payer de ce prix un allégement à leurs souffrances!
Pour Robert Kurtis, j’ignore… Je n’ai pas osé lui demander.
Quant aux autres, le bosseman, Daoulas, Falsten, les matelots! Oh! l’homme changé en bête fauve… C’est épouvantable!
MM. Letourneur, miss Herbey, moi, nous nous sommes cachés sous la tente, nous n’avons rien voulu voir! C’était déjà trop d’entendre!
André Letourneur voulait se jeter sur ces cannibales, leur arracher ces horribles débris! Il m’a fallu lutter avec lui pour le retenir.
Et, pourtant, c’était leur droit, à ces malheureux! Hobbart était mort! Ils ne l’avaient pas tué! Et, comme l’a dit un jour le bosseman, «mieux vaut manger un mort qu’un vivant!»
Qui sait, maintenant, si cette scène n’est pas le prologue de quelque drame abominable qui va ensanglanter le radeau!
J’ai fait toutes ces observations à André Letourneur, mais je n’ai pu dissiper l’horreur qui chez lui est portée à son comble!
Cependant, que l’on songe à ceci: nous mourons de faim, et huit de nos compagnons vont peut-être échapper à cette mort affreuse!
Hobbart, grâce aux provisions qu’il avait cachées, était le plus valide de nous. Aucune maladie organique n’avait altéré ses tissus. C’est en pleine santé, par un coup brutal, qu’il a fini de vivre!…
Mais à quelles horribles réflexions mon esprit se laisse-t-il entraîner? Ces cannibales me font-ils donc plus envie qu’horreur?
En ce moment, l’un d’eux élève la voix. C’est le charpentier Daoulas.
Il parle de faire évaporer de l’eau de mer au soleil afin d’en recueillir le sel.
«Et nous salerons ce qui reste, dit-il.
– Oui,» répond le bosseman.
Puis, c’est tout. Sans doute la proposition du charpentier a été adoptée, car je n’entends plus rien. Un silence profond s’établit à bord du radeau, et j’en conclus que mes compagnons dorment.
Ils n’ont plus faim.
![]()
– 19 janvier. – Pendant la journée du 19 janvier, même ciel, même température. La nuit arrive sans apporter aucune modification dans l’état de l’atmosphère. Je n’ai pu dormir même pendant quelques heures.
Vers le matin, j’entends des cris de colère qui éclatent à bord.
MM. Letourneur, miss Herbey, qui sont avec moi sous la tente, se relèvent. J’écarte la toile, et je regarde ce qui se passe.
Le bosseman, Daoulas, les autres matelots sont dans une exaspération terrible. Robert Kurtis, assis à l’arrière, se lève, et, s’informant de ce qui excite leur fureur, il essaye de les calmer.
«Non! non! nous saurons qui a fait cela! dit Daoulas, en jetant un regard farouche autour de lui.
– Oui! reprend le bosseman, il y a un voleur ici, puisque ce qui nous restait a disparu!
– Ce n’est pas moi! – Ni moi!» répondent tour à tour les matelots.
Et je vois ces malheureux furetant dans tous les coins, soulevant les voiles, déplaçant les espars. Leur colère s’accroît à voir que ces recherches demeurent sans résultat.
Le bosseman vient à moi.
«Vous devez connaître le voleur? me dit-il.
– Je ne sais ce que vous voulez dire,» ai-je répondu.
Daoulas et quelques autres matelots s’approchent.
«Nous avons fouillé tout le radeau, dit Daoulas. Il n’y a plus que cette tente à visiter…
– Personne de nous n’a quitté cette tente, Daoulas.
– Il faut voir!
– Non! laissez en paix ceux qui meurent de faim!
– Monsieur Kazallon, me dit le bosseman en se contenant, nous ne vous accusons pas… Quand l’un de vous aurait pris sa part, dont il n’a pas voulu hier, c’était son droit. Mais tout a disparu, vous entendez bien, tout!
– Fouillons la tente!» s’écrie Sandon.
Les matelots s’avancent. Je ne puis résister à ces malheureux, que la colère aveugle. Une horrible crainte me saisit. Est-ce que M. Letourneur, non pour lui, mais pour son fils, aurait été jusqu’à prendre… S’il l’a fait, il va être déchiré par ces furieux!
Je regarde Robert Kurtis comme pour lui demander protection. Robert Kurtis vient se placer près de moi. Ses deux mains sont enfoncées dans ses poches, mais je devine qu’elles sont armées.
Cependant, sur l’injonction du bosseman, miss Herbey et MM. Letourneur ont dû quitter la tente, qui est fouillée jusque dans ses coins les plus secrets, – en vain, heureusement.
Il est évident que, puisque les restes d’Hobbart ont disparu, c’est qu’ils ont été jetés à la mer.
Le bosseman, le charpentier, les matelots sont en proie au plus effrayant désespoir.
Mais qui donc a fait cela? Je regarde miss Herbey, M. Letourneur. Leur regard répond que ce ne sont pas eux.
Mes yeux se portent sur André, qui détourne un instant la tête.
Le malheureux jeune homme! Est-ce lui? Et si c’est lui, comprend-il les conséquences de cet acte?
![]()
– Du 20 au 22 janvier. – Pendant les jours suivants, ceux qui ont pris part à l’horrible repas du 18 janvier ont peu souffert, ayant été nourris et désaltérés.
Mais miss Herbey, André Letourneur, son père, moi, est-il possible de décrire ce que nous éprouvons! N’en sommes-nous pas à regretter que ces débris aient disparu? Si l’un de nous meurt, résisterons-nous?…
Le bosseman, Daoulas et les autres ont été bientôt repris par la faim, et ils nous regardent avec des yeux égarés. Sommes-nous donc une proie assurée pour eux?
En vérité, ce qui nous fait le plus souffrir, ce n’est pas la faim, c’est la soif. Oui! entre quelques gouttes d’eau et quelques miettes de biscuit, il n’est pas un de nous qui hésitât! Cela a toujours été dit des naufragés qui se sont trouvés dans les circonstances où nous sommes, et cela est vrai. On souffre plus de la soif que de la faim, on en meurt plus vite aussi.
Et, supplice épouvantable, on a autour de soi cette eau de mer que l’œil voit si semblable à l’eau douce! Plusieurs fois, j’ai essayé d’en boire quelques gouttes, mais elle a provoqué en moi des nausées insurmontables et une soif plus ardente après qu’avant.
Ah! c’en est trop! Voilà quarante-deux jours que nous avons abandonné le navire! Qui de nous peut se faire illusion désormais? Ne sommes-nous pas destinés à mourir l’un après l’autre, et de la pire des morts?
Je sens qu’une sorte de brouillard s’épaissît autour de mon cerveau. C’est comme un délire qui va s’emparer de moi. Je lutte pour ressaisir mon intelligence qui s’en va. Ce délire m’épouvante! Où va-t-il me conduire? Serai-je assez fort pour reprendre ma raison?…
Je suis revenu à moi, – après combien d’heures, je ne saurais le dire. Mon front a été couvert de compresses, imbibées d’eau de mer, par les soins de miss Herbey, mais je sens que je n’ai plus que peu de temps à vivre!
Aujourd’hui, 22, scène affreuse. Le nègre Jynxtrop, subitement pris d’un accès de folie furieuse, parcourt le radeau en poussant des hurlements. Robert Kurtis veut le contenir, mais en vain! Il se jette sur nous pour nous dévorer! Il faut se défendre contre les attaques de cette bête féroce. Jynxtrop a saisi un anspect, et il est difficile de parer ses coups.
Mais soudain, par un revirement qu’une attaque de folie seule explique, sa rage se tourne contre lui-même. Il se déchire de ses dents, de ses ongles, nous jetant son sang à la figure et criant:
«Buvez! Buvez!»
Pendant quelques minutes, il se démène ainsi, et se dirige vers l’avant du radeau, criant toujours:
«Buvez! Buvez!»
Puis, il s’élance, et j’entends son corps tomber à la mer.
Le bosseman, Falsten, Daoulas se précipitent à l’avant du radeau pour reprendre ce corps, mais ils ne voient plus qu’un large cercle rouge, au milieu duquel se débattent des requins monstrueux!
![]()
– 22 et 23 janvier. – Nous ne sommes plus que onze à bord, et il me paraît impossible que chaque jour, maintenant, ne compte pas quelque nouvelle victime. La fin de ce drame, quelle qu’elle soit, approche. Avant huit jours, ou la terre aura été atteinte, ou un navire aura opéré le sauvetage des naufragés. Sinon, le dernier survivant du Chancellor aura vécu.
Le 23, l’aspect du ciel a changé. La brise a notablement fraîchi. Le vent, pendant la nuit, a halé le nord-est. La voile du radeau s’est gonflée, et un sillage assez prononcé indique qu’il se déplace sensiblement. Le capitaine évalue ce déplacement à trois milles à l’heure.
Robert Kurtis et l’ingénieur Falsten sont certainement les plus valides entre nous. Quoique leur maigreur soit extrême, ils supportent d’une façon surprenante ces privations. Je ne saurais peindre à quelle extrémité est réduite la pauvre miss Herbey. Ce n’est plus qu’une âme, mais une âme vaillante encore, et toute sa vie semble s’être réfugiée dans ses yeux, qui brillent extraordinairement. Elle vit dans le ciel, non sur la terre!
Un homme d’une grande énergie, cependant, maintenant complètement abattu, c’est le bosseman. Il est méconnaissable. Sa tête courbée sur sa poitrine, ses longues mains osseuses allongées sur ses genoux, dont les rotules aiguës saillissent sous son pantalon usé, il reste invariablement assis dans un angle du radeau, sans jamais relever les yeux. Bien différent de miss Herbey, lui ne vit plus que par le corps, et son immobilité est telle, que je suppose, parfois, qu’il a cessé de vivre.
Plus de paroles, plus de gémissements même, sur ce radeau. Silence absolu. Il ne s’échange pas dix paroles par jour. D’ailleurs, les quelques mots que notre langue, nos lèvres, tuméfiées et durcies, pourraient prononcer, seraient absolument inintelligibles. Le radeau ne porte plus que des spectres, hâves, exsangues, qui n’ont plus rien d’humain!
![]()
– 24 janvier. – Où sommes-nous? Vers quelle partie de l’Atlantique le radeau a-t-il été poussé? Deux fois j’ai interrogé Robert Kurtis, et il n’a pu me répondre que vaguement. Cependant, comme il a toujours noté la direction des courants et dès vents, il pense que nous avons dû être reportés dans l’ouest, c’est-à-dire du côté de la terre.
Aujourd’hui, la brise est complétement tombée. Cependant, il existe à la surface de la mer une large houle qui indique que quelque trouble des eaux s’est produit dans l’est. Une tempête aura, sans doute, bouleversé cette portion de l’Atlantique. Le radeau fatigue beaucoup. Robert Kurtis, Falsten, le charpentier usent ce qui leur reste de force à en consolider les parties qui menacent de se disjoindre.
Pourquoi se donner cette peine? Qu’elles se disjoignent donc enfin, ces planches. Que cet Océan nous engloutisse! C’est trop lui disputer notre misérable vie!
En vérité, nos tortures ont atteint le plus haut point que l’homme puisse supporter. Il est impossible qu’elles aillent au delà! La chaleur est intolérable. C’est du plomb fondu que le ciel verse sur nous. La sueur nous inonde à travers nos guenilles, et cette transpiration accroît encore notre soif. Non, je ne puis peindre ce que je ressens! Les mots manquent quand il s’agit d’exprimer des douleurs surhumaines!
Le seul mode de rafraîchissement que nous avons pu employer quelquefois nous est maintenant interdit. Aucun de nous ne peut songer à se baigner, car, depuis la mort de Jynxtrop, les requins, arrivant par troupes, entourent le radeau.
J’ai essayé aujourd’hui de me procurer un peu d’eau potable, en faisant évaporer de l’eau de mer; mais, malgré ma patience, c’est à peine si je parviens à rendre humide un morceau de linge. D’ailleurs, la bouilloire, qui est très-usée, n’a pu résister au feu; elle s’est fendue, et j’ai été forcé d’abandonner mon opération.
L’ingénieur Falsten est presque anéanti maintenant, et il ne nous survivra que de quelques jours. Quand je relève la tête, je ne le vois même plus. Est-il couché sous les voiles, ou est-il mort? Seul, l’énergique capitaine Kurtis est debout à l’avant et regarde! Quand je pense que cet homme… espère encore!
Moi, je vais m’étendre à l’arrière. Là, j’attendrai la mort. Le plus tôt sera le mieux.
Combien d’heures se sont écoulées, je l’ignore… Tout à coup, j’entends des éclats de rire. L’un de nous devient fou, sans doute!
Ces éclats de rire redoublent. Je ne relève pas la tête. Peu m’importe. Cependant, quelques paroles incohérentes arrivent jusqu’à moi.
«Une prairie, une prairie! Des arbres verts! Une taverne sous ces arbres! Vite! vite! du brandevin, du gin, de l’eau à une guinée la goutte! Je payerai! J’ai de l’or! j’ai de l’or!»
Pauvre halluciné! Tout l’or de la banque ne te donnerait pas une goutte d’eau en ce moment.
C’est le matelot Flaypol qui, pris de délire, s’écrie:
«La terre! la terre est là!»
Ce mot galvaniserait un mort! Je fais un effort douloureux, et je me redresse. Pas de terre! Flaypol se promène sur la plate-forme, il rit. Il chante, il fait des signaux vers une côte imaginaire! Certes, les perceptions directes de l’ouïe, de la vue, du goût lui manquent, mais un phénomène purement cérébral les supplée. Aussi parle-t-il à des amis absents. Il les entraîne à sa taverne de Cardiff, aux Armes de Georges. Là, il offre du gin, du wisky, de l’eau, – de l’eau surtout, de l’eau qui l’enivre! Le voilà marchant sur ces corps étendus, bronchant à chaque pas, tombant, se relevant, chantant d’une voix avinée. Il semble arrivé au dernier degré de l’ivresse. Sous l’empire de sa folie, il ne souffre plus, et sa soif est apaisée! Ah! je voudrais être halluciné comme lui!
Le malheureux va-t-il donc finir comme a fini le nègre Jynxtrop, et se précipiter dans les flots?
Il faut que Daoulas, Falsten, le bosseman l’aient pensé, car si Flaypol veut se tuer, ils ne le laisseront pas faire «sans profit pour eux!» Aussi, les voilà qui se relèvent, qui le suivent, qui l’épient! Si Flaypol veut se jeter à la mer, cette fois, ils le disputeront aux requins!
Il n’en devait pas être ainsi. Pendant son hallucination, Flaypol est arrivé réellement au dernier degré de l’ivresse, comme s’il se fût enivré des liqueurs qu’il offrait dans son délire, et, tombant comme une masse, il s’est endormi pesamment.
![]()
– 25 janvier. – La nuit du 24 au 25 janvier a été brumeuse, et, par suite de je ne sais quel phénomène, une des plus chaudes que l’on puisse imaginer. Ce brouillard est étouffant. C’est à croire qu’une étincelle suffirait à y mettre le feu, comme à quelque substance explosive. Le radeau est non-seulement stationnaire, mais il ne ressent plus aucun mouvement. Je me demande quelquefois s’il flotte encore.
Pendant cette nuit, j’essaye de compter combien nous sommes à bord. Il me semble que nous sommes encore onze, mais je puis à peine rassembler les idées nécessaires pour établir ce calcul. Tantôt je trouve dix, tantôt douze. Ce doit être onze, depuis que Jynxtrop a péri. Demain, ils ne seront plus que dix, je serai mort.
Je sens bien, en effet, que j’arrive au terme de mes souffrances, car toute ma vie repasse dans mon souvenir. Mon pays, mes amis, ma famille, il m’est donné de les revoir une dernière fois en rêve!
Vers le matin, je me suis éveillé, si toutefois on peut appeler sommeil cet assoupissement maladif dans lequel j’ai été plongé. Que Dieu me pardonne, mais je pense sérieusement à en finir! Cette idée s’incruste dans mon cerveau. J’éprouve une sorte de charme à me dire que ces misères se termineront quand je le voudrai.
Je fais connaître ma résolution à Robert Kurtis, et je lui parle avec une singulière tranquillité d’esprit. Le capitaine se contente de faire un signe affirmatif.
«Pour moi, dit-il ensuite, je ne me tuerai pas. Ce serait abandonner mon poste. Si la mort ne me prend pas avant mes compagnons, je resterai le dernier sur ce radeau!»
La brume persiste. Nous flottons au milieu d’une atmosphère grisâtre. On ne voit même plus la surface de l’eau. Le brouillard s’élève de l’Océan comme une nuée épaisse, mais on sent bien qu’au-dessus brille un soleil ardent, qui aura bientôt pompé toutes ces vapeurs.
Vers sept heures, je crois entendre des cris d’oiseaux au-dessus de ma tête. Robert Kurtis, toujours debout, écoute avidement ces cris. Ils se renouvellent par trois fois.
A la troisième fois, je m’approche, et j’entends le capitaine qui murmure d’une voix sourde:
«Des oiseaux!… Mais alors… la terre serait donc proche!…»
Robert Kurtis croit-il donc encore à la terre? Je n’y crois pas, moi! Il n’existe ni continents, ni îles. Le globe n’est plus qu’un sphéroïde liquide, comme il était dans la seconde période de sa formation!
Cependant, j’attends le lever de la brume avec une certaine impatience, – non que je compte apercevoir la terre, mais cette absurde pensée d’une espérance irréalisable m’obsède, et j’ai hâte de m’en débarrasser.
Vers onze heures seulement, le brouillard commence à se dissiper. Tandis que ses épaisses volutes roulent à la surface des flots, j’entrevois par des trouées supérieures l’azur du ciel. De vifs rayons percent la brume et nous piquent comme des flèches de métal rougies à blanc. Mais cette condensation des vapeurs s’opère dans les hautes couches, et je ne puis encore observer l’horizon.
Pendant une demi-heure, ces tourbillons nous enveloppent, et ils ne se dissipent pas sans peine, car le vent fait absolument défaut.
Robert Kurtis, appuyé sur le bord de la plate-forme, cherche à percer cet opaque rideau de brumes.
Enfin, le soleil, dans toute son ardeur, nettoie la surface de l’Océan, le brouillard recule, la clarté se fait dans un rayon plus étendu, l’horizon apparaît…
Il est, cet horizon, ce qu’il a toujours été depuis six semaines, – une ligne continue et circulaire, sur laquelle se confondent le ciel et l’eau!
Robert Kurtis, après avoir regardé autour de lui, ne prononce pas un seul mot. Ah! je le plains sincèrement, puisque, de nous tous, il est le seul qui n’ait pas le droit d’en finir quand il le voudra. Pour moi, je mourrai demain, et, si la mort ne me frappe pas, j’irai au-devant de la mort. Quant à mes compagnons, j’ignore s’ils sont encore vivants, mais il me semble que bien des jours se sont écoulés depuis que je ne les ai vus.
La nuit est arrivée. Je n’ai pu dormir un seul instant. Vers deux heures, la soif m’a causé des douleurs telles que je n’ai pu retenir mes cris. Quoi! avant de mourir, n’aurai-je pas cette suprême volupté d’éteindre le feu qui me brûle la poitrine?
Si! Je boirai mon propre sang à défaut du sang des autres! Cela ne me servira de rien, je le sais, mais, du moins, je tromperai mon mal!
A peine cette idée a-t-elle traversé mon esprit, qu’elle est mise à exécution. Je parviens à ouvrir mon couteau. Mon bras est à nu. D’un coup rapide, je tranche une veine. Le sang ne sort que goutte à goutte, et me voilà me désaltérant à cette source de ma vie! Ce sang repasse en moi, il apaise un instant mes tourments atroces; puis, il s’arrête, il n’a plus la force de couler!
Que demain est long à venir!
Avec le jour, un brouillard épais s’est encore amassé à l’horizon et a rétréci le cercle dont le radeau forme le centre. Ce brouillard est brûlant comme les buées qui s’échappent d’une chaudière.
C’est aujourd’hui mon dernier jour.
Avant de mourir, je serais content de serrer la main d’un ami. Robert Kurtis est là, près de moi. Je me traîne jusqu’à lui et je lui prends la main. Il me comprend, il sait que c’est un adieu, et il semble que, par une dernière pensée d’espoir, il veuille me retenir! C’est inutile.
J’aurais aussi voulu revoir MM. Letourneur, miss Herbey… Je n’ose pas! La jeune fille lirait ma résolution dans mes yeux! Elle me parlerait de Dieu, de l’autre vie qu’il faut attendre! Attendre, je n’en ai plus le courage… Dieu me pardonne!
Je reviens vers l’arrière du radeau, et, après de longs efforts, je parviens à me dresser debout près du mât. Une dernière fois, je parcours du regard cette mer impitoyable, cet horizon qui ne se déplace pas! Une terre m’apparaîtrait, une voile s’élèverait au-dessus des flots, que je me croirais le jouet d’une illusion… Mais la mer est déserte!
Il est dix heures du matin, C’est le moment d’en finir. Les tiraillements de la faim, les aiguillons de la soif me déchirent avec une nouvelle violence. L’instinct de la conservation s’éteint en moi. Dans quelques instants, j’aurai fini de souffrir!… Que Dieu me prenne en pitié!
En ce moment, une voix s’élève. Je reconnais la voix de Daoulas.
Le charpentier est près de Robert Kurtis.
«Capitaine, dit-il, nous allons tirer au sort.»
Au moment de me jeter à la mer, je m’arrête. Pourquoi? je ne saurais le dire, mais je reviens à l’arrière du radeau.
![]()
– 26 janvier. – La proposition a été faite. Tous l’ont entendue, et tous l’ont comprise. Depuis quelques jours, c’était devenu une idée fixe, que personne n’osait formuler.
On va tirer au sort.
Celui que le sort désignera, chacun en aura sa part.
Eh bien, soit! Si le sort me désigne, je ne me plaindrai pas.
Il me semble qu’une exception est proposée en faveur de miss Herbey, et que c’est André Letourneur qui l’a faite. Mais un murmure de colère court parmi les matelots. Nous sommes onze à bord, chacun de nous a donc dix chances pour lui, une contre, et l’exception proposée changerait cette proportion. Miss Herbey subira le sort commun.
Il est alors dix heures et demie du matin. Le bosseman, que la proposition de Daoulas a ranimé, insiste pour que le tirage soit fait immédiatement. Il a raison. D’ailleurs, nul de nous ne tient à la vie. Celui qui sera désigné ne devancera que de quelques jours seulement, de quelques heures peut-être, ses compagnons dans la mort. On le sait, on ne s’effraye pas de mourir. Mais ne plus souffrir de cette faim pendant un jour ou deux, ne plus ressentir cette soif, voilà ce qu’on veut, et voilà ce qui sera.
Je ne puis dire comment chacun de nos noms s’est trouvé au fond d’un chapeau. Ce ne peut être que Falsten qui les ait écrits sur une feuille détachée de son carnet.
Les onze noms sont là. Il est convenu, sans discussion, que le dernier nom sortant désignera la victime.
Qui procédera au tirage? Il y a une sorte d’hésitation.
«Moi!» répond l’un de nous.
Je me retourne, et je reconnais M. Letourneur.
Il est là, debout, livide, la main étendue, ses cheveux blancs tombant sur ses joues amaigries, effrayant par son calme.
Ah! malheureux père! Je te comprends! Je sais pourquoi tu veux appeler les noms! Ton dévouement paternel ira jusque-là!
«Quand vous voudrez!» dit le bosseman.
M. Letourneur plonge la main dans le chapeau. Il prend un billet, il le déplie, il prononce à haute voix le nom qui est écrit sur le billet, et il le passe à celui que ce nom désigne.
Le premier nom sorti, c’est celui de Burke, qui pousse un cri de joie.
Le second, celui de Flaypol.
Le troisième, celui du bosseman.
Le quatrième, celui de Falsten.
Le cinquième, celui de Robert Kurtis.
Le sixième, celui de Sandon.
La moitié des noms, plus un, ont été appelés.
Le mien n’est pas sorti. Je cherche à calculer les chances qui me restent: quatre bonnes, une mauvaise.
Depuis que Burke a poussé son cri, pas un mot n’a été proféré.
M. Letourneur continue son sinistre office.
Le septième nom, c’est celui de miss Herbey, mais la jeune fille n’a pas tressailli.
Le huitième nom, c’est le mien. Oui! le mien!
Le neuvième nom:
«Letourneur!
– Lequel? demande le bosseman.
– André!» répond M. Letourneur.
Un cri se fait entendre, et André tombe sans connaissance.
«Mais va donc!» s’écrie en rugissant le charpentier Daoulas, dont le nom reste seul dans le chapeau avec celui de M. Letourneur.
Daoulas regarde son rival comme une victime qu’il veut dévorer. M. Letourneur, lui, est presque souriant. Il met sa main dans le chapeau, il tire l’avant-dernier billet, il le déplie lentement, et sans que sa voix faiblisse, avec une fermeté que je n’aurais jamais attendue de cet homme, il prononce ce nom: «Daoulas!»
Le charpentier est sauvé. Un hurlement s’échappe de sa poitrine.
Puis, M. Letourneur prend le dernier billet, et, sans rouvrir, il le déchire.
Mais un morceau du papier déchiré a volé vers un coin du radeau. Personne n’y fait attention. Je rampe de ce côté, je ramasse ce papier, et, sur un coin, je lis: And…
M. Letourneur se précipite vers moi, il m’arrache violemment des mains ce bout de papier, il le tord dans ses doigts, puis, me regardant d’un air grave, il le jette à la mer.
![]()
– Suite du 26 janvier. – J’avais bien compris. Le père s’est dévoué pour le fils, et, n’ayant plus que sa vie à lui donner, il la lui donne.
Cependant, tous ces affamés ne veulent plus attendre. Les tiraillements de leurs entrailles redoublent en présence de cette victime qui leur est dévolue. M. Letourneur n’est plus un homme pour eux. Ils n’ont encore rien dit, mais leurs lèvres s’avancent en pointe, leurs dents qui se découvrent, prêtes au rapt violent, déchireront comme des dents de carnassiers, avec la voracité brutale des bêtes. Veut-on donc qu’ils se jettent sur leur victime et qu’ils la dévorent vivante?
Qui croira que, en ce moment, un appel est fait au reste d’humanité que ces hommes peuvent avoir encore en eux, et qui croira, surtout, que cet appel a été entendu? Oui! une parole les a arrêtés à l’instant où ils allaient se jeter sur M. Letourneur. Le bosseman prêt à jouer le rôle de boucher, Daoulas la hache à la main, sont demeurés immobiles.
Miss Herbey s’avance ou plutôt se traîne vers eux.
«Mes amis, dit-elle, voulez-vous attendre un jour encore? Rien qu’un jour! Si demain la terre n’est pas là, si aucun navire ne nous a rencontrés, notre pauvre compagnon deviendra votre proie?..»
A ces mots, mon cœur tressaille. Il me semble que cette jeune fille a parlé avec un accent prophétique, et que c’est une inspiration d’en haut qui anime cette noble créature! Un immense espoir me revient au cœur. La côte, le bâtiment, miss Herbey les a peut-être entrevus dans une de ces visions surnaturelles que Dieu fait passer devant certains regards! Oui! il faut attendre un jour encore! Qu’est-ce qu’un jour, après tout ce que nous avons souffert?
Robert Kurtis pense comme moi. Nous joignons nos prières à celles de miss Herbey. Falsten parle dans le même sens. Nous supplions nos compagnons, le bosseman, Daoulas, les autres…
Les matelots s’arrêtent et ne font pas entendre un seul murmure.
Le bosseman jette alors sa hache; puis, d’une voix sourde:
«A demain, au lever du jour!» dit-il.
Ce mot dit tout. Si, demain, ni terre ni navire ne sont en vue, l’horrible sacrifice s’accomplira.
Chacun, maintenant, retourne à sa place et par un reste d’effort comprime ses douleurs. Les matelots se cachent sous les voiles. Ils ne cherchent même plus à observer la mer. Peu leur importe! Demain, ils mangeront.
Cependant, André Letourneur est revenu à lui, et son premier regard a été pour son père. Puis, je vois qu’il compte les passagers du radeau… Pas un ne manque. Sur qui le sort est-il tombé? Quand André a perdu connaissance, il n’y avait plus que deux noms dans le chapeau, celui du charpentier et celui de son père! Et M. Letourneur et Daoulas sont tous deux là!
Miss Herbey s’approche alors et lui dit simplement que l’opération du tirage au sort n’a pas été achevée.
André Letourneur n’en demande pas davantage. Il prend la main de son père. La figure de M. Letourneur est calme, presque souriante. Il ne voit, il ne comprend qu’une chose, son fils épargné. Ces deux êtres, si étroitement liés l’un à l’autre, vont s’asseoir à l’arrière du radeau, et ils causent ensemble, à voix basse.
Cependant, je ne suis pas revenu sur la première impression que m’a causée l’intervention de la jeune fille. Je crois à un secours providentiel. Je ne saurais dire jusqu’à quel point cette idée s’enracine dans mon esprit. J’oserais affirmer que nous touchons au terme de nos misères, et le navire ou la terre seraient là, à quelques milles sous le vent, que je n’en serais pas plus certain! Que l’on ne s’étonne pas de cette tendance. Mon cerveau est tellement vide, que les chimères s’y changent en réalités.
Je parle de mes pressentiments à MM. Letourneur. André est confiant comme moi. Le pauvre enfant! S’il savait que demain!…
Le père m’écoute gravement et m’encourage à espérer. Il croit volontiers – il le dit du moins – que le ciel épargnera les survivants du Chancellor, et il prodigue à son fils des caresses qui, pour lui, sont les dernières.
Puis, plus tard, quand je suis seul près de lui, M. Letourneur se penche à mon oreille:
«Je vous recommande mon malheureux enfant, dit-il. Qu’il ne sache jamais que…»
Il n’achève pas sa phrase, et de grosses larmes tombent de ses yeux!
Moi, je suis tout espoir.
Aussi, sans me détourner un instant, je regarde l’horizon, et je le parcours sur tout son périmètre. Il est désert, mais je ne suis pas inquiet. Avant demain, une voile ou une terre seront signalées.
Comme moi, Robert Kurtis observe la mer. Miss Herbey, Falsten, le bosseman lui-même concentrent toute leur vie dans leur regard.
Cependant, la nuit se fait, mais j’ai la conviction que quelque navire s’approchera, dans cette obscurité profonde, et qu’il verra nos signaux au lever du jour.
![]()
– 27 janvier. – Je ne ferme pas l’œil. J’écoute les moindres bruits, les clapotements de l’eau, le murmure des lames. Une remarque que je fais, c’est qu’il n’y a plus un seul requin autour du radeau. Je vois là un heureux présage.
La lune s’est levée à minuit quarante-six minutes, montrant son demi-disque de quadrature, mais son insuffisante lumière ne me permet pas d’observer la mer dans un rayon étendu. Que de fois j’ai cru entrevoir à quelques encâblures cette voile si désirée!
Mais le matin vient… Le soleil se lève sur une mer déserte!
Le moment terrible approche. Alors, je sens toutes mes espérances de la veille s’effacer peu à peu. Le navire n’apparaît pas. La terre non plus. Je rentre dans la réalité, et je me souviens! C’est l’heure où va s’accomplir une abominable exécution!
Je n’ose plus regarder la victime, et, lorsque ses yeux, si résignés, se fixent sur moi, je baisse les miens.
Une insurmontable horreur me comprime la poitrine. La tête me tourne comme dans l’ivresse.
Il est six heures du matin. Je ne crois plus à un secours providentiel. Mon cœur bat plus de cent pulsations à la minute, et une sueur d’angoisse m’enveloppe tout entier.
Le bosseman et Robert Kurtis, debout, appuyés au mât, ne cessent d’examiner l’Océan. Le bosseman, lui, est effrayant à voir. On sent bien qu’il ne devancera pas l’heure, mais aussi qu’il ne la retardera pas. Il m’est impossible de deviner quelles sont les impressions du capitaine. Sa face est livide, il semble ne plus vivre que par le regard.
Quant aux matelots, ils se traînent sur la plate-forme, et, de leurs yeux ardents, ils dévorent déjà leur victime!
Je ne puis tenir en place, et je me glisse jusqu’à l’avant du radeau.
Le bosseman est toujours debout, regardant.
«Enfin!» s’écrie-t-il.
Ce mot me fait bondir.
Le bosseman, Daoulas, Flaypol, Burke, Sandon s’avancent vers l’arrière. Le charpentier serre convulsivement sa hache!
Miss Herbey ne peut retenir un cri.
Soudain, André se redresse.
«Mon père? s’écrie-t-il d’une voix étranglée.
– Le sort m’a désigné…» répond M Letourneur.
André saisit son père et l’entoure de ses bras.
«Jamais! crie-t-il avec un rugissement. Vous me tuerez plutôt! Tuez-moi! C’est moi qui ai jeté à la mer le cadavre d’Hobbart! C’est moi, moi, qu’il faut égorger!»
Le malheureux!
Ses paroles redoublent la rage des bourreaux. Daoulas, allant à lui, l’arrache des bras de M. Letourneur, en disant:
«Pas tant de façons!»
André tombe à la renverse, et deux matelots l’étreignent de manière qu’il ne puisse plus faire un mouvement.
En même temps, Burke et Flaypol, saisissant leur victime, l’entraînent vers l’avant du radeau.
Cette scène épouvantable se passe plus rapidement que je ne la décris. L’horreur m’a cloué sur place! Je voudrais me jeter entre M. Letourneur et ses bourreaux, et je ne le puis!
En ce moment, M. Letourneur est debout. Il a repoussé les matelots qui lui ont arraché une partie de ses vêtements. Ses épaules sont nues.
«Un instant, dit-il d’un ton dans lequel je sens une indomptable énergie, un instant! Je n’ai pas l’intention de vous voler votre ration! Mais vous n’allez pas me dévorer tout entier aujourd’hui, je suppose!»
Les matelots s’arrêtent, ils regardent, ils écoutent, stupéfaits.
M. Letourneur continue:
«Vous êtes dix! Est-ce que mes deux bras ne vous suffiront pas? Coupez-les, et demain vous aurez le reste!…»
M. Letourneur étend ses deux bras nus…
«Oui!» crie d’une voix terrible le charpentier Daoulas.
Et, rapide comme la foudre, il lève sa hache…
Robert Kurtis n’a pu en voir davantage. Moi non plus. Ce massacre ne s’accomplira pas, nous vivants. Le capitaine s’est jeté au milieu des matelots, pour leur arracher leur victime. Je me suis précipité dans la mêlée… mais arrivé à l’avant du radeau, j’ai été repoussé violemment par un des matelots, et je suis tombé à la mer…
Je ferme ma bouche, je veux mourir étouffé!… La suffocation est plus forte que ma volonté. Mes lèvres s’ouvrent! Quelques gorgées d’eau pénètrent!…
Dieu éternel! Cette eau est douce!
![]()
– Suite du 27 janvier. – J’ai bu, j’ai bu! Je renais! Soudain la vie est rentrée en moi! Je ne veux plus mourir!
Je crie. Mes cris sont entendus. Robert Kurtis apparaît au-dessus du bord, me jette une corde, que ma main saisit. Je me hisse et je retombe sur la plate-forme.
Mes premiers mots sont ceux-ci.
«L’eau douce!
– L’eau douce! crie Robert Kurtis. La terre est là!»
Il est temps encore! Le meurtre n’est pas commis! La victime n’a pas été frappée! Robert Kurtis et André avaient lutté contre ces cannibales, et c’est au moment où ils allaient succomber eux-mêmes, que ma voix s’est fait entendre!
La lutte engagée s’arrête. Ces mots: l’eau douce! je les répète, et, me penchant hors du radeau, je bois avidement, à larges gorgées!
Miss Herbey, la première, suit mon exemple. Robert Kurtis, Falsten, les autres se précipitent vers cette source de vie. Chacun en fait autant. Les bêtes féroces de tout à l’heure lèvent les bras au ciel. Quelques matelots se signent en criant au miracle. Chacun s’agenouille au bord du radeau et boit avec ravissement. L’extase a succédé aux fureurs!
André et son père sont les derniers à nous imiter.
«Mais où sommes-nous? me suis-je écrié.
– A moins de vingt milles de terre!» répond Robert Kurtis.
On le regarde. Le capitaine est-il fou? Il n’y a pas une côte en vue, et le radeau occupe toujours le centre de ce cercle liquide!
Et, cependant, l’eau est douce! Depuis quand l’est-elle? N’importe! Nos sens ne nous ont pas trompés, et notre soif est apaisée.
«Oui, la terre est invisible, mais elle est là! dit le capitaine, en étendant sa main vers l’ouest.
– Quelle terre? demande le bosseman.
– La terre d’Amérique, la terre où coule l’Amazone, le seul fleuve qui ait un courant assez fort pour dessaler l’Océan jusqu’à vingt milles de son embouchure!»
![]()
– Suite du 27 janvier. – Robert Kurtis a évidemment raison. Cette embouchure de l’Amazone, dont le débit est de deux cent quarante mille mètres cubes à l’heure,1 c’est le seul endroit de l’Atlantique où nous ayons pu trouver de l’eau douce. La terre est là! Nous le sentons! Le vent nous y porte!»
En ce moment, la voix de miss Herbey s’élève vers le ciel, et nous mêlons nos prières aux siennes.
André Letourneur est dans les bras de son père, à l’arrière du radeau, tandis qu’à l’avant, tous, nous regardons l’horizon de l’ouest…
Une heure après, Robert Kurtis crie: «Terre!»
Le journal où j’ai consigné ces notes quotidiennes est fini. Notre sauvetage s’est opéré en quelques heures, et je le raconterai en quelques mots.
Le radeau, vers onze heures du matin, a été rencontré à la pointe Magouri sur l’île Marajo. De charitables pêcheurs nous ont recueillis et réconfortés; puis, ils nous ont conduits au Para, où nous avons été l’objet des soins les plus touchants.
Le radeau a atterri par 0° 12’ de latitude nord. Il a donc été rejeté d’au moins quinze degrés dans le sud-ouest depuis le jour où nous avons abandonné le navire. Je dis «au moins», car il est évident que nous avons dû descendre plus au sud. Si nous sommes arrivés à l’embouchure de l’Amazone, c’est que le courant du Gulf-stream a repris le radeau et l’y a porté. Sans cette circonstance, nous étions perdus.
De trente-deux embarqués à Charleston, soit neuf passagers et vingt-trois marins, il ne reste que cinq passagers et six marins, – en tout, onze.
Ce sont les seuls survivants du Chancellor.
Procès-verbal de sauvetage a été dressé par les autorités brésiliennes.
Ont signé: Miss Herbey, J.-R. Kazallon, Letourneur père, André Letourneur, Falsten, le bosseman, Daoulas, Burke, Flaypol, Sandon, et, – en dernier, – Robert Kurtis, capitaine.
Je dois ajouter que, au Para, des moyens de nous rapatrier nous ont été offerts presque aussitôt. Un navire nous a conduits à Cayenne, et nous allons rejoindre la ligne transatlantique française d’Aspinwal, dont le steamer Ville-de-Saint-Nazaire nous reconduira en Europe.
Et maintenant, après tant d’épreuves subies ensemble, après tant de dangers auxquels nous avons échappé par miracle, pour ainsi dire, n’est-il pas naturel qu’une indestructible amitié lie entre eux les passagers du Chancellor? En quelque circonstance que ce soit, si loin que le sort les entraîne, n’est-il pas certain qu’ils ne s’oublieront jamais? Robert Kurtis est et restera toujours l’ami de ceux qui furent ses compagnons d’infortune.
Miss Herbey, elle, voulait se retirer du monde et consacrer sa vie aux soins de ceux qui souffrent.
«Mais mon fils n’est-il pas un malade!…» lui a dit M. Letourneur.
Miss Herbey a maintenant un père dans M. Letourneur, un frère dans son fils André. – Je dis un frère, mais avant peu, dans sa nouvelle famille, cette vaillante jeune fille aura trouvé le bonheur qu’elle mérite, et que nous lui souhaitons do tout cœur!
FIN
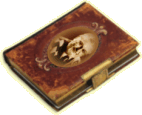
1 C’est 3,000 fois le débit de la Seine.