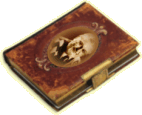Jules Verne
Edom
Illustrations: Damian Christ
© Andrzej
Zydorczak
I
![]() e zartog Sofr-Aï-Sr – c’est-à-dire le docteur, troisième
représentant mâle de la cent-unième génération de la lignée des Sofr –
suivait à pas lents la principale rue de Basidra, capitale du
Hars-Iten-Schu, – autrement dit l’Empire-des-Quatre-Mers. Quatre mers, en
effet: la Tubélone ou septentrionale, la Ehone ou australe, la Spone ou
orientale, et la Mérone ou occidentale, limitaient cette vaste contrée,
de forme très irrégulière, dont les pointes extrêmes – en comptant
d’après les mesures connues du lecteur – atteignaient, en longitude, le
quatrième degré Est et le soixante-deuxième degré Ouest, et, en latitude,
le cinquante-quatrième degré Nord et le cinquante-cinquième degré Sud.
Quant à l’étendue respective de ces mers, comment l’évaluer, fût-ce d’une
manière approximative, puisqu’elles se rejoignaient toutes, et qu’un
navigateur, parti de l’un quelconque de leurs rivages et voguant toujours
devant lui, fût nécessairement arrivé au rivage diamétralement opposé?
Car, sur toute la surface du globe, il n’existait pas d’autre terre que
celle du Hars-Iten-Schu.
e zartog Sofr-Aï-Sr – c’est-à-dire le docteur, troisième
représentant mâle de la cent-unième génération de la lignée des Sofr –
suivait à pas lents la principale rue de Basidra, capitale du
Hars-Iten-Schu, – autrement dit l’Empire-des-Quatre-Mers. Quatre mers, en
effet: la Tubélone ou septentrionale, la Ehone ou australe, la Spone ou
orientale, et la Mérone ou occidentale, limitaient cette vaste contrée,
de forme très irrégulière, dont les pointes extrêmes – en comptant
d’après les mesures connues du lecteur – atteignaient, en longitude, le
quatrième degré Est et le soixante-deuxième degré Ouest, et, en latitude,
le cinquante-quatrième degré Nord et le cinquante-cinquième degré Sud.
Quant à l’étendue respective de ces mers, comment l’évaluer, fût-ce d’une
manière approximative, puisqu’elles se rejoignaient toutes, et qu’un
navigateur, parti de l’un quelconque de leurs rivages et voguant toujours
devant lui, fût nécessairement arrivé au rivage diamétralement opposé?
Car, sur toute la surface du globe, il n’existait pas d’autre terre que
celle du Hars-Iten-Schu.
Sofr marchait à pas lents, d’abord parce qu’il faisait très chaud. On entrait dans la saison brûlante, et, sur Basidra, située au bord de la Spone-Schu, ou mer orientale, à moins de vingt degrés au Nord de l’Équateur, une terrible cataracte de rayons tombait du soleil, proche alors du zénith.
Mais, plus que la lassitude et la chaleur, le poids de ses pensées ralentissait les pas de Sofr, le savant zartog. Tout en s’épongeant le front d’une main distraite, il se remémorait la séance qui venait de prendre fin, où tant d’orateurs éloquents, parmi lesquels il s’honorait d’être compté, avaient magnifiquement célébré le cent-quatre-vingt-quinzième anniversaire de la fondation de l’Empire.
Les uns en avaient retracé l’histoire, c’est-à-dire celle même de l’humanité tout entière. Ils avaient montré la Mahart-Iten-Schu, la Terre-des-Quatre-Mers, divisée, à l’origine, entre un nombre immense de peuplades sauvages qui s’ignoraient les unes les autres. C’est à ces peuplades que remontaient les plus antiques traditions. Quant aux faits antérieurs, nul ne les connaissait, et c’est à peine si les sciences naturelles commençaient à discerner une faible lueur dans les ténèbres impénétrables du passé. En tout cas, ces temps reculés échappaient à la critique historique, dont les vagues notions relatives aux anciennes peuplades éparses formaient les premiers rudiments.
Pendant plus de huit mille ans, l’histoire, par degrés plus complète et plus exacte, de la Mahart-Iten-Schu ne relatait que combats et guerres, d’abord d’individu à individu, puis de famille à famille, enfin de tribu à tribu, chaque être vivant, chaque collectivité, petite ou grande, n’ayant dans le cours des âges, d’autre objectif que d’assurer sa suprématie sur ses compétiteurs, et s’efforçant, avec des fortunes diverses et souvent opposées, de les asservir à ses lois.
En deçà de ces huit mille ans, les souvenirs des hommes se précisaient un peu. La légende commençait à mériter plus justement le nom d’histoire au début de la deuxième des quatre périodes en lesquelles on divisait communément les annales de la Mahart-Iten-Schu. D’ailleurs, histoire ou légende, la matière des récits ne changeait guère. C’étaient toujours des massacres et des tueries, non plus, il est vrai, de tribu à tribu, mais de peuple à peuple désormais, si bien que cette deuxième période n’était pas, à tout prendre, fort différente de la première.
Et il en était de même de la troisième, close il y avait deux cents ans à peine, après avoir duré près de trois fois autant. Plus atroce encore peut-être, cette troisième époque, pendant laquelle, groupés en armées innombrables, les hommes avaient, avec une rage insatiable, abreuvé la terre de leur sang.
Un peu moins de huit siècles avant le jour où le zartog Sofr suivait la principale rue de Basidra, l’humanité s’était trouvée mûre, en effet, pour les convulsions de vaste envergure. A ce moment, les armes, le feu, la violence ayant déjà accompli une partie de leur œuvre nécessaire, les faibles ayant succombé devant les forts, les hommes peuplant la Mahart-Iten-Schu formaient trois nations homogènes, dans chacune desquelles le temps avait atténué les différences entre les vainqueurs et les vaincus d’autrefois. C’est alors que l’une de ces nations avait entrepris de soumettre ses voisines. Situés vers le centre de la Mahart-Iten-Schu, les Andarti-ha-Sammgor, ou Hommes-à-Face-de-Bronze, luttèrent sans merci pour agrandir leurs frontières, dans lesquelles étouffait leur race ardente et prolifique. Les uns après les autres, au prix de guerres séculaires, ils vainquirent les Andarti-Mahart-Horis, les Hommes-du-Pays-de-la-Neige, qui habitaient les contrées du Sud, et les Andarti-Mitra-Psul, les Hommes-de-l’Etoile-Immobile, dont l’empire était situé vers le Nord et vers l’Ouest.
Près de deux cents ans s’étaient écoulés depuis que l’ultime révolte de ces deux derniers peuples avait été noyée dans des torrents de sang, et la terre avait enfin connue une ère de paix. C’était la quatrième période de l’histoire. Un seul Empire remplaçant les trois nations de jadis, tous obéissant à la loi de Basidra, l’unité politique tendait à fondre les races. Nul ne parlait plus des Hommes-à-Face-de-Bronze, des Hommes-du-Pays-de-la-Neige, des Hommes-de-l’Etoile-Immobile, et la terre ne contenait plus qu’un peuple unique, les Andarti-Iten-Schu, les Hommes-des-Quatre-Mers, qui résumait tous les autres en lui.
Mais voilà qu’après ces deux cents années de paix une cinquième période semblait en voie de gestation. Des bruits fâcheux, venus on ne savait d’où, circulaient depuis quelque temps. Il s’était révélé des penseurs pour réveiller dans les âmes des souvenirs ancestraux qu’on eût pu croire abolis. L’ancien sentiment de la race ressuscitait, sous une forme nouvelle caractérisée par des mots nouveaux. On parlait couramment d’«atavisme», d’«affinités», de «nationalités», etc., tous vocables de création récente, qui, répondant à un besoin, avaient aussitôt conquis droit de cité. Suivant les communautés d’origine, d’aspect physique, de tendances morales, d’intérêts ou simplement de région et de climat, des groupements se formaient qu’on voyait grandir peu à peu et qui commençaient à s’agiter. Comment cette évolution naissante tournerait-elle? L’Empire allait-il se désagréger à peine formé? La Mahart-Iten-Schu allait-elle être divisée, comme jadis, entre un grand nombre de nations, ou du moins, pour en maintenir l’unité, faudrait-il avoir encore recours aux effroyables hécatombes qui, durant tant de millénaires, avaient fait de la terre un charnier?…
Sofr, d’un mouvement de tête, rejeta ces pensées. L’avenir, ni lui ni personne ne le connaissait. Pourquoi donc s’attrister à l’avance d’événements incertains? En tout cas, ce n’était pas le jour d’agiter ces sinistres hypothèses. Aujourd’hui, tout était à la joie, et on ne devait songer qu’à la grandeur auguste de Mogar-Si, douzième empereur du Hars-Iten-Schu, dont le sceptre menait l’univers vers de glorieuses destinées.
Au surplus, pour un zartog, les sujets de se réjouir ne manquaient pas. Outre l’historien qui avait retracé les fastes de la Mahart-Iten-Schu, une pléiade de savants, à l’occasion du grandiose anniversaire, avaient établi, chacun dans sa spécialité, le bilan du savoir humain et précisé le point où son effort séculaire avait amené l’humanité. Or, si le premier avait suggéré, dans une certaine mesure, de tristes réflexions, en racontant par quelle route lente et tortueuse elle s’était évadée de sa bestialité originelle, les autres avaient donné un aliment au légitime orgueil de leur auditoire.
Oui, en vérité, la comparaison entre ce qu’était l’homme, arrivant nu et désarmé sur la terre, et ce qu’il était aujourd’hui, incitait à l’admiration. Pendant des siècles, malgré ses discordes et ses haines fratricides, pas un instant il n’avait cessé sa lutte contre la nature, augmentant de jour en jour l’ampleur de sa victoire. Lente tout d’abord, sa marche triomphale s’était étonnamment accélérée depuis deux cents ans, la stabilité des institutions politiques et la paix universelle qui en était résultée ayant provoqué un merveilleux essor de la science. L’humanité avait vécu par le cerveau et non plus seulement par les membres, elle avait réfléchi au lieu de s’épuiser en guerres insensées, et c’est pourquoi, au cours des deux derniers siècles, elle avait marché d’un pas toujours plus rapide vers la connaissance et vers la domestication de la matière.
A grands traits, Sofr, tout en suivant sous le brûlant soleil la longue rue de Basidra, esquissait dans son esprit le tableau des conquêtes de l’homme.
Celui-ci avait d’abord – cela se perdait dans la nuit des temps – imaginé l’écriture, afin de fixer la pensée, puis – l’invention remontait à plus de cinq cents ans – il avait trouvé le moyen de répandre la parole écrite en un nombre infini d’exemplaires, à l’aide d’un moule disposé une fois pour toutes. C’est de cette invention que découlaient en réalité toutes les autres. C’est grâce à elle que les cerveaux s’étaient mis en branle, que l’intelligence de chacun s’était accrue de celle du voisin, et que les découvertes, dans l’ordre théorique et pratique, s’étaient prodigieusement multipliées. A présent, on ne les comptait plus.
L’homme avait pénétré dans les entrailles de la terre et il en extrayait la houille, généreuse dispensatrice de chaleur; il avait libéré la force latente de l’eau, et la vapeur traînait désormais sur des rubans de fer des convois pesants ou actionnait d’innombrables machines puissantes, délicates et précises; grâce à ces machines, il tissait les fibres végétales et pouvait travailler à son gré les métaux, le marbre et la roche. Dans un domaine moins concret ou tout au moins d’une utilisation moins directe et moins immédiate, il pénétrait graduellement le mystère des nombres et explorait sans cesse plus avant l’infini des vérités mathématiques. Par elles, sa pensée avait parcouru le ciel. Il savait que le soleil n’était qu’une étoile gravitant dans l’espace selon des lois rigoureuses, en entraînant les sept planètes de son cortège dans son orbe enflammé. Il connaissait l’art, soit de combiner certains corps bruts de manière à en former de nouveaux n’ayant plus rien de commun avec les premiers, soit de diviser certains autres corps en leurs éléments constitutifs et primordiaux. Il soumettait à l’analyse le son, la chaleur, la lumière, et commençait à en déterminer la nature et les lois. Cinquante ans plus tôt, il avait appris à produire cette force dont le tonnerre et les éclairs sont les terrifiantes manifestations, et aussitôt il en avait fait son esclave; déjà cet agent mystérieux transmettait à d’incalculables distances la pensée écrite; demain il transmettrait le son; après-demain, sans doute, la lumière… Oui, l’homme était grand, plus grand que l’univers immense, auquel il commanderait en maître, un jour prochain.
Alors, pour que l’on possédât la vérité intégrale, ce dernier problème resterait à résoudre: cet homme, maître du monde, qui était-il? D’où venait-il? Vers quelles fins inconnues tendait son inlassable effort?
C’est précisément ce vaste sujet que le zartog Sofr venait de traiter au cours de la cérémonie dont il sortait. Certes, il n’avait fait que l’effleurer, car un tel problème était actuellement insoluble et le demeurerait sans doute longtemps encore. Quelques vagues lueurs commençaient pourtant à éclairer le mystère. Et, de ces lueurs, n’était-ce pas le zartog Sofr qui avait projeté les plus puissantes, lorsque, codifiant, systématisant les patientes observations de ses prédécesseurs et ses remarques personnelles, il avait abouti à sa loi de l’évolution de la matière vivante, loi universellement admise maintenant et qui ne rencontrait plus un seul contradicteur?
Cette théorie reposait sur une triple base.
Sur la science géologique, tout d’abord, qui, née du jour où l’on avait fouillé les entrailles du sol, s’était perfectionnée simultanément au développement des exploitations minières. L’écorce du globe était si parfaitement connue que l’on osait fixer son âge à quatre cent mille ans, et à vingt mille ans celui de la Mahart-Iten-Schu telle qu’elle existait aujourd’hui. Auparavant, ce continent dormait sous les eaux de la mer, ainsi qu’en témoignait l’épaisse couche de limon marin recouvrant, sans aucune interruption, les couches rocheuses sous-jacentes. Par quel mécanisme avait-il jailli hors des flots? Sans doute par suite d’une contraction du globe refroidi. Quoiqu’il en fût à cet égard, l’émersion de la Mahart-Iten-Schu devait être considérée comme certaine.
Les sciences naturelles avaient fourni à Sofr les deux autres bases de son système, en démontrant l’étroite parenté des plantes entre elles, des animaux entre eux. Sofr était allé plus loin. Il avait prouvé jusqu’à l’évidence que presque tous les végétaux existants se reliaient à une plante marine leur ancêtre, et que presque tous les animaux terrestres ou aériens dérivaient d’animaux marins. Par une lente mais incessante évolution, ceux-ci s’étaient adaptés peu à peu à des conditions de vie, d’abord voisines, ensuite plus lointaines, de celles de leur vie primitive, et, de stade en stade, ils avaient donné naissance à la plupart des formes vivantes qui peuplaient la terre et le ciel.
Malheureusement, cette théorie ingénieuse n’était pas inattaquable. Que les êtres vivants de l’ordre animal ou végétal procédassent d’ancêtres marins, cela paraissait incontestable pour presque tous, mais non pour tous. Il existait, en effet, quelques plantes et quelques animaux qu’il semblait impossible de rattacher à des formes aquatiques. Là était un des deux points faibles du système.
L’homme – Sofr ne se le dissimulait pas – était l’autre point faible. Entre l’homme et les animaux, aucun rapprochement n’était possible. Certes, les fonctions et les propriétés primordiales, telles que la respiration, la nutrition, la motilité étaient les mêmes et s’accomplissaient ou se révélaient sensiblement de pareille manière, mais un abîme infranchissable subsistait entre les formes extérieures, le nombre et la disposition des organes. Si, par une chaîne dont peu de maillons manquaient, on pouvait rattacher la grande majorité des animaux à des ancêtres issus de la mer, une pareille filiation était inadmissible en ce qui concernait l’homme. Pour conserver intacte la théorie de l’évolution, on était donc dans la nécessité d’imaginer gratuitement l’hypothèse d’une souche commune aux habitants des eaux et à l’homme, souche dont rien, absolument rien, ne démontrait l’existence antérieure.
Un moment, Sofr avait espéré trouver dans le sol des arguments dans le sens de ses préférences. A son instigation et sous sa direction, des fouilles avaient été faites pendant une longue suite d’années, mais pour aboutir à des résultats diamétralement opposés à ceux qu’en attendait leur promoteur.
Après avoir traversé une mince pellicule d’humus formée par la décomposition des plantes et d’animaux semblables ou analogues à ceux qu’on voyait tous les jours, on était arrivé à l’épaisse couche de limon, dans laquelle les vestiges du passé avaient changé de nature. Dans ce limon, plus aucune trace de la flore et de la faune existantes, mais un amas colossal de fossiles exclusivement marins et dont les congénères vivaient encore le plus souvent dans les océans ceinturant la Mahart-Iten-Schu.
Qu’en conclure, sinon que les géologues avaient raison en professant que le continent avait jadis servi de fond à ces mêmes océans, et que Sofr non plus n’avait pas tort en affirmant l’origine marine de la faune et de la flore contemporaines? Puisque, sauf des exceptions si rares qu’on était en droit de les considérer comme des monstruosités, les formes aquatiques et les formes terrestres étaient les seules dont on relevât la trace, celles-ci avaient été nécessairement engendrées par celles-là.
Malheureusement pour la généralisation du système, on fit encore d’autres trouvailles. Epars dans toute l’épaisseur de l’humus et jusque dans la partie la plus superficielle du dépôt de limon, d’innombrables ossements humains furent ramenés au jour. Rien d’exceptionnel dans la structure de ces fractions de squelettes, et Sofr dut renoncer à leur demander les organismes intermédiaires dont l’existence eût affirmé sa théorie. Ces ossements étaient des ossements d’homme, ni plus, ni moins.
Toutefois, une particularité assez remarquable ne tarda pas à être constatée. Jusqu’à une certaine antiquité, qui pouvait être grossièrement évaluée à deux ou trois mille ans, plus l’ossuaire était ancien, plus les crânes découverts étaient de petite taille. Par contre, au-delà de ce stade, la progression se renversait, et, dès lors, plus on reculait dans le passé, plus augmentait la capacité de ces crânes et, par suite, la grandeur des cerveaux qu’ils avaient contenus. Le maximum dans cet ordre d’idée fut précisément rencontré parmi les débris, d’ailleurs fort rares, trouvés à la superficie de la couche de limon. L’examen consciencieux de ces restes vénérables ne permit pas de mettre en doute que les hommes vivant à cette époque reculée n’eussent dès lors acquis un développement cérébral de beaucoup supérieur à celui de leurs successeurs, jusque et y compris les contemporains du zartog Sofr eux-mêmes. Il y avait donc eu, pendant cent-soixante ou cent-soixante-dix siècles, régression certaine, suivie d’une nouvelle ascension.
Sofr, troublé par ces faits étranges, poussa ses recherches plus avant. La couche de limon fut traversée de part en part, sur une épaisseur telle que, selon les avis les plus modérés, le dépôt n’en avait pas exigé moins de quinze à vingt mille ans. Au-delà, on eut la surprise de trouver de faibles restes d’une ancienne couche d’humus, puis, au-dessous de cet humus, ce fut la roche, de nature variable selon le siège des recherches. Mais, ce qui porta l’étonnement à son comble, ce fut de ramener quelques débris d’origine incontestablement humaine de ces profondeurs mystérieuses. C’étaient des parcelles d’ossements ayant appartenu à des hommes, et aussi des fragments d’armes ou de machines, des morceaux de poterie, des lambeaux d’inscriptions en langage inconnu, des pierres dures finement travaillées, parfois sculptées en forme de statues presque intactes, des chapiteaux délicatement ouvragés, etc., etc. De l’ensemble de ces trouvailles, on fut logiquement amené à penser que quarante mille ans plus tôt, c’est-à-dire vingt mille avant le moment où avaient surgi, on ne savait d’où ni comment, les premiers représentants de la race contemporaine, des hommes avaient déjà vécu dans ces mêmes lieux et y étaient parvenus à un degré de civilisation fort avancée.
Telle fut, en effet, la conclusion généralement admise. Toutefois, il y eut au moins un dissident.
Ce dissident n’était autre que Sofr. Admettre que d’autres hommes, séparés de leurs successeurs par un abîme de vingt mille ans, eussent une première fois peuplé la terre, c’était, à son estime, pure folie. D’où seraient venus, dans ce cas, ces descendants d’ancêtres depuis si longtemps disparus et auxquels nul lien ne les rattachait? Plutôt que d’accueillir une hypothèse aussi absurde, mieux valait rester dans l’expectative. De ce que ces faits singuliers ne fussent pas expliqués, il ne fallait pas conclure qu’ils fussent inexplicables. On les interprèterait un jour. Jusque-là, il convenait de n’en tenir aucun compte et de rester attaché à ces principes, qui satisfont pleinement la raison pure:
La vie planétaire se divise en deux phases: avant l’homme, depuis l’homme. Dans la première, la terre, en état de perpétuelles transformations, est pour cette raison, inhabitable et inhabitée. Dans la seconde, l’écorce du globe est arrivée à un degré de cohésion permettant la stabilité. Aussitôt, ayant enfin un substratum solide, la vie apparaît. Elle débute par les formes les plus simples, et va en se compliquant de siècle en siècle, pour aboutir finalement à l’homme, sa dernière et sa plus parfaite expression. L’homme, à peine apparu sur la terre, commence aussitôt et poursuit sans arrêt son ascension. D’une marche lente mais sûre, il s’achemine vers sa fin, qui est la connaissance parfaite et la domination absolue de l’Univers.
Emporté par la chaleur de ses convictions, Sofr avait dépassé sa maison. Il fit volte-face en maugréant.
«Eh quoi! se disait-il, admettre que l’homme – il y aurait quarante mille ans! – soit parvenu à une civilisation comparable, sinon supérieure à celle dont on jouit actuellement, et que ses connaissances, ses acquisitions aient disparu sans laisser la moindre trace, au point de contraindre ses descendants à recommencer l’œuvre par la base, comme s’ils étaient les pionniers d’un monde inhabité avant eux? Mais ce serait nier l’avenir, proclamer que notre effort est vain et que tout progrès est aussi fragile qu’une bulle d’écume à la surface des flots!»
Sofr fit halte devant sa maison.
«Upsa ni!… hartchok!» – Non, non! en vérité! – «Andart mir’hoë spha!» – L’homme est le maître des choses! murmura-t-il en poussant la porte.
***
Quand le zartog se fut reposé quelques instants, il déjeuna de bon appétit, puis s’étendit en vue de faire sa sieste quotidienne. Mais les questions qu’il avait agitées en regagnant son domicile continuaient à l’obséder et chassaient le sommeil.
Quel que fût son désir d’établir la parfaite unité des méthodes de la nature, il avait trop d’esprit critique pour méconnaître la faiblesse de son système dès qu’on abordait le problème de l’origine et de la formation de l’homme. Contraindre les faits à cadrer avec une hypothèse préalable, c’est une manière d’avoir raison contre les autres, ce n’en est pas une d’avoir raison contre soi-même.
Si, au lieu d’être un savant, un très éminent zartog, Sofr avait fait partie de la classe des illettrés, il eût été moins embarrassé. Le peuple, en effet, sans perdre son temps à de profondes spéculations, se contentait d’accepter les yeux fermés la vieille légende que, de temps immémorial, on se transmettait de père en fils. Expliquant le mystère par un autre mystère, elle faisait remonter l’origine de l’homme à l’intervention d’une volonté supérieure. Un jour, cette puissance extraterrestre avait créé de rien Edom et Hiva, le premier homme et la première femme, dont les descendants avaient peuplé la terre. Ainsi tout s’enchaînait très simplement.
Trop simplement, songeait Sofr. Quand on désespère de comprendre quelque chose, il est vraiment trop facile de faire intervenir la divinité. De cette façon, il devient inutile de chercher la solution des énigmes de l’univers, les problèmes étant supprimés aussitôt que posés.
Si encore la légende populaire avait eu, ne fût-ce que l’apparence d’une base sérieuse!… Mais elle ne reposait sur rien. Ce n’était qu’une tradition, née aux époques d’ignorance, et transmise ensuite d’âge en âge. Jusqu’à ce nom: Edom!… D’où venait ce vocable bizarre, à la consonnance étrangère, qui ne semblait pas appartenir à la langue des Andarti-Iten-Schu? Rien que sur cette petite difficulté philologique, une infinité de savants avaient pâli, sans trouver de réponse satisfaisante… Allons! billevesées que tout cela, indignes de retenir l’attention d’un zartog.
Sofr, énervé, descendit dans son jardin. C’était l’heure, au surplus, où il avait coutume de le faire. Le soleil déclinant versait sur la terre une chaleur moins brûlante, et une brise tiède commençait à souffler de la Spone-Schu. Le zartog erra par les allées, à l’ombre des arbres, dont les feuilles frissonnantes murmuraient au vent du large, et, peu à peu, ses nerfs retrouvèrent leur équilibre habituel. Il put chasser ses absorbantes pensées, jouir paisiblement du plein air, s’intéresser aux fruits, richesse des jardins, aux fleurs, leur parure.
Le hasard de la promenade l’ayant ramené du côté de sa maison, il s’arrêta au bord d’une profonde excavation, dans laquelle gisaient de nombreux outils. Là seraient bâties à bref délai les fondations d’une construction neuve qui doublerait la surface de son laboratoire. Mais, en ce jour de fête, les ouvriers avaient abandonné leur travail pour se livrer au plaisir.
Sofr estimait machinalement l’ouvrage déjà fait et l’ouvrage restant à faire, quand, dans la pénombre de l’excavation, un point brillant attira son attention. Intrigué, il descendit au fond du trou et dégagea l’objet brillant de la terre qui le recouvrait aux trois quarts.
Remonté au jour, le zartog examina sa trouvaille. C’était une sorte d’étui, fait d’un métal inconnu, de couleur grise, de texture granuleuse, et dont un long séjour dans le sol avait atténué l’éclat. Au tiers de sa longueur, une fente indiquait que l’étui était formé de deux parties s’emboîtant l’une dans l’autre. Sofr essaya de l’ouvrir.
A sa première tentative, le métal, désagrégé par le temps, se réduisit en poussière, découvrant un second objet qui y était inclus.
La substance de cet objet était aussi nouvelle pour le zartog que le métal qui l’avait protégé jusqu’alors. C’était un rouleau fait de feuillets superposés et couverts de signes étranges, dont la régularité montrait qu’ils étaient des caractères d’écriture, mais d’une écriture inconnue, et telle que Sofr n’en avait jamais vu de semblable, ni même d’analogue.
Le zartog, tout tremblant d’émotion, courut s’enfermer dans son laboratoire, et, ayant étalé avec soin le précieux document, il l’examina longuement.
Oui, c’était bien de l’écriture, rien de plus certain. Mais il ne l’était pas moins que cette écriture ne ressemblait en rien à aucune de celles que, depuis l’origine des temps historiques, on avait pratiquées sur toute la surface de la terre.
D’où venait ce document? Que signifiait-il? Telles furent les deux questions qui se posèrent d’elles-mêmes à l’esprit de Sofr.
Pour répondre à la première il fallait nécessairement être en état de répondre à la seconde. Il s’agissait donc, tout d’abord de lire, de traduire ensuite, car on pouvait affirmer a priori que la langue du document serait aussi ignorée que son écriture.
Cela était-il impossible? Le zartog Sofr ne le pensa pas, et, sans plus tarder, il se mit fiévreusement au travail.
Ce travail dura longtemps, longtemps, des années entières. Sofr ne se lassa point. Sans se décourager, il poursuivit l’étude méthodique du mystérieux document, avançant pas à pas vers la lumière. Un jour vint enfin où il posséda la clef de l’indéchiffrable rébus, un jour vint où, avec beaucoup d’hésitation et beaucoup de peine encore, il put le traduire dans la langue des Hommes-des-Quatre-Mers.
Or, quand ce jour arriva, le zartog Sofr-Aï-Sr lut ce qui suit:
![]()
II
Rosario, le 24 mai 2…
Je date de cette façon le début de mon récit, bien qu’en réalité il ait été rédigé à une autre date beaucoup plus récente et en des lieux bien différents. Mais, en pareille matière, l’ordre est, à mon sens, impérieusement nécessaire, et c’est pourquoi j’adopte la forme d’un «journal» écrit au jour le jour.
C’est donc le 24 mai que commence le récit des effroyables événements que j’entends ici relater pour l’enseignement de ceux qui viendront après moi, si toutefois l’humanité est encore en droit de compter sur un avenir quelconque.
En quelle langue écrirai-je? En anglais ou en espagnol que je parle couramment? Non, j’écrirai dans la langue de mon pays: en français.
Ce jour-là, le 24 mai, j’avais réuni quelques amis dans ma villa de Rosario.
Rosario est, ou plutôt était, une ville du Mexique située sur le rivage du Pacifique, un peu au sud du golfe de Californie. Une dizaine d’années auparavant, je m’y étais installé pour diriger l’exploitation d’une mine d’argent qui m’appartenait en propre. Mes affaires avaient étonnamment prospéré. J’étais un homme riche, très riche même, – ce mot-là me fait bien rire aujourd’hui! – et je projetais de rentrer à bref délai en France, ma patrie d’origine.
Ma villa, des plus luxueuses, était située au point culminant d’un vaste jardin qui descendait en pente vers la mer et finissait brusquement en une falaise à pic de plus de cent mètres de hauteur. En arrière de ma villa, le terrain continuait à monter, et, par des routes en lacets, on pouvait atteindre la crête de montagnes dont l’altitude dépassait quinze cents mètres. Souvent, ce qui constituait une agréable promenade, j’en avais fait l’ascension dans mon automobile, un superbe et puissant double phaéton de trente-cinq chevaux, de l’une des meilleures marques françaises.
J’étais installé à Rosario avec mon fils, Jean, un beau garçon de vingt ans, quand, à la mort de parents, éloignés par le sang mais près de mon cœur, je recueillis leur fille, Hélène, restée orpheline et sans fortune. Depuis cette époque, cinq ans s’étaient écoulés. Mon fils Jean avait vingt-cinq ans; ma pupille Hélène, vingt ans. Dans le secret de mon cœur, je les destinais l’un à l’autre.
Notre service était assuré par un valet de chambre, Germain; par Modeste Simonat, un chauffeur des plus débrouillards, et par deux femmes, Edith et Mary, filles de mon jardinier, Georges Raleigh, et de sa femme, Anna.
Ce jour-là, 24 mai, nous étions huit assis autour de ma table, à la lumière des lampes électriques qu’alimentaient des groupes électrogènes installés dans le jardin. Il y avait, outre le maître de céans, son fils et sa pupille, cinq autres convives, dont trois appartenaient à la race anglo-saxonne et deux à la race mexicaine.
Le docteur Bathurst figurait parmi les premiers, et le docteur Moreno parmi les seconds. C’étaient deux savants, dans la plus large acception du mot, ce qui ne les empêchait pas d’être rarement d’accord. Au demeurant, de braves gens et les meilleurs amis du monde.
Les deux autres Anglo-Saxons avaient nom Williamson, propriétaire d’une importante pêcherie de Rosario, et Rowling, un audacieux qui avait fondé aux environs de la ville un établissement de primeurs, où il était en train de récolter une sérieuse fortune.
Quant au dernier convive, c’était le senor Mendoza, président du tribunal de Rosario, homme estimable, esprit cultivé, juge intègre.
Nous arrivâmes sans incident notable à la fin du repas. Les paroles qu’on avait prononcées jusque là, je les ai oubliées. Par contre, il n’en est pas ainsi de ce qui fut dit au moment des cigares.
Non pas que ces propos aient par eux-mêmes une importance particulière, mais le commentaire brutal qui devait bientôt en être fait ne laisse pas de leur donner quelque saveur, et c’est pourquoi ils ne sont jamais sortis de mon esprit.
On en était venu – par quel chemin, peu importe – à parler des progrès merveilleux réalisés par l’homme. Le docteur Bathurst dit à un certain moment:
«Il est de fait que si Adam (naturellement, en sa qualité d’Anglo-Saxon, il prononçait Edèm) et Eve (il prononçait Iva, bien entendu) revenaient sur la terre, ils seraient joliment étonnés!»
Ce fut l’origine de la discussion. Fervent darwiniste, partisan convaincu de la sélection naturelle, Moreno demanda d’un ton ironique à Bathurst si celui-ci croyait sérieusement à ta légende du Paradis terrestre. Bathurst répondit qu’il croyait du moins en Dieu, et que, l’existence d’Adam et d’Eve étant affirmée par la Bible, il s’interdisait de la discuter. Moreno répliqua qu’il croyait en Dieu au moins autant que son contradicteur, mais que le premier homme et la première femme pouvaient fort bien n’être que des mythes, des symboles, et qu’il n’y avait rien d’impie par conséquent à supposer que la Bible eût voulu figurer ainsi le souffle de vie répandu par la puissance créatrice dans la première cellule, de laquelle toutes les autres avaient ensuite procédé. Bathurst riposta que l’explication était spécieuse, et que, en ce qui le concernait, il estimait plus flatteur d’être l’œuvre directe de la divinité que d’en descendre par l’intermédiaire de primates plus ou moins simiesques.
Je vis le moment où la discussion allait s’échauffer, quand elle cessa tout à coup, les deux adversaires ayant par hasard trouvé un terrain d’entente. C’est ainsi, d’ailleurs, que les choses finissaient d’ordinaire.
Cette fois, revenant à leur premier thème, les deux antagonistes s’accordaient à admirer, quelle que fût l’origine de l’humanité, la haute culture où elle était parvenue et énuméraient ses conquêtes avec orgueil. Toutes y passèrent. Bathurst vanta la chimie, poussée à un tel degré de perfection qu’elle tendait à disparaître pour se confondre avec la physique, les deux sciences n’en formant plus qu’une, ayant pour objet l’étude de l’immanente énergie. Moreno fit l’éloge de la médecine et de la chirurgie, grâce auxquelles on avait pénétré l’intime nature du phénomène de la vie et dont les prodigieuses découvertes permettaient d’espérer, dans un avenir prochain, l’immortalité des organismes animés. Après quoi, tous deux se congratulèrent des hauteurs atteintes par l’astronomie. Ne conversait-on pas maintenant, en attendant les étoiles, avec sept des planètes du système solaire?
Fatigués par leur enthousiasme, les deux apologistes prirent un petit temps de repos. Les autres convives en profitèrent pour placer un mot à leur tour, et l’on entra dans le vaste champ des inventions pratiques qui avaient si profondément modifié la condition de l’humanité. On parla des chemins de fer et des steamers affectés au transport des marchandises lourdes et encombrantes, des aéronefs économiques utilisés par les voyageurs à qui le temps ne manque pas, des tubes pneumatiques ou électro-ioniques sillonnant tous les continents et toutes les mers, adoptés par les gens pressés. On parla des innombrables machines plus ingénieuses les unes que les autres, dont une seule, dans certaines industries, exécute le travail de cent hommes. On parla de l’imprimerie, de la photographie des couleurs et de la lumière, de celle du son, de la chaleur et de toutes les vibrations de l’éther. On parla surtout de l’électricité, cet agent si souple, si docile et si parfaitement connu dans ses propriétés et dans son essence, qui permet, sans le moindre connecteur matériel, soit d’actionner un mécanisme quelconque, soit de diriger un vaisseau marin, sous-marin ou aérien, soit de s’écrire, de se parler ou de se voir, et cela quelque grande que soit la distance.
Bref, ce fut un vrai dithyrambe, dans lequel je fis ma partie, je l’avoue. On s’accorda sur ce point, que l’humanité avait atteint un niveau intellectuel inconnu avant notre époque et qui autorisait à croire à sa victoire définitive sur la nature.
«Cependant, dit de sa petite voix flûtée le président Mendoza, profitant de l’instant de silence qui suivit cette conclusion finale, je me suis laissé dire que des peuples, aujourd’hui disparus sans laisser la moindre trace, étaient déjà parvenus à une civilisation égale ou analogue à la nôtre.
– Lesquels? interrogea la table tout d’une voix.
– Eh mais!… les Babyloniens, par exemple.
Ce fut une explosion d’hilarité. Oser comparer les Babyloniens aux hommes modernes!
– Les Egyptiens, continuait don Mendoza sans s’émouvoir.
On rit plus fort autour de lui.
– Il y a aussi les Atlantes, que notre ignorance seule rend légendaires, poursuivit le Président. Sans compter qu’une infinité d’autres humanités, antérieures aux Atlantes eux-mêmes, ont pu naître, prospérer et s’éteindre sans que nous en ayons aucune connaissance.
Don Mendoza persistant dans son paradoxe, on consentit, afin de ne pas le froisser, à faire semblant de le prendre au sérieux.
– Voyons, mon cher Président, insinua Moreno, du ton qu’on prend pour faire entendre raison à un enfant, vous ne voulez pas prétendre, j’imagine, qu’aucun de ces anciens peuples puisse être comparé à nous? Dans l’ordre moral, j’admets qu’ils se soient élevés à un égal degré de culture, mais dans l’ordre matériel!…
– Pourquoi pas? objecta don Mendoza.
– Parce que, expliqua Bathurst, le propre de nos inventions est qu’elles se répandent instantanément par toute la terre. La disparition d’un seul peuple, ou même d’un grand nombre de peuples, laisserait donc intacte la somme de progrès réalisés. Pour que l’effort humain fût perdu, il faudrait que toute l’humanité disparût à la fois. Est-ce là, je vous le demande, une hypothèse admissible?»
Pendant que nous causions ainsi, les effets et les causes continuaient à s’engendrer réciproquement dans l’infini de l’univers, et, moins d’une minute après la question que venait de poser le docteur Bathurst, leur résultante totale n’allait que trop justifier le scepticisme de Mendoza. Mais nous n’en avions aucune conscience, et nous discourions paisiblement, les uns renversés sur le dossier de leur siège, les autres accoudés sur la table, tous faisant converger des regards compatissants sur Mendoza que nous supposions accablé par la réplique de Bathurst.
«D’abord, répondit le Président sans s’émouvoir, il est à croire que la terre avait jadis moins d’habitants qu’elle n’en a aujourd’hui, de telle sorte qu’un peuple pouvait fort bien posséder à lui seul le savoir universel. Ensuite, je ne vois rien d’absurde, a priori, à admettre que toute la surface du globe soit bouleversée en même temps.
– Allons donc!» nous écriâmes-nous à l’unisson.
Ce fut à cet instant précis que survint le cataclysme.
Nous prononcions encore tous ensemble cet «allons donc», qu’un vacarme effroyable s’éleva. Le sol trembla et manqua sous nos pieds, la villa oscilla sur sa base.
Nous heurtant, nous bousculant, en proie à une terreur indicible, nous nous précipitâmes au dehors.
A peine avions-nous franchi le seuil, que la maison s’écroulait d’un seul bloc, ensevelissant sous ses décombres le Président Mendoza et mon valet de chambre Germain, qui venaient les derniers. Après quelques secondes d’un affolement bien naturel, nous nous disposions à leur porter secours, quand nous aperçûmes Raleigh, mon jardinier, accourir, suivi de sa femme, du bas du jardin où il habitait.
«La mer!… la mer!…» criait-il à pleins poumons.
Je me retournai du côté de l’océan et demeurai sans mouvement, frappé de stupeur. Ce n’est pas que je me rendisse nettement compte de ce que je voyais, mais j’eus sur-le-champ la claire notion que la perspective coutumière était changée. Or, cela ne suffisait-il pas à glacer le cœur d’épouvante que l’aspect de la nature, de cette nature que nous considérons comme immuable par essence, eût été si étrangement modifié en quelques secondes?
Toutefois, je ne tardai pas à reprendre mon sang-froid. La véritable supériorité de l’homme, ce n’est pas de dominer, de vaincre la nature; c’est, pour le penseur, de la comprendre, de faire tenir l’univers immense dans le microcosme de son cerveau; c’est, pour l’homme d’action, de garder une âme sereine devant la révolte de la matière, c’est de lui dire: «Me détruire, soit! m’émouvoir, jamais!»
Dès que j’eus reconquis mon calme, je compris en quoi le tableau que j’avais sous les yeux différait de celui que j’étais accoutumé de contempler. La falaise avait disparu, tout simplement, et mon jardin s’était abaissé au niveau de la mer, dont les vagues, après avoir anéanti la maison du jardinier, battaient furieusement mes plates-bandes les plus basses.
Comme il était peu admissible que le niveau de l’eau eût monté, il fallait nécessairement que celui de la terre se lût abaissé. La descente dépassait cent mètres, puisque la falaise avait précédemment cette hauteur, mais elle avait dû se faire avec une certaine douceur, car nous ne nous en étions guère aperçus, ce qui expliquait le calme relatif de l’océan.
Un bref examen me convainquit que mon hypothèse était juste et me permit, en outre, de constater que la descente n’avait pas cessé. La mer continuait à gagner, en effet, avec une vitesse qui me parut voisine de deux mètres à la seconde, soit sept ou huit kilomètres à l’heure. Étant donnée la distance qui nous séparait des premières vagues, nous allions par conséquent être engloutis en moins de trois minutes, si la vitesse de chute demeurait uniforme.
Ma décision fut rapide.
«A l’auto!» m’écriai-je.
On me comprit. Nous nous précipitâmes tous vers la remise, et l’auto fut traînée au dehors. En un clin d’œil, on fit le plein d’essence, puis nous nous entassâmes au petit bonheur. Mon chauffeur Simonat actionna le moteur, sauta au volant, embraya, et s’élança sur la route en quatrième vitesse, tandis que Raleigh, ayant ouvert la grille, agrippait l’auto au passage et se cramponnait aux ressorts d’arrière.
Il était temps. Au moment où l’auto atteignait la route, une lame vint, en déferlant, mouiller les roues jusqu’au moyeu. Mais désormais nous pouvions nous rire de la poursuite de la mer. En dépit de sa charge excessive, ma bonne machine saurait nous emporter hors de ses atteintes, et à moins que la descente vers l’abîme ne dût indéfiniment continuer… En somme, nous avions du champ devant nous: deux heures au moins de montée et une altitude disponible de près de quinze cents mètres.
Pourtant, je ne tardai pas à reconnaître qu’il ne convenait pas encore de crier victoire. Après que le premier bond de la voiture nous eut portés à une vingtaine de mètres de la frange d’écume, c’est en vain que Simonat ouvrit les gaz en grand, cette distance ne s’accrut pas. Sans doute, le poids des douze personnes qu’elle portait ralentissait l’allure de la voiture. Quoi qu’il en soit, cette allure était précisément égale à celle de l’eau envahissante, qui restait invariablement à la même distance.
Cette effroyable situation fut bientôt connue, et tous, sauf Simonat, appliqué à diriger sa voiture, nous nous retournâmes vers le chemin que nous laissions en arrière. On n’y voyait plus rien que de l’eau. A mesure que nous l’avions conquise, la route disparaissait sous la mer qui la conquérait à son tour. Celle-ci s’était calmée. A peine si quelques rides venaient doucement mourir sur une grève toujours nouvelle. C’était un lac paisible qui gonflait, gonflait toujours, d’un mouvement uniforme, et rien n’était tragique comme la poursuite de cette eau calme. En vain nous fuyions devant elle, l’eau montait, implacable, avec nous.
Simonat, qui tenait les yeux fixés sur la route, dit, à un tournant:
«Nous voici à moitié de la pente. Encore une heure de montée.»
Nous frissonnâmes. Eh quoi! dans une heure, nous allions atteindre le sommet, et il nous faudrait redescendre, chassés, rejoints alors, quelle que fût notre vitesse, par les masses liquides qui se précipiteraient en avalanche a notre suite!…
L’heure s’écoula sans que rien fût changé dans notre situation. Déjà, nous distinguions le point culminant de la côte, quand la voiture éprouva une violente secousse et fit une embardée qui manqua la fracasser sur le talus de la route. En même temps, une vague énorme se gonfla derrière nous, courut à l’assaut de la route, se creusa, et déferla finalement sur l’auto qui fut entourée d’écume. Allions-nous être engloutis?…
Non, l’eau se retira en bouillonnant, tandis que le moteur, précipitant tout à coup ses halètements, augmentait notre allure.
D’où provenait ce subit accroissement de vitesse? Un cri d’Anna Raleigh nous le fit comprendre. Ainsi que la pauvre femme venait de le constater, son mari n’était plus cramponné aux ressorts. Sans doute, le remous avait arraché le malheureux, et c’est pourquoi la voiture délestée gravissait plus allègrement la pente.
Soudain, elle s’arrêta sur place.
«Qu’y a-t-il? demandai-je à Simonat. Une panne?»
Même dans ces circonstances tragiques, l’orgueil professionnel ne perdit pas ses droits. Simonat haussa les épaules avec dédain, entendant par là me faire comprendre que la panne était inconnue d’un chauffeur de sa sorte, et, de la main, montra silencieusement la route. L’arrêt me fut alors expliqué.
La route était coupée à moins de dix mètres en avant de nous. Coupée est le mot juste: on l’eût dite tranchée au couteau. Au-delà d’une arête vive qui la terminait brusquement, c’était le vide, un abîme de ténèbres, au fond duquel il était impossible de rien distinguer.
Nous nous retournâmes, éperdus, certains que notre dernière heure était venue. L’océan, qui nous avait poursuivis jusque sur ces hauteurs, allait nécessairement nous atteindre en quelques secondes…
Tous, sauf la malheureuse Anna et ses filles, qui sanglotaient à fendre l’âme, nous poussâmes un cri de joyeuse surprise. Non, l’eau n’avait pas continué son mouvement ascensionnel, ou, plus exactement, la terre avait cessé de s’enfoncer. Sans doute, la secousse que nous venions de ressentir avait été l’ultime manifestation du phénomène. L’océan s’était arrêté, et son niveau restait en contre-bas de près de cent mètres du point sur lequel nous étions groupés autour de l’auto encore trépidante, pareille à un animal essouflé par une course rapide.
Réussirons-nous à nous tirer de ce mauvais pas? Nous ne le saurions qu’au jour. Jusque-là, il fallait attendre. L’un après l’autre, nous nous étendîmes donc sur le sol, et je crois, Dieu me pardonne, que je m’endormis!
***
Dans la nuit.
Je suis réveillé en sursaut par un bruit formidable. Quelle heure est-il? Je l’ignore. En tout cas, nous sommes toujours noyés dans les ténèbres de la nuit.
Le bruit sort de l’abîme impénétrable, dans lequel la route s’est effondrée. Que se passe-t-il?… On jurerait que des masses d’eau y tombent avec violence… Oui, c’est bien cela, car des volutes d’écume arrivent jusqu’à nous, et nous sommes couverts par les embruns.
Puis le calme renaît peu à peu… Tout rentre dans le silence… Le ciel pâlit… C’est le jour.
***
25 mai.
Quel supplice que la lente révélation de notre situation véritable! D’abord, nous ne distinguons que nos environs immédiats, mais le cercle grandit, grandit sans cesse, comme si notre espoir toujours déçu eût soulevé l’un après l’autre un nombre infini de voiles légers; et c’est enfin la pleine lumière, qui détruit nos dernières illusions.
Notre situation est des plus simples et peut se résumer en quelques mots. Nous sommes sur une île. La mer nous entoure de toutes parts. Hier encore, nous eussions aperçu tout un océan de sommets, dont plusieurs dominaient celui sur lequel nous nous trouvons. Ces sommets ont disparu, tandis que, pour des raisons qui resteront à jamais inconnues, le nôtre, plus humble cependant, s’est arrêté dans sa chute tranquille. A leur place, s’étend une nappe d’eau sans limite. De tous côtés, rien que la mer. Nous occupons le seul point solide du cercle immense décrit par l’horizon.
Il nous suffit d’un coup d’œil pour connaître dans toute son étendue l’îlot où une chance extraordinaire nous a fait trouver asile. Il est de petite taille, en effet: mille mètres au plus en longueur, et cinq cents dans l’autre dimension. Vers le Nord, l’Ouest et le Sud, son sommet, élevé d’environ cent mètres au-dessus des flots, les rejoint par une pente assez douce. A l’Est, au contraire, l’îlot se termine en une falaise qui tombe à pic dans l’océan.
C’est de ce côté surtout que se portent nos regards. Dans cette direction, nous devrions voir des montagnes étagées, et, au-delà, le Mexique tout entier. Quel changement dans l’espace d’une courte nuit de printemps! Les montagnes ont disparu, le Mexique a été englouti! A leur place, c’est un désert infini, le désert aride de la mer!
Nous nous regardons épouvantés. Parqués, sans vivres, sans eau, sur ce roc étroit et dénudé, nous ne pouvons conserver le moindre espoir. Farouches, nous nous étendons sur le sol, et nous commençons à attendre la mort.
***
A bord de la Virginia, 4 juin.
Que s’est-il passé pendant les jours suivants? Je n’en ai pas gardé le souvenir. Il est à supposer que je perdis finalement connaissance, puisque je ne reprends conscience qu’à bord du navire qui nous a recueillis. Alors seulement, j’apprends que nous sommes restés dix jours entiers sur l’îlot et que deux d’entre nous, Williamson et Rowling, y sont morts de soif et de faim. Des quinze êtres vivants qu’abritait ma villa au moment du cataclysme, il n’en subsiste que neuf: mon fils Jean et ma pupille Hélène, mon chauffeur Simonat, inconsolable de la perte de sa machine, Anna Raleigh et ses deux filles, les docteurs Bathurst et Moreno, et moi enfin, moi, qui me hâte de rédiger ces lignes pour l’édification des races futures, en admettant qu’il en doive naître.
La Virginia, qui nous porte, est un bâtiment mixte, à vapeur et à voiles, de deux mille tonneaux environ, consacré au transport des marchandises. C’est un assez vieux navire, médiocre marcheur. Le capitaine Moris a vingt hommes sous ses ordres. Le capitaine et l’équipage sont anglais.
La Virginia a quitté Melbourne sur lest, il y a un peu plus d’un mois, à destination de Rosario. Aucun incident n’a marqué son voyage, sauf dans la nuit du 24 au 25 mai, une série de lames de fond d’une hauteur prodigieuse, mais d’une longueur proportionnée, ce qui les a rendues inoffensives. Quelques singulières qu’elles fussent, ces lames ne pouvaient faire prévoir au capitaine le cataclysme qui s’accomplissait au même instant. Aussi a-t-il été très surpris en ne voyant que la mer à l’endroit où il comptait rencontrer Rosario et le littoral mexicain. De ce littoral, il ne subsistait plus qu’un îlot. Un canot de la Virginia aborda cet îlot, sur lequel onze corps inanimés furent découverts. Deux n’étaient plus que des cadavres. On embarqua les neuf autres. C’est ainsi que nous fûmes sauvés.
***
A terre. Janvier ou février.
Un intervalle de huit mois sépare les dernières lignes qui précèdent des premières qui vont suivre. Je date celles-ci de janvier ou février, dans l’impossibilité où je suis d’être plus précis, car je n’ai plus une exacte notion du temps.
Ces huit mois constituent la période la plus atroce de nos épreuves, celle où, par degrés cruellement ménagés, nous avons connu toute l’étendue de notre malheur.
Après nous avoir recueillis, la Virginia continua sa route vers l’Est à toute vapeur. Quand je revins à moi, l’îlot où nous avions failli mourir était depuis longtemps sous l’horizon. Comme l’indiqua le point que le capitaine prit par un ciel sans nuages, nous naviguions alors juste à l’endroit où aurait dû être Mexico. Mais, de Mexico, il ne subsistait aucune trace, pas plus qu’on n’en avait trouvé, pendant mon évanouissement, des montagnes du centre, pas plus qu’on n’en distinguait maintenant d’une terre quelconque, si loin que portât la vue. De tous côtés, ce n’était que l’infini de la mer.
Il y avait, dans cette constatation, quelque chose de véritablement affolant. Nous sentions la raison près de nous échapper. Eh quoi! le Mexique entier englouti!… Nous échangions des regards épouvantés, en nous demandant jusqu’où s’étaient étendus les ravages de l’effroyable cataclysme…
Le capitaine voulut en avoir le cœur net. Modifiant sa route, il mit le cap au Nord. Si le Mexique n’existait plus, il n’était pas admissible qu’il en fût de même de tout le continent américain.
Il en était cependant ainsi. Nous remontâmes vainement au Nord pendant douze jours sans rencontrer la terre, et nous ne la rencontrâmes pas davantage après avoir viré cap pour cap et nous être dirigés vers le Sud pendant près d’un mois. Quelque paradoxale qu’elle nous parût, force nous fut de nous rendre à l’évidence. Oui, la totalité du continent américain s’était abîmée sous les flots!
N’avions-nous donc été sauvés que pour connaître une seconde fois les affres de l’agonie? En vérité, nous avions lieu de le craindre. Sans parler des vivres qui pourtant manqueraient un jour ou l’autre, un danger pressant nous menaçait. Que deviendrions-nous quand l’épuisement du charbon frapperait la machine d’immobilité, ainsi que cesse de battre le cœur d’un animal exsangue? C’est pourquoi, le 14 juillet, – nous nous trouvions alors à peu près à l’ancien emplacement de Buenos-Ayres – le capitaine Moris laissa tomber les feux et mit à la voile. Cela fait, il réunit tout le personnel de la Virginia, équipage et passagers, et, nous ayant résumé la situation, il nous invita à y réfléchir mûrement et à proposer la solution qui aurait nos préférences au conseil qui serait tenu le lendemain.
Je ne sais si quelqu’un de mes compagnons d’infortune eût trouvé un expédient plus ou moins ingénieux. En tout cas, pour ma part, je flottais, je l’avoue, très incertain du meilleur parti à prendre, quand une tempête qui s’éleva dans la nuit trancha la question. Il nous fallut fuir dans l’Ouest, emportés par un vent déchaîné, sans cesse sur le point d’être engloutis par une mer furieuse.
L’ouragan dura trente-cinq jours, sans une minute d’interruption, voire même de détente. Nous commençions à désespérer qu’il finît jamais, lorsque, le 19 août, le beau temps revint avec la même soudaineté qu’il avait cessé. Le capitaine en profita pour faire le point. Le calcul lui donna 40° de latitude Nord et 114° de longitude Est. C’étaient les coordonnées de Pékin!
Ainsi, nous avions passé au-dessus de la Polynésie, et peut-être de l’Australie, sans même nous en rendre compte, et là où nous voguions maintenant s’étendait jadis la capitale d’un Empire de quatre cents millions d’âmes!
L’Asie avait-elle donc eu le sort de l’Amérique?
Nous en fûmes bientôt convaincus. La Virginia, continuant sa route cap au Sud-Ouest, arriva à la hauteur du Thibet, puis à celle de l’Himalaya. Ici auraient dû s’élever les plus hauts sommets du globe. Et pourtant, dans toutes les directions, rien n’émergeait de la surface de l’océan. C’était à croire qu’il n’existait plus, sur la terre, d’autre point solide que l’îlot qui nous avait sauvés, que nous étions les seuls survivants du cataclysme, les derniers habitants d’un monde enseveli dans le mouvant linceul de la mer!
S’il en était ainsi, nous ne tarderions pas à périr à notre tour. Malgré un rationnement sévère, les vivres du bord s’épuisaient, en effet, et nous devions perdre, dans ce cas, tout espoir de les renouveler.
J’abrège le récit de cette navigation effarante. Si, pour la raconter en détail, j’essayais de la revivre jour par jour, le souvenir m’en rendrait fou. Pour étranges et terribles que soient les événements qui l’ont précédée et suivie, quelque lamentable que m’apparaisse l’avenir – un avenir que je ne verrai pas, – c’est encore pendant cette navigation infernale que nous avons connu le maximum de l’épouvante. Oh! cette course éternelle sur une mer sans fin! S’attendre tous les jours à aborder quelque part et voir sans cesse reculer le terme du voyage! Vivre penchés sur des cartes où les hommes avaient gravé la ligne sinueuse des rivages, et constater que rien, absolument rien, n’existe plus de ces lieux qu’ils pensaient éternels! Se dire que la terre palpitait de vies innombrables, que des millions d’hommes et des myriades d’animaux la parcouraient en tous sens ou en sillonnaient l’atmosphère, et que tout est mort à la fois, que toutes ces vies se sont éteintes ensemble comme une petite flamme au souffle du vent! Se chercher partout des semblables et les chercher en vain! Acquérir peu à peu la certitude qu’autour de soi il n’existe rien de vivant, et prendre graduellement conscience de sa solitude au milieu d’un impitoyable univers!…
Ai-je trouvé les mots convenables pour exprimer notre angoisse? Je ne sais. Dans aucune langue il ne doit exister d’adéquats à une situation sans précédent.
Après avoir reconnu la mer où était jadis la péninsule indienne, nous remontâmes au Nord pendant dix jours, puis nous mîmes le cap à l’Ouest. Sans qu’aucun changement ne fût apporté à notre situation, nous franchîmes la chaîne de l’Oural devenue montagnes sous-marines, et nous naviguâmes au-dessus de ce qui avait été l’Europe. Nous descendîmes ensuite vers le Sud, jusqu’à vingt degrés au-delà de l’Equateur; après quoi, lassés de notre inutile recherche, nous reprîmes la route du Nord et traversâmes, jusque passé les Pyrénées, une étendue d’eau qui recouvrait l’Afrique et l’Espagne. En vérité nous commencions à nous habituer à notre épouvante. A mesure que nous avancions, nous pointions notre route sur les cartes, et nous disions: «Ici, c’était Moscou… Varsovie… Berlin… Vienne… Rome… Tunis… Tombouctou… Saint-Louis… Oran… Madrid…», mais avec une indifférence grandissante, et, l’accoutumance aidant, nous en arrivions à prononcer sans émotion ces paroles, en réalité si tragiques.
Pourtant, moi tout au moins, je n’avais pas épuisé ma capacité de souffrance. Je m’en aperçus le jour – c’était à peu près le 11 décembre – où le capitaine Moris me dit: «Ici, c’était Paris.» A ces mots, je crus qu’on m’arrachait l’âme. Que l’univers entier fût englouti, soit! Mais la France – ma France! – et Paris, qui la symbolisait!…
A mes côtés, j’entendis comme un sanglot. Je me retournai. C’était Simonat qui pleurait.
Pendant quatre jours encore, nous poursuivîmes notre route vers le Nord, puis, arrivés à la hauteur d’Edimbourg, on redescendit vers le Sud-Ouest, à la recherche de l’Irlande, puis la route fut donnée à l’Est. En réalité, nous errions au hasard, car il n’y avait pas plus de raison d’aller dans une direction que dans une autre.
On passa au-dessus de Londres, dont la tombe liquide fut saluée de tout l’équipage. Cinq jours après, nous étions à la hauteur de Dantzig, quand le capitaine Moris fit virer cap pour cap et ordonna de gouverner au Sud-Ouest. Le timonier obéit passivement. Qu’est-ce que cela pouvait bien lui faire? De tous côtés, ne serait-ce pas la même chose?
Ce fut le neuvième jour de navigation à cette aire de compas que nous mangeâmes notre dernier morceau de biscuit.
Comme nous nous regardions avec des yeux hagards, le capitaine Moris commanda tout à coup de rallumer les feux. A quelle pensée obéissait-il? J’en suis encore à me le demander. Quoi qu’il en soit, l’ordre fut exécuté, et la vitesse du navire s’accéléra.
Deux jours plus tard, nous souffrions déjà cruellement de la faim. Le surlendemain, presque tous refusèrent obstinément de se lever. Il n’y eut que le capitaine, Simonat, quelques hommes de l’équipage et moi, pour avoir l’énergie d’assurer la direction du navire.
Le lendemain, cinquième jour de jeûne, le nombre des timoniers et des mécaniciens bénévoles décrut encore. Dans vingt-quatre heures, personne n’aurait plus la force de se tenir debout.
Nous naviguions, en ce moment, depuis plus de sept mois. Depuis plus de sept mois, nous sillonnions la mer en tous sens. Nous devions être, je crois, le 8 janvier. Je dis: je crois, dans l’impossibilité où je suis d’être plus précis, le calendrier ayant dès lors perdu pour nous beaucoup de sa rigueur.
Or, ce fut ce jour-là, pendant que je tenais la barre et que je consacrais à garder la ligne de foi toute mon attention défaillante, qu’il me sembla distinguer quelque chose dans l’Ouest. Croyant être le jouet d’une erreur, j’écarquillai les yeux…
Non, je ne m’étais pas trompé.
Je poussai un véritable rugissement, puis, me cramponnant à la barre, je criai d’une voix forte:
«Terre par tribord devant!»
Quel effet magique eurent ces mots! Tous les moribonds ressuscitèrent à la fois, et leurs figures hâves apparurent au-dessus de la lisse de tribord.
«C’est bien la terre», dit le capitaine Moris, après avoir examiné le nuage qui apparaissait à l’horizon.
Une demi-heure plus tard, il était impossible de conserver le moindre doute. C’était bien la terre que nous trouvions en plein Océan Atlantique, après l’avoir vainement cherchée sur toute la surface des anciens continents!
Vers trois heures de l’après-midi, le détail du littoral qui nous barrait la route devint perceptible, et nous sentîmes renaître notre désespoir. C’est qu’en vérité ce littoral ne ressemblait à aucun autre, et nul d’entre nous n’avait souvenir d’en avoir jamais vu d’une si absolue, d’une si parfaite sauvagerie.
Sur la terre, telle que nous l’habitions avant le désastre, le vert était une couleur très abondante. Nul d’entre nous ne connaissait de côte si déshéritée, de contrée si aride, qu’il ne s’y rencontrât quelques arbustes, voire quelques touffes d’ajoncs, voire simplement des traînées de lichens ou de mousses. Ici, rien de tel. On ne distinguait qu’une haute falaise noirâtre, au pied de laquelle gisait un chaos de rochers, sans une plante, sans un seul brin d’herbe. C’était la désolation dans ce qu’elle peut avoir de plus complet, de plus total.
Pendant deux jours, nous longeâmes cette falaise abrupte sans y découvrir la moindre fissure. Ce fut seulement vers le soir du second que nous découvrîmes une vaste baie, bien abritée contre tous les vents du large, au fond de laquelle nous laissâmes tomber l’ancre.
Ayant aussitôt gagné la terre dans les canots, notre premier soin fut de récolter notre nourriture sur la grève. Celle-ci était couverte de tortues par centaines et de coquillages par millions. Dans les interstices des récifs, on voyait des crabes, des homards et des langoustes en quantité fabuleuse, sans préjudice d’innombrables poissons. De toute évidence, cette mer si abondamment peuplée suffirait, à défaut d’autres ressources, à assurer notre vie pendant un temps illimité.
Quand nous fûmes restaurés, une coupure de la falaise nous permit d’atteindre le plateau, où nous découvrîmes une large étendue de pays. L’aspect du rivage ne nous avait pas trompé. De tous côtés, dans toutes les directions, ce n’étaient que roches arides, recouvertes d’algues et de goëmons généralement desséchés, sans le plus petit brin d’herbe, sans rien de vivant, ni sur la terre, ni dans le ciel. De place en place, de petits lacs, des étangs plutôt, brillaient aux rayons du soleil. Ayant tenté de nous désaltérer, nous reconnûmes que l’eau en était salée.
Nous n’en fûmes pas surpris, à vrai dire. Le fait confirmait ce que nous avions supposé de prime abord, à savoir que ce continent inconnu était né d’hier et qu’il était sorti d’un seul bloc des profondeurs de la mer. Cela expliquait son aridité, ainsi que sa complète solitude. Cela expliquait encore cette épaisse couche de vase uniformément répandue, qui, par suite de l’évaporation, commençait à se craqueler et à se réduire en poussière.
Le lendemain, à midi, le point donna 17° 20’ de latitude Nord et 23° 55’ de longitude Ouest. En le reportant sur la carte, nous pûmes voir qu’il se trouvait bien en pleine mer, à peu près à la hauteur du Cap Vert. Et pourtant, dans l’Ouest la terre, la mer dans l’Est, s’étendaient maintenant à perte de vue.
Quelque rébarbatif et inhospitalier que fût le continent sur lequel nous avions pris pied, force nous était de nous en contenter. C’est pourquoi le déchargement de la Virginia fut entrepris sans plus attendre. On monta sur le plateau tout ce qu’elle contenait, sans choix ni sélection. Auparavant, on avait affourché solidement le bâtiment sur quatre ancres, par quinze brasses de fond. Dans cette baie tranquille, il ne courait aucun risque, et nous pouvions sans inconvénient l’abandonner à lui-même.
Dès que le débarquement fut achevé, notre nouvelle vie commença. En premier lieu, il convenait…
Arrivé à ce point de sa traduction, le zartog Sofr dut l’interrompre. Le manuscrit avait à cet endroit une première lacune, probablement fort importante d’après la quantité de pages intéressées, lacune suivie de plusieurs autres plus considérables encore, autant qu’on en pouvait juger. Sans doute, un grand nombre de feuillets avaient été atteints par l’humidité, malgré la protection de l’étui; il ne subsistait, en somme, que des fragments plus ou moins étendus, dont le contexte était à jamais détruit. Ils se succédaient dans cet ordre:
…commençons à nous acclimater.
Combien y a-t-il de temps que nous avons débarqué sur cette côte? Je n’en sais plus rien. Je l’ai demandé au docteur Moreno, qui tient un calendrier des jours écoulés. Il m’a dit: «Six mois», en ajoutant: «à quelques jours près» car il craint de s’être trompé.
Nous en sommes déjà là! Il n’a fallu que six mois pour que nous ne soyons plus très sûrs d’avoir mesuré exactement le temps. Cela promet!
Notre négligence n’a, au surplus, rien de bien étonnant. Nous employons toute notre attention, toute notre activité à conserver notre vie. Se nourrir est un problème dont la solution exige la journée entière. Que mangeons-nous? Des poissons, quand nous en trouvons, ce qui devient chaque jour moins facile, car notre poursuite incessante les effarouche. Nous mangeons aussi des œufs de tortue et certaines algues comestibles. Le soir, nous sommes repus, mais exténués, et nous ne pensons qu’à dormir.
On a improvisé des tentes avec les voiles de la Virginia. J’estime qu’il faudra construire à bref délai un abri plus sérieux.
De temps en temps, nous tirons un oiseau. L’atmosphère n’est pas si déserte que nous l’avions supposé d’abord. Une dizaine d’espèces connues sont représentées sur ce continent nouveau. Ce sont exclusivement des longs courriers: hirondelles, albatros, cordonniers et quelques autres. Il faut croire qu’ils ne trouvent pas leur nourriture sur cette terre sans végétation, car ils ne cessent de tournoyer autour de notre campement, à l’affût des reliefs de nos misérables repas. Parfois nous en ramassons un que la faim a tué, ce qui épargne notre poudre et nos fusils.
Heureusement, la situation a des chances de devenir meilleure. Nous avons découvert un sac de blé dans la cale de la Virginia, et on en a semé la moitié. Ce sera une grande amélioration, quand ce blé aura poussé. Mais germera-til? Le sol est recouvert d’une couche épaisse d’alluvion, formée d’une vase sableuse engraissée par la décomposition des algues. Quelque médiocre que soit sa qualité, c’est de l’humus tout de même. Lorsque nous avons abordé, il était imprégné de sel, mais, depuis, des pluies diluviennes en ont abondamment lavé la surface, puisque toutes les dépressions sont maintenant pleines d’eau douce.
Toutefois, la couche alluvionnaire n’est débarrassée de sel que sur une très faible épaisseur. Les ruisseaux, les rivières même, qui commencent à se former, sont tous fortement saumâtres, ce qui prouve qu’elle est encore saturée en profondeur.
Pour semer le blé et pour conserver l’autre moitié en réserve, il a presque fallu se battre. Une partie de l’équipage de la Virginia voulait en faire du pain tout de suite. Nous avons été contraints de…
***
… que nous avions à bord de la Virginia. Ces deux couples de lapins se sont sauvés dans l’intérieur et on ne les a plus revus. Il faut croire qu’ils ont trouvé de quoi se nourrir. La terre, à notre insu, produirait-elle donc…
***
… deux ans au moins que nous sommes ici! Le blé a admirablement réussi. Nous avons du pain presque à discrétion, et nos champs gagnent toujours en étendue. Mais quelle lutte contre les oiseaux! Ils se sont étrangement multipliés, et, tout autour de nos cultures…
***
Malgré les décès que j’ai relatés ci-dessus, la petite tribu que nous formons n’a pas diminué, au contraire. Mon fils et ma pupille ont trois enfants, et chacun des trois autres ménages en a autant. Toute cette marmaille éclate de santé. C’est à croire que l’espèce humaine possède une vigueur plus grande, une vitalité plus intense, depuis qu’elle est si réduite en nombre. Mais que de causes…
***
… ici depuis dix ans et nous ne savions rien de ce continent. Nous ne le connaissions que sur un rayon de quelques kilomètres autour du lieu de notre débarquement. C’est le docteur Bathurst qui nous a fait honte de notre aveulissement. A son instigation, nous avons armé la Virginia, ce qui a demandé près de six mois, et nous avons fait un voyage d’exploration.
Nous voici revenus d’avant-hier. Le voyage a duré plus que nous ne pensions, parce que nous avons voulu qu’il fût complet.
Nous avons fait le tour du continent qui nous porte et qui, tout nous incite à le croire, doit être, avec notre îlot, la dernière parcelle solide existant à la surface du globe. Ses rivages nous ont semblé être partout semblables, c’est-à-dire très heurtés et très sauvages.
Notre navigation a été coupée de plusieurs excursions dans l’intérieur, notamment en vue de trouver trace de l’archipel des Açores et de Madère, situés, avant le cataclysme, dans l’Océan Atlantique, et qui doivent, en conséquence, faire nécessairement partie du continent nouveau. Nous n’en avons pas reconnu le moindre vestige. Tout ce que nous avons pu constater, c’est que le sol était bouleversé et recouvert d’une épaisse couche de lave à l’emplacement de ces îles, qui, sans doute, ont été le siège de violents phénomènes volcaniques.
Par exemple, si nous n’avons pas découvert ce que nous cherchions, nous avons trouvé ce que nous ne cherchions pas. A demi pris dans la lave, des témoins d’un travail humain nous sont apparus à la hauteur des Açores, mais non pas du travail des Açoriens, nos contemporains d’hier. C’étaient des débris de colonnes ou de poteries, telles que nous n’en avions jamais vu. Examen fait, le docteur Moreno suggéra que ces débris devaient provenir de l’antique Atlantide, et que le flux volcanique les aurait ramené au jour.
Le docteur Moreno a peut-être raison. La légendaire Atlantide aurait occupé, en effet, si elle a jamais existé, à peu près la place du nouveau continent. Ce serait, dans ce cas, une chose singulière que la succession aux mêmes lieux de trois humanités ne procédant pas l’une de l’autre.
Quoi qu’il en soit, j’avoue que le problème me laisse froid. Nous avons assez à faire avec le présent, sans nous occuper du passé.
Au moment où nous avons regagné notre campement, cette remarque nous a frappés que, par rapport au reste du pays, ses environs immédiats pouvaient passer pour une région favorisée. Cela tient uniquement à ce que la couleur verte, jadis si abondante dans la nature, n’y est pas tout à fait inconnue, tandis qu’elle est radicalement supprimée dans le reste du continent. Nous n’avions jamais fait cette observation jusqu’alors, mais la chose est indéniable. Des brins d’herbe, qui n’existaient pas au moment de notre débarquement, jaillissent maintenant assez nombreux autour de nous. Ils n’appartiennent, d’ailleurs, qu’à un petit nombre d’espèces parmi les plus vulgaires, dont les oiseaux auront, sans doute, transporté les graines jusqu’ici.
Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède qu’il n’y a pas de végétation, en dehors de ces quelques espèces anciennes. Par suite d’un travail d’adaptation des plus étranges, il existe, au contraire, une végétation, à l’état, tout au moins, de rudiment, de promesse, sur toute l’étendue du continent.
Les plantes marines, dont celui-ci était couvert quand il a jailli hors des flots, sont mortes, pour la plupart, à la lumière du soleil. Quelques-unes cependant ont persisté, dans les lacs, les étangs et les flaques d’eau que la chaleur a progressivement desséchés. Mais, à ce moment, des rivières et des ruisseaux commençaient à naître, d’autant plus propres à la vie des goëmons et des algues que l’eau en était salée. Lorsque la surface, puis la profondeur du sol eurent été privées de sel, et que l’eau devint douce, l’immense majorité de ces plantes furent détruites. Un petit nombre d’entre elles, cependant, ayant pu se plier aux nouvelles conditions de vie, prospérèrent dans l’eau douce comme elles avaient prospéré dans l’eau salée. Mais le phénomène ne s’est pas arrêté là. Quelques-unes de ces plantes, douées d’un pouvoir d’accommodation plus grand, se sont adaptées au plein air, après s’être adaptées à l’eau douce, et, sur les berges tout d’abord, puis de proche en proche, ont gagné vers l’intérieur.
Nous avons surpris cette transformation sur le vif, et nous avons pu constater combien les formes se modifiaient en même temps que le fonctionnement physiologique. Déjà quelques tiges s’érigent timidement vers le ciel. On peut prévoir qu’un jour une flore sera ainsi créée de toutes pièces, et qu’une lutte ardente s’établira entre les espèces nouvelles et celles provenant de l’ancien ordre de choses.
Ce qui se passe pour la flore se passe aussi pour la faune. Dans le voisinage des cours d’eau, on voit d’anciens animaux marins, mollusques et crustacés pour la plupart, en train de devenir terrestres. L’air est sillonné de poissons volants, beaucoup plus oiseaux que poissons, leurs ailes ayant démesurément grandi et leur queue incurvée leur permettant…
Le dernier fragment contenait, intacte, la fin du manuscrit. Il était ainsi conçu:
… tous vieux. Le capitaine Moris est mort. Le docteur Bathurst a soixante-cinq ans, le docteur Moreno soixante, moi soixante-huit. Tous, nous aurons bientôt fini de vivre. Auparavant, cependant, nous accomplirons la tâche résolue, et, autant que cela est en notre pouvoir, nous viendrons en aide aux générations futures dans la lutte qui les attend.
Mais verront-elles le jour, ces générations de l’avenir?
Je suis tenté de répondre oui, si je ne tiens compte que de la multiplication de mes semblables. Les enfants pullulent, et, d’autre part, sous ce climat sain, dans ce pays où les animaux féroces sont inconnus, grande est la longévité. Notre colonie a triplé d’importance.
Par contre, je suis tenté de répondre non, si je considère la profonde déchéance intellectuelle de mes compagnons de misère.
Notre petit groupe de naufragés était cependant dans des conditions favorables pour tirer parti du savoir humain. Il comprenait un homme particulièrement énergique: le capitaine Moris, aujourd’hui décédé; deux hommes plus cultivés qu’on ne l’est d’ordinaire: mon fils et moi, et deux savants véritables: le docteur Bathurst et le docteur Moreno. Avec de pareils éléments, on aurait pu faire quelque chose. On n’a rien fait. La conservation de notre vie matérielle a été, depuis l’origine, et est encore notre unique souci. Comme au début, nous employons notre temps à chercher notre nourriture, et, le soir, nous tombons, épuisés, dans un lourd sommeil.
Il est, hélas! trop certain que l’humanité, dont nous sommes les seuls représentants, est en voie de régression rapide et tend à se rapprocher de la brute. Chez les matelots de la Virginia, gens déjà incultes autrefois, les caractères de l’animalité se sont accentués; mon fils et moi, nous avons oublié ce que nous savions; le docteur Bathurst et le docteur Moreno eux-mêmes ont laissé leur cerveau en friche. On peut dire que notre vie cérébrale est abolie.
Combien il est heureux que nous ayons accompli, il y a de cela bien des années, le périple de ce continent! Aujourd’hui, nous n’aurions plus le même courage. Et d’ailleurs le capitaine Moris est mort, qui conduisait l’expédition, et morte de vétusté la Virginia qui nous portait.
Au début de notre séjour, quelques-uns d’entre nous avaient entrepris de se bâtir des maisons. Ces constructions inachevées tombent en ruines, à présent. Nous dormons tous à même la terre en toutes saisons.
Depuis longtemps il ne reste plus rien des vêtements qui nous couvraient. Pendant quelques années, on s’est ingénié à les remplacer par des algues tissées d’une façon d’abord ingénieuse, puis plus grossière. Puis, on s’est lassé de cet effort que la douceur du climat rend superflu. Nous vivons nus, comme ceux que nous appelions des sauvages.
Manger, manger, c’est notre but perpétuel, notre préoccupation exclusive.
Cependant, il subsiste encore quelques restes de nos anciennes idées et de nos anciens sentiments. Mon fils Jean, homme mûr maintenant et grand-père, n’a pas perdu tout sentiment affectif, et mon ex-chauffeur, Modeste Simonat, conserve une vague souvenance que je fus le maître autrefois.
Mais avec eux, avec nous, ces traces impalpables des hommes que nous fûmes – car nous ne sommes plus des hommes, en vérité – vont disparaître à jamais. Ceux de l’avenir, nés ici, n’auront jamais connu d’autre existence. L’humanité sera réduite à ces adultes – j’en ai sous les yeux, tandis que j’écris – qui ne savent pas lire, ni compter, à peine parler; à ces enfants aux dents aiguës, qui semblent n’être qu’un ventre insatiable. Puis, après ceux-ci, il y aura d’autres adultes et d’autres enfants, puis d’autres adultes et d’autres enfants encore, toujours plus proches de l’animal, toujours plus loin de leurs aïeux pensants.
Il me semble les voir, ces hommes futurs, oublieux du langage articulé, l’intelligence éteinte, le corps couvert de poils rudes, errer dans ce morne désert…
Eh bien! nous voulons essayer qu’il n’en soit pas ainsi. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les conquêtes de l’humanité dont j’ai fait partie ne soient pas à jamais perdues. Le docteur Moreno, le docteur Bathurst et moi, nous réveillerons notre cerveau engourdi, nous l’obligerons à se rappe1er ce qu’il a su. Nous partageant le travail, sur ce papier et avec cette encre provenant de la Virginia, nous énumérerons tout ce que nous connaissons dans les diverses branches de la science, afin que, plus tard, les hommes, s’ils perdurent, et si, après une période de sauvagerie plus ou moins longue, ils sentent renaître leur soif de lumière, trouvent ce résumé de ce qu’ont fait leurs devanciers. Puissent-ils alors bénir ta mémoire de ceux qui tentèrent de la sorte d’abréger la route douloureuse de frères qu’ils ne verront pas!
***
Au seuil de la mort.
Il y a maintenant environ quinze ans que les lignes ci-dessus furent écrites. Le docteur Bathurst et le docteur Moreno ne sont plus. De tous ceux qui débarquèrent ici, moi, l’un des plus vieux, je reste presque seul. Mais la mort va me prendre à mon tour. Je la sens monter de mes pieds glacés à mon cœur qui s’arrête.
Notre travail est terminé. J’ai enfermé les manuscrits qui contiennent le résumé de la science humaine dans une caisse de fer débarquée de la Virginia, et que j’ai enfoncée profondément dans le sol. A côté, je vais placer ces quelques pages roulées dans un étui d’aluminium.
Quelqu’un trouvera-t-il jamais le dépôt confié à la terre? Quelqu’un le cherchera-t-il seulement?…
C’est affaire à la destinée. A Dieu vat!…
![]()
III
![]() mesure que le zartog
traduisait cet étrange document, une sorte d’épouvante étreignait son
âme.
mesure que le zartog
traduisait cet étrange document, une sorte d’épouvante étreignait son
âme.
Eh quoi! la race des Andarti-Iten-Schu descendait de ces hommes, qui, après avoir erré de longs mois sur le désert des océans, étaient venus échouer en ce point du rivage où s’élevait maintenant Basidra? Ainsi, ces créatures misérables avaient fait partie d’une humanité glorieuse, au regard de laquelle l’humanité actuelle balbutiait à peine! Et cependant, pour que fussent abolis à jamais la science et jusqu’au souvenir de ces peuples si puissants, qu’avait-il fallu? Moins que rien. Qu’un imperceptible frisson parcourut l’écorce du globe.
Quel irréparable malheur que les manuscrits dont parlait le document eussent été détruits avec la caisse de fer qui les contenait! Mais, quelque grand que fût ce malheur, il était impossible de conserver le moindre espoir, les ouvriers ayant, pour creuser les fondations, retourné le sol en tous sens. A n’en pas douter, le fer avait été corrodé par le temps, alors que l’étui d’aluminium résistait victorieusement.
Au reste, il n’en fallait pas plus pour que l’optimisme de Sofr fût irrémédiablement renversé. Si le manuscrit ne contenait aucun détail technique, il abondait en indications générales et prouvait d’une manière péremptoire que l’humanité s’était, dans le passé, avancée plus avant sur la route de la vérité qu’elle ne l’avait fait aujourd’hui. Tout y était, dans ce récit, les notions connues de Sofr, et d’autres qu’il n’aurait même pas osé imaginer, jusqu’à l’explication de ce nom d’Edom, sur lequel tant de vaines polémiques s’étaient engagées. Edom, c’était la déformation d’Edèm, lui-même déformation d’Adam, lequel Adam n’était peut-être que la déformation de quelque autre mot plus ancien.
Edom, Edèm, Adam, c’est le perpétuel symbole du premier homme, et c’est aussi une explication de son arrivée sur la terre. Sofr avait donc eu tort de nier cet ancêtre, dont le manuscrit établissait sans conteste la réalité, et c’est le peuple qui avait eu raison de se donner des ascendants semblables à lui-même. Mais, pas plus pour cela que pour tout le reste, les Andarti-Iten-Schu n’avaient rien inventé. Ils s’étaient contentés de redire ce qu’on avait dit avant eux.
Et peut-être, après tout, les contemporains du rédacteur de ce récit n’avaient-ils pas inventé davantage. Peut-être n’avaient-ils fait que refaire, eux aussi, le chemin parcouru par d’autres humanités venues avant eux sur la terre. Le document ne parlait-il pas d’un peuple qu’il nommait Atlantes? C’était de ces Atlantes, sans doute, que les fouilles de Sofr avaient permis de retrouver quelques traces impalpables au-dessous du limon marin. A quelle connaissance de la vérité cette antique nation était-elle parvenue, quand l’invasion de l’océan la raya de la terre?
Quelle qu’elle fût, il ne subsistait rien de son œuvre après la catastrophe, et l’homme avait dû reprendre du bas de la montée son ascension vers la lumière.
Peut-être en serait-il de même pour les Andarti-Iten-Schu. Peut-être en serait-il encore ainsi après eux, jusqu’au jour…
Mais le jour viendrait-il jamais où serait satisfait l’insatiable désir de l’homme? Le jour viendrait-il jamais où celui-ci, ayant achevé de gravir la pente, pourrait se reposer sur le sommet enfin conquis?
Ainsi songeait le zartog Sofr, penché sur le manuscrit vénérable.
Par ce récit d’outre-tombe, il imaginait le drame terrible qui se déroule perpétuellement dans l’univers, et son cœur était plein de pitié. Tout saignant des maux innombrables dont ce qui vécut avait souffert avant lui, pliant sous le poids de ces vains efforts accumulés dans l’infini des temps, le zartog Sofr-Aï-Sr prenait, lentement, douloureusement, conscience de l’éternel recommencement des choses.
FIN