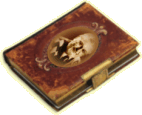Jules Verne
Le Chemin de france
(Chapitre XXI-XXV)
41 dessinset deux cartes par George Roux
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
![]() éparés, après trois semaines d’un voyage qu’un peu plus de chance eût mené à bonne fin! Séparés, lorsque, quelques lieues au delà, c’était le salut assuré pour tous! Séparés avec la crainte de ne plus jamais se revoir!
éparés, après trois semaines d’un voyage qu’un peu plus de chance eût mené à bonne fin! Séparés, lorsque, quelques lieues au delà, c’était le salut assuré pour tous! Séparés avec la crainte de ne plus jamais se revoir!
Et ces femmes, abandonnées dans la maison d’un paysan, au milieu d’un village occupé par l’ennemi, n’ayant pour défenseur qu’un vieillard de soixante-dix ans!
En vérité, est-ce que je n’aurais pas dû rester près d’elles?… Mais, ne songeant qu’au fugitif, à travers cette redoutable Argonne qu’il ne connaissait pas, pouvais-je hésiter à rejoindre M. Jean à qui je serais si utile? Pour M. de Lauranay et ses compagnes, il n’y allait que de la liberté – je l’espérais, du moins. Pour Jean Keller, il y allait de la vie. Rien que cette pensée m’eût retenu, si j’avais été tenté de revenir à la Croix-aux-Bois.
Voici, d’ailleurs, ce qui s’était passé, et pourquoi ce village fut envahi dans la journée du 16.
On se souvient que des cinq défilés de la forêt de l’Argonne, un seul, celui de la Croix-aux-Bois, était resté inoccupé par les Français.
Cependant, afin de se garder de toute surprise, Dumouriez avait envoyé au débouché de ce passage, vers Longwé, un colonel avec deux escadrons et deux bataillons. C’était assez loin de la Croix-aux-Bois pour que Hans Stenger n’eût pas eu connaissance de ce fait. D’ailleurs, telle était la conviction que les Impériaux ne se hasarderaient pas à travers ce défilé, qu’on ne prit aucune mesure pour le défendre. Ni abatis ne furent faits, ni palissades. Et même, persuadé que rien ne menaçait l’Argonne à cette hauteur, le colonel, demanda à renvoyer une partie de ses troupes au quartier général – ce qui lui fut accordé.
C’est alors que les Autrichiens, mieux avisés, envoyèrent reconnaître le passage. De là, cette visite d’un tas d’espions allemands, qui parurent à la Croix-aux-Bois, puis l’occupation du défilé. Et voilà comment, par suite d’un faux calcul, une des portes de l’Argonne était ouverte sur la France.
Dès que Brunswick apprit que la passe de la Croix-aux-Bois était demeurée libre, il donna ordre de l’occuper. Et cela arriva même au moment où, très embarrassé pour déboucher dans les plaines de la Champagne, il s’apprêtait à remonter vers Sedan, afin de tourner l’Argonne par le nord. Mais, la Croix-aux-Bois à lui, il pouvait, non sans quelques difficultés sans doute, s’introduire par ce défilé. Il envoya donc une colonne autrichienne, avec les immigrés commandés par le prince de Ligne.
Le colonel français et ses hommes, surpris par cette attaque, durent céder la place, et se replier vers Grand-Pré. L’ennemi fut maître du passage.
Voilà ce qui s’était fait au moment où nous avions été obligés de prendre la fuite. Depuis, Dumouriez tenta de réparer cette faute si grave, en envoyant le général Chazot avec deux brigades, six escadrons et quatre pièces de huit, pour chasser les Autrichiens, avant qu’ils se fussent retranchés.
Malheureusement, le 14, Chazot ne fut pas en mesure d’opérer, le 15, non plus. Lorsqu’il attaqua dans la soirée du 16, il était déjà trop tard.
En effet, s’il repoussa d’abord les Autrichiens du défilé, s’il leur tua même le prince de Ligne, il eut bientôt à soutenir le choc de forces supérieures. Malgré d’héroïques efforts, le passage de la Croix-aux-Bois fut définitivement perdu.
Faute très regrettable pour la France, et, j’ajouterai, pour nous, car, sans cette déplorable erreur, dès le 15, nous eussions pu être au milieu des Français.
Maintenant, cela n’était plus possible. En effet, Chazot, se voyant coupé du quartier-général, recula sur Vouziers, tandis que Dubourg, qui occupait le Chêne-Populeux, craignant d’être enveloppé, revenait vers Attigny.
La frontière de France était donc ouverte aux colonnes des Impériaux. Dumouriez risquait d’être cerné et contraint de mettre bas les armes.
Et alors, plus d’obstacles sérieux à opposer aux envahisseurs entre Paris et l’Argonne.
Quant à nous deux Jean Keller, je suis forcé de convenir que nous étions mal pris.
Presque aussitôt après avoir quitté la maison de Hans Stenger, j’avais rejoint M. Jean au plus épais du bois.
«Vous… Natalis? s’écria-t-il.
– Oui!… moi!…
– Et votre promesse de ne jamais abandonner ni Marthe ni ma mère!
– Minute, monsieur Jean! Écoutez-moi!»
Alors je lui dis tout, que je connaissais ce pays de l’Argonne dont il ignorait l’étendue et la disposition, que Mme Keller et Mlle Marthe, m’avaient, pour ainsi dire, donné l’ordre de le suivre, que je n’avais pas hésité…
«Et si j’ai mal fait, monsieur Jean, ajoutai-je, que Dieu me punisse!
– Venez donc!»
En ce moment, il ne s’agissait plus de suivre le défilé jusqu’à la frontière de l’Argonne. Les Autrichiens pouvaient se jeter en dehors du passage de la Croix-aux-Bois, et même de la sente de Briquenay. De là, nécessité de piquer droit au sud-ouest, de manière à franchir la ligne de l’Aisne.
Nous allâmes dans cette direction jusqu’à l’heure où le jour manqua tout à fait. S’aventurer dans l’ombre n’était pas possible. Comment s’orienter? Nous fîmes halte pour la nuit.
Pendant les premières heures, les coups de feu ne cessèrent de se faire entendre, à moins d’une demi-lieue. C’étaient les volontaires de Longwé, qui essayaient de reprendre le défilé aux Autrichiens. Mais, n’étant pas en force, ils furent obligés de se disperser. Par malheur, ils ne se jetèrent pas à travers la forêt, où nous aurions pu les rencontrer et apprendre d’eux que Dumouriez avait son quartier général à Grand-Pré. Nous les eussions accompagnés. Là, ainsi que je le sus plus tard, j’aurais retrouvé mon brave régiment de Royal-Picardie, qui avait quitté Charleville pour se joindre à l’armée du centre. Arrivés à Grand-Pré, M. Jean et moi, nous étions au milieu de nos amis, nous étions sauvés, nous aurions vu ce qu’il convenait de faire pour le salut des êtres si chers, abandonnés à la Croix-aux-Bois.
Mais les volontaires avaient évacué l’Argonne et remonté le cours de l’Aisne, afin de regagner le quartier général.
La nuit fut mauvaise. Il tombait une bruine qui perçait jusqu’aux os. Nos vêtements, déchirés par les broussailles, s’en allaient par lambeaux. Je n’en réchapperais même pas ma roulière. C’étaient surtout nos chaussures qui menaçaient de nous laisser pieds nus. En serions-nous donc réduits à marcher sur notre «chrétienté», comme on dit au village? Enfin, nous étions transis, car la pluie filtrait à travers le feuillage, et j’avais en vain cherché un trou pour nous y blottir. Ajoutez à cela quelques alertes, des coups de feu tellement rapprochés que, deux ou trois fois, je crus en voir la lueur, et cette angoisse d’entendre à chaque instant retentir le hurrah prussien!… Il fallait alors s’enfuir plus profondément, crainte de se faire ramasser. Ah! misère et poussière! que le jour tardait à venir!
Dès que l’aube eut monté, nous reprîmes notre course à travers la forêt. Je dis course, car nous allions aussi vite que le permettait la nature du sol, tandis que je m’orientais de mon mieux sur le soleil levant.
De plus, rien dans le ventre, et la faim nous aiguillonnait. M. Jean, en fuyant la maison des Stenger, n’avait pas eu le temps de prendre des provisions. Moi, parti comme un fou, tant je redoutais que la retraite me fût coupée par les Autrichiens, je ne m’étais pas mieux pourvu. Nous en étions donc réduits à danser devant le buffet, ainsi que l’on fait quand il est vide. Si les corneilles, les émouchets, et nombre de petits oiseaux, des bruants surtout, volaient par centaines à travers les arbres, le gibier paraissait rare. A peine ça et là un gîte de lièvre ou quelques couples de gelinottes qui fuyaient sous le taillis. Et comment les attraper? Par bonheur, les châtaigniers ne manquent pas dans l’Argonne, ni les châtaignes en cette saison. J’en fis cuire sous la cendre, après avoir allumé un tas de broussailles avec un peu de poudre. Cela nous empêcha positivement de succomber à la faim.
La nuit vint – une nuit froide et sombre. Le bois était si serré que nous n’avions pas fait longue route depuis le matin. Cependant la lisière de l’Argonne ne pouvait être éloignée. On entendait la mousqueterie des éclaireurs qui battaient l’estrade le long de l’Aisne. Toutefois, il faudrait encore près de vingt-quatre heures, avant que nous eussions pu trouver refuge de l’autre côté de la rivière, soit à Vouziers, soit dans un des villages de la rive gauche.
Je ne parlerai pas de nos fatigues. Nous n’avions pas le temps d’y songer. Ce soir-là, malgré que mon cerveau fut obsédé de mille craintes, comme j’avais sommeil, je m’étendis au pied d’un arbre. Je me rappelle qu’au moment où mes yeux se fermèrent, je songeais à ce régiment du colonel von Grawert, qui avait laissé une trentaine de ses morts dans la clairière, quelques jours avant. Ce régiment, avec son colonel et ses officiers, je l’envoyais au diable, et il y allait, quand je m’endormis.
Le matin venu, M. Jean, je le vis bien, n’avait pas fermé l’oeil. Il ne pensait guère à lui, – on le connaît assez pour en être sûr. Mais de se représenter sa mère, Mlle Marthe, dans cette maison de la Croix-aux-Bois, entre les mains des Autrichiens, exposées à tant d’injures, brutalisées peut-être, cela lui brisait le cœur.
En somme, pendant cette nuit, c’était M. Jean qui avait veillé. Et il faut que j’aie eu le sommeil dur, car les détonations éclatèrent encore à peu de distance. Comme je ne me réveillais pas, M. Jean voulut me laisser dormir.
Au moment où nous allions nous remettre en route, M. Jean m’arrêta et dit:
«Natalis, écoutez-moi.»
Il avait prononcé ces mots du ton d’un homme dont la résolution est prise. Je vis de quoi il retournait, et je répondis sans plus attendre:
«Non, monsieur Jean, je ne vous écouterai pas, si c’est de séparation que vous avez à me parler.
– Natalis, reprit-il, c’est par dévouement pour moi que vous avez voulu me suivre.
– Soit!
– Tant qu’il ne s’est agi que de fatigues, je n’ai rien dit. Maintenant, il s’agit de dangers. Si je suis pris et si l’on vous prend avec moi, on ne vous épargnera pas. Ce sera la mort pour vous… et cela, Natalis, je ne puis l’accepter. Partez donc!… Passez la frontière… J’essaierai de le faire de mon côté… et si nous ne nous revoyons pas…
– Monsieur Jean, répondis-je, il est temps de se remettre en route. Nous serons sauvés ou nous mourrons ensemble!
– Natalis…
– Je jure Dieu que je ne vous quitterai pas!»
Et nous voilà repartis. Les premières heures du jour avaient été bruyantes. L’artillerie ronflait au milieu des crépitements de la mousqueterie. C’était une nouvelle attaque du défilé de la Croix-aux-Bois, – attaque qui ne réussit pas en présence d’un ennemi trop nombreux.
Puis, vers huit heures, tout redevint silencieux. On n’entendait plus un seul coup de fusil. Terrible incertitude pour nous! Qu’un combat se fût livré dans le défilé, nul doute possible à cet égard. Mais quel en avait été le résultat? Devions-nous remonter à travers la forêt? Non! D’instinct, je sentais que c’eût été se livrer. Il fallait continuer toujours, continuer quand même, en marchant dans la direction de Vouziers.
A midi, quelques châtaignes, grillées sous les cendres, furent encore notre seule nourriture. Le taillis était si épais que nous faisions à peine cinq cents pas en une heure. Et puis, des alertes soudaines, des coups de feu à droite, à gauche, et enfin, ce qui vous mettait l’effroi dans l’âme, le glas du tocsin qui bourdonnait dans tous les villages de l’Argonne!
Le soir vint. Nous ne devions pas être à une lieue du cours de l’Aisne. Le lendemain, si aucun obstacle ne nous arrêtait, notre salut serait assuré de l’autre côté du fleuve. Il n’y aurait qu’à le redescendre pendant une heure sur sa rive droite, et nous le passerions sur les ponts de Senuc ou de Grand-Ham, dont Clairfayt ni Brunswick n’étaient encore les maîtres.
Nous avions fait halte vers huit heures. De notre mieux, nous cherchions à nous garantir du froid au fond d’un épais fourré. On n’entendait que le grignotement de la pluie sur les feuilles. Tout était tranquille dans la forêt, et je ne sais pourquoi je trouvais quelque chose d’inquiétant à cette tranquillité.
Soudain, à quelque vingt pas, des voix se firent entendre. M. Jean me saisit la main:
«Oui! disait-on, nous sommes sur ses traces depuis la Croix-aux-Bois!
– Il ne nous échappera pas!
– Mais rien des mille florins aux Autrichiens!…
– Non!… non! camarades!…»
Je sentais la main de M. Jean qui serrait plus fortement la mienne.
«La voix de Buch! murmura-t-il à mon oreille.
– Les gueux! répondis-je. Ils sont là cinq ou six peut-être!… Ne les attendons pas!…»
Et voilà que nous glissons hors du fourré en rampant au milieu des herbes.
Tout à coup, un bruit de branche brisée nous trahit. Presque aussitôt, un coup de feu illumina le sous-bois. Nous avions été aperçus.
«Venez, monsieur Jean, venez! m’écriai-je.
– Pas avant d’avoir cassé la tête à l’un de ces misérables!»
Et il déchargea son pistolet dans la direction du groupe qui se précipitait vers nous.
Je crois bien que l’un de ces chenapans tomba. Mais j’avais autre chose à faire que de m’en assurer.
Nous courions de toute la vitesse de nos jambes. Je sentais Buch et ses camarades à nos chausses. Nous étions à bout de forces!
Un quart d’heure après, la bande tomba sur nous. Ils étaient là une demi-douzaine d’hommes armés.
En un instant, ils nous eurent terrassés, liés par les mains, poussés en avant, sans épargner les coups.
Une heure après, nous étions entre les mains des Autrichiens, établis à Longwé, puis enfermés et gardés à vue dans une maison du village.
![]()
![]() tait-ce le hasard seul qui avait mis Buch sur nos traces? J’inclinais à le croire, car, depuis quelque temps le hasard ne se montrait plus notre ami. Mais, par la suite, nous apprîmes ce que nous ne pouvions savoir alors: c’est que depuis notre dernière rencontre, le fils Buch n’avait cessé ses recherches, moins pour venger la mort de son frère, croyez-le bien, que pour gagner la prime de mille florins. S’il avait perdu nos traces à partir du jour où nous avions pris à travers l’Argonne, il les avait retrouvées au village de la Croix-aux-Bois. Il était de ces espions qui l’envahirent dans l’après-midi du 16. Chez les Stenger, il reconnut M. et Mlle de Lauranay, Mme Keller et ma soeur. Il apprit que nous venions de les quitter à l’instant. Nous ne pouvions être loin. Une demi-douzaine de coquins de son espèce se joignirent à lui. Tous se lancèrent à notre poursuite. On sait le reste.
tait-ce le hasard seul qui avait mis Buch sur nos traces? J’inclinais à le croire, car, depuis quelque temps le hasard ne se montrait plus notre ami. Mais, par la suite, nous apprîmes ce que nous ne pouvions savoir alors: c’est que depuis notre dernière rencontre, le fils Buch n’avait cessé ses recherches, moins pour venger la mort de son frère, croyez-le bien, que pour gagner la prime de mille florins. S’il avait perdu nos traces à partir du jour où nous avions pris à travers l’Argonne, il les avait retrouvées au village de la Croix-aux-Bois. Il était de ces espions qui l’envahirent dans l’après-midi du 16. Chez les Stenger, il reconnut M. et Mlle de Lauranay, Mme Keller et ma soeur. Il apprit que nous venions de les quitter à l’instant. Nous ne pouvions être loin. Une demi-douzaine de coquins de son espèce se joignirent à lui. Tous se lancèrent à notre poursuite. On sait le reste.
Maintenant, nous étions gardés de manière à défier toute évasion, en attendant que notre sort fut réglé – ce qui ne pouvait être ni long ni douteux – et, comme on dit, il n’y avait plus qu’à écrire à sa famille!
Tout d’abord j’examinai la chambre qui nous servait de prison. Elle occupait la moitié du rez-de-chaussée d’une maison basse. Deux fenêtres, opposées l’une à l’autre, l’éclairaient sur la rue, en avant, et sur une cour, en arrière.
C’est de cette maison, sans doute, que nous ne sortirions que pour être conduits à la mort.
M. Jean, sous la double accusation d’avoir frappé un officier, et déserté en temps de guerre; moi, accusé de complicité, et probablement d’espionnage en ma qualité de Français, on ne nous ferait pas languir.
Et j’entendis M. Jean murmurer:
«C’est la fin, cette fois!»
Je ne répondis rien. Je l’avoue, mon fonds de confiance habituelle avait reçu un fort ébranlement, et la situation me paraissait désespérée.
«Oui, la fin! répétait M. Jean. Et qu’importerait, si ma mère, si Marthe, si tous ceux que nous aimons étaient hors de danger! Mais, après nous, que deviendront-elles? Sont-elles encore dans ce village entre les mains des Autrichiens?…»
Et de fait, en admettant qu’elles n’eussent point été entraînées, une faible distance les séparait de nous. A peine compte-t-on une lieue et demie entre la Croix-aux-Bois et Longwé. Pourvu que la nouvelle de notre arrestation ne leur fût pas parvenue!
C’est à quoi je pensais, c’est ce que je craignais par dessus tout. C’eût été le coup de mort pour Mme Keller. Oui! J’en étais à désirer que les Autrichiens les eussent dirigées sur leurs avant-postes, au delà de l’Argonne. Pourtant, Mme Keller était à peine transportable, et si on l’obligeait à se remettre en route, si les soins lui manquaient!…
La nuit se passa, sans que notre situation se fût modifiée. Quelles tristes pensées vous envahissent le cerveau, quand la mort est si proche! C’est alors que toute notre vie repasse en un instant devant nos yeux!
Il faut ajouter que nous souffrions beaucoup de la faim, n’ayant vécu que de châtaignes depuis deux jours. On n’avait même pas songé à nous apporter de la nourriture. Eh, que diable! Nous valions mille florins à ce gueux de Buch, et il pouvait bien nous nourrir pour le prix!
Nous ne l’avions pas revu, il est vrai. Sans doute, il était allé prévenir les Prussiens de sa capture. Je pensais alors que cela prendrait peut-être quelque temps. C’étaient des Autrichiens qui nous gardaient, mais c’étaient des Prussiens qui devaient prononcer sur notre sort. Ou ils viendraient à la Croix-aux-Bois, ou on nous conduirait à leur quartier général. De là, des retards, à moins qu’il n’arrivât un ordre d’exécution à Longwé. Quoiqu’il en soit, il ne fallait pas nous laisser mourir de faim.
Au matin, la porte s’ouvrit vers sept heures. Un vivandier en blouse apportait une écuelle de soupe – de l’eau pour bouillon, ou à peu près, avec une miche de pain trempé. La quantité remplaçait la qualité. Nous n’avions pas le droit d’être difficiles, et, j’avais si faim, que je ne fis que tordre et avaler.
J’aurais voulu interroger ce vivandier, savoir de lui ce qui se passait à Longwé, surtout à la Croix-aux-Bois, si l’on parlait de l’approche des Prussiens, si leur intention était de prendre ce défilé pour traverser l’Argonne, enfin où en étaient les choses. Mais je ne savais pas assez d’allemand pour être compris ni pour comprendre. Et M. Jean, absorbé dans ses réflexions, gardait le silence. Je ne me serais pas permis de l’en tirer. Donc, impossible de pourparler avec cet homme-là.
Rien de nouveau ne se produisit pendant cette matinée. Nous étions gardés à vue. Cependant on nous permettait d’aller et de venir dans la petite cour, pu les Autrichiens nous examinaient avec plus de curiosité que de sympathie, on peut le croire. Moi, devant eux, je tenais à faire bonne contenance. Aussi, me promenais-je, les mains dans les poches, en sifflotant les plus joyeuses marches du Royal-Picardie.
Et n’aurais-je pas dû plutôt me dire:
«Va, va, siffle, pauvre merle en cage!… On te coupera bientôt le sifflet!»
A midi, nouvelle soupière de pain trempé. Il n’était pas varié, notre ordinaire, et j’en arrivais à regretter les châtaignes de l’Argonne. Il fallut bien s’en contenter. D’autant plus que cette espèce de coupeliards, ce vivandier avec sa face de fouine, avait l’air de dire: «C’est encore trop bon pour vous!»
Vrai Dieu! je lui aurais volontiers jeté l’écuelle à la tête! Mais mieux valait ne point perdre son bien, et se refaire des forces pour ne pas faiblir au dernier moment!
J’obtins même que M. Jean partageât avec moi ce maigre repas. Il comprit mes raisons et mangea un peu. Il pensait à tout autre chose. Son esprit était ailleurs, là bas, dans la maison de Hans Stenger, avec sa mère, avec sa fiancée. Il prononçait leur nom, il les appelait! Parfois, dans une sorte de délire, il s’élançait vers la porte comme pour aller les rejoindre! C’était plus fort que lui. Et alors il retombait. S’il ne pleurait pas, il n’en était que plus effrayant à voir, et des larmes l’auraient soulagé. Mais non! Et cela me déchirait le cœur.
Pendant ce temps, passaient des files de soldats, marchant sans ordre, l’arme à volonté, puis d’autres colonnes qui traversaient Longwé. Les trompettes se taisaient, les tambours aussi. L’ennemi se glissait sans bruit afin de gagner la ligne de l’Aisne. Il dut défiler là bien des milliers d’hommes. S’ils étaient Autrichiens ou Prussiens, c’est bien ce que j’aurais voulu savoir! Du reste, plus un seul coup de feu sur le revers occidental de l’Argonne. La porte de France était grande ouverte!… On ne la défendait même plus.
Vers dix heures du soir, une escouade de soldats parut dans notre chambre. Cette fois, c’étaient des Prussiens. Et, ce qui me coupa en deux, je reconnus l’uniforme du régiment de Leib, venu à Longwé après sa rencontre avec les volontaires dans l’Argonne.
On nous fit sortir, M. Jean et moi, après nous avoir attaché les mains derrière le dos.
M. Jean s’adressa au caporal qui commandait l’escouade.
«Où nous conduit-on!» dit-il.
Pour toute réponse, ce gueux nous mit dehors avec une bourrade. Nous avions bien l’air de pauvres diables qu’on allait exécuter sans jugement. Et, pourtant, moi, je n’avais pas été pris les armes à la main! Mais allez donc dire cela à ces espèces de barbares! Ils vous riraient au nez comme des uhlans!
Notre escouade suivit la rue de Longwé, qui descend vers la lisière de l’Argonne, et s’amorce un peu en dehors du village, à la route de Vouziers.
Au bout de cinq cents pas, on s’arrêta au milieu d’une clairière, où campait le régiment de Leib.
Quelques instants après, nous comparaissions devant le colonel von Grawert.
Il se contenta de nous regarder, ne prononça pas une seule parole. Puis, tournant les talons, il donna le signal du départ, et tout le régiment se mit en marche.
Je compris alors que l’on voulait nous faire passer devant un conseil de guerre, qu’on mettrait quelques formes à nous administrer douze balles dans la poitrine, que cela eût été fait, immédiatement, si le régiment fut resté à Longwé. Mais, paraît-il, les choses pressaient, et les coalisés n’avaient pas de temps à perdre, s’ils voulaient devancer les Français sur l’Aisne.
En effet, Dumouriez, ayant appris que les Impériaux étaient maîtres du défilé de la Croix-aux-Bois, venait de mettre à exécution un nouveau plan. Ce plan consistait à redescendre la lisière gauche de l’Argonne jusqu’à la hauteur du défilé des Islettes, afin de s’adosser à Dillon qui l’occupait. De cette façon, nos soldats feraient face aux colonnes de Clairfayt qui viendraient de la frontière, et aux colonnes de Brunswick qui se présenteraient du côté de la France. Il fallait s’attendre, en effet, à voir les Prussiens traverser l’Argonne, dès que le camp de Grand-Pré serait levé, afin de couper la route de Châlons.
Aussi Dumouriez avait-il évacué son quartier général, sans bruit, la nuit du 15 au 16. Après avoir franchi les deux ponts de l’Aisne, il vint s’arrêter avec ses troupes sur les hauteurs d’Autry, à quatre lieues de Grand-Pré. De là, malgré deux paniques qui mirent un instant le désordre parmi nos soldats, il continua vers Dammartin-sur-Hans, de manière à atteindre les positions de Sainte-Menehould, qui sont situées à l’extrémité du passage des Islettes.
En même temps, comme les Prussiens allaient déboucher de l’Argonne par le défilé de Grand-Pré, il prenait toutes ses précautions afin que le camp de l’Épine, assis sur la route de Châlons, ne pût être enlevé, au cas où l’ennemi l’eût attaqué, au lieu de se rabattre sur Sainte-Menehould.
A ce moment, les généraux Beurnonville, Chazot et Dubouquet recevaient l’ordre de rejoindre Dumouriez, et celui-ci pressait Kellerman, qui était parti de Metz, le 4, de hâter sa marche en avant.
Si tous ces généraux étaient exacts au rendez-vous, Dumouriez aurait avec lui plus de trente-cinq mille hommes, et il pourrait tenir tête aux Impériaux.
En effet, Brunswick et ses Prussiens avaient quelque temps hésité avant d’avoir définitivement arrêté leur plan de campagne. Enfin, ils se décidèrent à traverser Grand-Pré, à déboucher de l’Argonne, pour s’emparer de la route de Châlons, cerner l’armée française à Sainte-Menehould, et l’obliger à mettre bas les armes.
Voilà pourquoi le régiment de Leib avait si précipitamment quitté Longwé, et pourquoi nous remontions le cours de l’Aisne.
Il faisait un temps affreux, du brouillard, de la pluie. Les chemins étaient défoncés. La boue vous couvrait jusqu’à l’échine. De marcher ainsi, les bras liés, voilà qui est pénible! En vérité, on eût mieux fait de nous fusiller tout de suite!
Et les mauvais traitements que ces Prussiens ne nous épargnaient guère! Et les insultes qu’ils nous jetaient à la face! C’était pire que de la boue!
Et ce Frantz von Grawert qui, dix fois, vint nous affronter sous le nez! M. Jean ne pouvait se contenir. Les mains lui démangeaient, sous les cordes, de saisir le lieutenant par le cou, de l’étrangler comme une bête malfaisante!
On côtoya l’Aisne en cheminant à marche forcée. Il fallut passer, avec de l’eau à mi-jambe, les ruisseaux de la Dormoise, de la Tourbe et de la Bionne. On ne s’arrêtait pas, afin d’arriver à temps pour occuper les hauteurs de Sainte-Menehould. Mais la colonne ne pouvait aller vite. On s’embourbait fréquemment. Et, lorsque les Prussiens se trouveraient en face de Dumouriez, il était permis d’espérer que les Français seraient déjà adossés aux Islettes.
Nous allâmes ainsi jusqu’à dix heures du soir. Les vivres étaient à peine distribués, et, s’ils manquaient aux Prussiens, on juge ce qu’il pouvait en rester aux deux prisonniers qu’ils traînaient comme des bêtes!
M. Jean et moi, nous pouvions à peine nous parler. D’ailleurs, chaque propos échangé nous valait quelque bourrade. Ces gens-là sont véritablement d’une race cruelle. Sans doute, ils voulaient plaire au lieutenant, Frantz von Grawert, et ils n’y réussissaient que trop!
Cette nuit du 19 au 20 septembre fut une des plus pénibles que nous eussions passées jusqu’alors. C’était à regretter nos haltes sous les taillis de l’Argonne, quand nous n’étions encore que des fugitifs. Enfin, avant le jour, on avait atteint sur la gauche de Sainte-Menehould une sorte de terrain marécageux. Le campement y fut installé dans deux pieds de boue. Aucun feu n’avait été allumé, parce que les Prussiens ne voulaient pas signaler leur présence.
Une odeur infecte s’élevait de cette masse d’hommes entassés. Comme on dit, on en aurait plus pris avec le nez qu’avec une pelle!
Enfin le jour reparut, – ce jour où se livrerait, sans doute, la bataille. Le Royal-Picardie était là peut-être, et je ne serais pas dans le rang, au milieu de mes camarades!
Il se faisait un grand mouvement d’allées et venues à travers le cantonnement. Des estafettes, des aides de camp, traversaient à chaque instant le marécage. Les tambours battaient, les trompettes sonnaient. On entendait aussi quelques coups de feu sur la droite…
Enfin! Les Français avaient devancé les Prussiens à Sainte-Menehould!
Il était près de onze heures, quand une escouade de soldats vint nous chercher, M. Jean et moi. Tout d’abord, on nous conduisit devant une tente où siégeaient une demi-douzaine d’officiers, présidés par le colonel von Grawert. Oui! il présidait ce conseil de guerre en personne!
Ce ne fut pas long. Simple formalité pour établir notre identité. D’ailleurs, Jean Keller, déjà condamné à mort pour avoir frappé un officier, le fut une seconde fois comme déserteur, et moi, comme espion français!
Il n’y avait pas à discuter, et, lorsque le colonel eut ajouté que l’exécution aurait lieu sur l’heure:
«Vive la France! m’écriai-je.
– Vive la France!» répéta Jean Keller.
![]()
![]() ette fois, c’était bien fini. On peut dire que les fusils étaient déjà braqués sur nous! Il n’y avait plus à attendre que le commandement de feu! Eh bien, Jean Keller et Natalis Delpierre sauraient mourir.
ette fois, c’était bien fini. On peut dire que les fusils étaient déjà braqués sur nous! Il n’y avait plus à attendre que le commandement de feu! Eh bien, Jean Keller et Natalis Delpierre sauraient mourir.
En dehors de la tente, se trouvait le peloton, qui devait nous fusiller, – une douzaine d’hommes du régiment de Leib sous les ordres d’un lieutenant.
On ne nous avait pas rattaché les mains. A quoi bon? Nous ne pouvions fuir. Quelques pas sans doute, et là, contre un mur ou au pied d’un arbre, nous tomberions sous les balles prussiennes! Ah! que n’aurais-je donné pour mourir en pleine bataille, frappé de vingt coups de sabre, ou coupé en deux d’un boulet! Recevoir la mort sans pouvoir se défendre, c’est dur!
Nous deux M. Jean marchions silencieusement. Lui pensait à Marthe qu’il ne verrait plus, à sa mère que ce dernier coup allait tuer.
Moi, je songeais à ma sœur Irma, à mon autre sœur Firminie, à tout ce qui restait de notre famille!… Je revoyais mon père, ma mère, mon village, tous les êtres que j’aimais, mon régiment, mon pays…
Ni l’un ni l’autre, nous ne regardions où nous menaient les soldats. D’ailleurs, que ce fût là ou ici, peu importait! Il fallait être tué comme des chiens! Ah! quelle rage!
Évidemment, puisque je vous fais moi-même ce récit, puisque je l’ai écrit de ma main, c’est que j’en suis réchappé. Mais, ce qu’allait être le dénouement de cette histoire, quand j’aurais eu toute l’invention d’un conteur, il m’eût été impossible de l’imaginer. Vous le verrez bientôt.
A une cinquantaine de pas plus loin, il fallut passer à travers le régiment de Leib. Tous connaissaient Jean Keller. Eh bien, il n’y eut même pas un sentiment de pitié pour lui – cette pitié qu’on ne refuse jamais à ceux qui vont mourir! Quelles natures! Ils étaient bien dignes, ces Prussiens, d’être commandés par des Grawert! Le lieutenant nous vit. Il regarda M. Jean, qui lui rendit son regard. Chez l’un, c’était la satisfaction d’une haine qui va s’assouvir, chez l’autre, c’était du mépris…
Un instant, je crus que ce misérable allait nous accompagner. En vérité, je me demandais s’il ne tiendrait pas à commander lui-même le feu! Mais un appel de trompette se fit entendre… Il se perdit au milieu des soldats.
Nous tournions alors une des hauteurs que le duc de Brunswick était venu occuper. Ces hauteurs qui dominent la petite ville et l’entourent sur un circuit de trois quarts de lieue, s’appellent les collines de la Lune. C’est à leur pied que passe la route de Châlons. Quant aux Français, ils s’étageaient sur les croupes avoisinantes.
Au-dessous se déployaient de nombreuses colonnes, prêtes à gravir nos positions, de manière à dominer Sainte-Menehould. Si les Prussiens y réussissaient, Dumouriez serait très compromis, en présence d’un ennemi supérieur par le nombre, et qui pourrait l’accabler de ses feux.
Avec un temps clair, j’aurais pu apercevoir les uniformes français sur les hauteurs. Mais tout disparaissait encore au milieu d’une brume épaisse, que le soleil n’avait pu dissiper. On entendait déjà quelques détonations, et c’est à peine si on pouvait en apercevoir les lueurs.
Le croirait-on! Il me restait un espoir, ou plutôt, je me forçais de ne point désespérer.
Et cependant, quelle apparence qu’un secours pût nous venir du côté où l’on nous menait? Toutes les troupes, appelées par Dumouriez, n’étaient-elles pas sous sa main autour de Sainte-Menehould? Que voulez-vous? On a tellement envie d’échapper à la mort que l’on se fait de ces idées-là!
Il était environ onze heures et quart. Le midi du 20 septembre ne sonnerait jamais pour nous!
En effet, nous étions arrivés. L’escouade venait de quitter la grande route de Châlons, sur la gauche. Le brouillard était encore assez épais pour que les objets ne fussent pas visibles à quelques centaines de pieds. On sentait, cependant, qu’il ne tarderait pas à se fondre au soleil.
Nous étions entrés dans un petit bois, désigné pour le lieu d’exécution et dont nous ne devions plus sortir.
Au loin s’entendaient des roulements de tambours, des éclats de trompette, auxquels se mêlaient des détonations d’artillerie, des pétillements de feux de file et de peloton.
Je cherchais à me rendre compte de ce qui se passait, comme si cela eût dû m’intéresser en un pareil moment! J’observais que ces bruits de bataille venaient de la droite et qu’ils semblaient se rapprocher. Y avait-il donc un engagement sur la route de Châlons? Une colonne était-elle sortie du camp de l’Épine pour prendre les Prussiens de flanc? Je ne me l’expliquais pas.
Si je vous raconte ceci avec une certaine précision, c’est que je tiens à vous faire connaître quel était alors l’état de mon esprit. Quant aux détails, ils sont restés gravés dans ma mémoire. D’ailleurs, on n’oublie pas des choses pareilles. Pour moi, c’est comme si c’était hier!
Nous venions d’entrer dans le petit bois. Au bout d’une centaine de pas, l’escouade s’arrêta devant un abatis d’arbres.
C’était à cette place que M. Jean et moi nous devions être passés par les armes.
L’officier qui commandait – un homme à face dure – fit faire halte. Les soldats se rangèrent de côté, et j’entends encore les crosses de leurs fusils qui résonnèrent sur le sol, lorsqu’ils mirent l’arme au pied.
«C’est ici, dit l’officier.
– Bien!.» répondit Jean Keller.
Il répondit cela d’une voix ferme, le front haut, le regard assuré.
Et, alors, s’approchant de moi, il me parla dans cette langue française qu’il aimait tant, et que j’allais entendre pour la dernière fois.
«Natalis, me dit-il, nous allons mourir! Ma dernière pensée sera pour ma mère, pour Marthe qu’après elle, j’aimais le plus au monde! Les pauvres femmes! Que le ciel les prenne en pitié! Quant à vous, Natalis, pardonnez-moi…
– Que je vous pardonne, monsieur Jean?
– Oui, puisque c’est moi qui…
– Monsieur Jean! répondis-je, je n’ai rien à vous pardonner. Ce que j’ai fait a été fait librement, et je le ferais encore! Laissez-moi vous embrasser, et mourons tous deux en braves!»
Nous tombâmes dans les bras l’un de l’autre.
Et je n’oublierai jamais quelle fut l’attitude de Jean Keller, lorsque, se retournant vers l’officier, il lui dit d’une voix qui ne tremblait pas:
«A vos ordres!»
L’officier fit un signe. Quatre soldats se détachèrent du peloton, nous poussèrent par le dos, et nous conduisirent tous deux au pied du même arbre. Nous devions être frappés du même coup et tomber ensemble… Eh bien, j’aimais mieux cela!
Je me rappelle que cet arbre était un hêtre. Je le vois encore avec tout un pan d’écorce pelé. Le brouillard commençait à se dissiper. Les autres arbres sortaient des brumes.
M. Jean et moi, nous étions debout, la main dans la main, regardant le peloton en face.
L’officier s’écarta un peu. Le craquement des batteries qu’on armait m’entra dans l’oreille. Je serrais la main de Jean Keller, et je vous jure qu’elle ne tremblait pas dans la mienne!
Les fusils furent remontés à la hauteur de l’épaule. A un premier commandement, ils s’abaisseraient. A un second, ils feraient feu, et tout serait fini.
Soudain, des cris éclatent sous le bois, derrière l’escouade des soldats.
Dieu du ciel! Que vois-je?… Mme Keller, soutenue par Mlle Marthe et par ma sœur Irma. Sa voix pouvait à peine se faire entendre. Sa main agitait un papier, et Mlle Marthe, ma sœur, M. de Lauranay répétaient avec elle:
«Français!… Français!»
En cet instant, une formidable détonation retentit, et j’aperçus Mme Keller qui s’affaissait.
Ni M. Jean ni moi, n’étions tombés, cependant. Ce n’étaient donc pas les soldats du peloton qui avaient tiré?…
Non! Une demi-douzaine d’entre eux gisaient sur le sol, tandis que l’officier et les autres s’enfuyaient à toutes jambes.
En même temps, de divers côtés, à travers le bois partaient ces cris que j’entends encore:
«En avant! En avant!»
C’était bien le cri français, et non le rauque «vorwaertz!» des Prussiens!
Un détachement de nos soldats, s’étant jeté hors de la route de Châlons, venait d’arriver dans le bois, au bon moment, j’ose le dire! Leurs coups de feu avaient précédé, de quelques secondes seulement, ceux que le peloton allait tirer… Cela avait suffi. Maintenant, comment nos braves compatriotes s’étaient-ils trouvés là si à propos?… Je devais ne le savoir que plus tard.
M. Jean avait bondi du côté de sa mère que Mlle Marthe et ma sœur soutenaient entre leurs bras. La malheureuse femme, croyant que cette détonation venait de nous donner le coup de mort, était tombée sans connaissance.
Mais, sous les baisers de son fils, elle se ranimait, elle revenait à elle, et ces mots s’échappaient encore de sa bouche avec un accent que je n’oublierai de ma vie:
«Français!… Il est Français!»
Que voulait-elle dire? Je m’étais tourné vers M. de Lauranay… Il ne pouvait parler.
Mlle Marthe saisit alors le papier que Mme Keller tenait dans sa main, encore serré comme celle d’une morte, et elle le tendit à M. Jean.
Je le vois encore ce papier. C’était un journal allemand, le Zeitblatt.
M. Jean l’avait pris. Il le lisait. Des larmes coulaient de ses yeux. Dieu du ciel! Qu’on est heureux de savoir lire en des occasions pareilles!
Et alors, le même mot sortit de ses lèvres. Il se relevait. Il avait l’air d’un homme qui serait devenu fou subitement. Ce qu’il disait, je ne pouvais le comprendre, tant sa voix était étranglée par l’émotion.
«Français!… Je suis Français!… s’écriait-il. Ah! ma mère!… Marthe… Je suis Français!…»
Puis, il tomba à genoux dans un élan de reconnaissance envers Dieu.
Mais Mme Keller venait de se redresser à son tour, disant:
«Maintenant, Jean, on ne te forcera plus à te battre contre la France!
– Non, mère!… C’est maintenant mon droit et mon devoir de me battre pour elle!»
![]()
![]() . Jean m’avait entraîné, sans avoir pris le temps de s’expliquer. Nous nous étions joints aux Français qui s’élançaient hors du bois, et nous marchions au canon, qui commençait à rouler en fracas continu.
. Jean m’avait entraîné, sans avoir pris le temps de s’expliquer. Nous nous étions joints aux Français qui s’élançaient hors du bois, et nous marchions au canon, qui commençait à rouler en fracas continu.
J’essayais en vain de réfléchir. Comment, Jean Keller, fils de M. Keller, allemand d’origine, était Français? Comprenais pas! Tout ce que je puis dire, c’est qu’il allait se battre comme s’il l’était, et moi avec!
Il faut raconter maintenant quels événements avaient marqué cette matinée du 20 septembre, et comment un détachement de nos soldats s’était trouvé si à propos dans le petit bois qui borde la route de Châlons.
On s’en souvient, dans la nuit du 16, Dumouriez avait fait détendre le camp de Grand-Pré pour se porter sur les positions de Sainte-Menehould, où il était arrivé le lendemain, après une marche de quatre à cinq lieues.
Devant Sainte-Menehould s’arrondissent différentes hauteurs, séparées par de profonds ravins.
Leur pied est défendu par des fondrières et des marécages, formés par l’Aure jusqu’à l’endroit où cette rivière se jette dans l’Aisne.
Ces hauteurs sont, à droite, celles de l’Hyron, situées en face des collines de la Lune, à gauche, celles de Gizaucourt. Entre elles et Sainte-Menehould s’étend une sorte de bassin marécageux que traverse la route de Châlons. A sa surface, ce bassin est accidenté de quelques mamelons de moindre importance, – entre autres celui du moulin de Valmy, qui domine le village de ce nom, devenu si célèbre depuis le 20 septembre 1792.
Dès son arrivée, Dumouriez occupa Sainte-Menehould. Dans cette attitude, il s’appuyait au corps de Dillon, prêt à défendre le défilé des Islettes contre toute colonne, autrichienne ou prussienne, qui voudrait prendre l’Argonne à revers. Là, les soldats de Dumouriez, bien pourvus de vivres, firent fête à leur général, dont la discipline était très sévère. Et elle se montra telle, en effet, contre les volontaires venus de Châlons, qui, pour la plupart, ne valaient pas la corde pour les pendre.
Cependant Kellermann, après l’abandon du camp de Grand-Pré, avait fait un mouvement de recul. Aussi, le 19, était-il encore à deux lieues de Sainte-Menehould, quand Beurnonville s’y trouvait déjà avec neuf mille hommes de l’armée auxiliaire du camp de Maulde.
Dans la pensée de Dumouriez, Kellermann devait s’établir sur les hauteurs de Gizaucourt, qui dominent celles de la Lune, vers lesquelles se dirigeaient les Prussiens. Mais l’ordre ayant été mal compris, ce fut le plateau de Valmy que vint occuper Kellermann avec le général Valence et le duc de Chartres, lequel, à la tête de douze bataillons d’infanterie et de douze escadrons d’artillerie, se distingua particulièrement dans cette bataille.
Entre temps, Brunswick arrivait avec l’espoir de couper la route de Châlons et de repousser Dillon hors du défilé des Islettes. Sainte-Menehould une fois entourée par quatre-vingt mille hommes, auxquels s’était jointe la cavalerie des émigrés, force serait bientôt à Dumouriez et à Kellermann de se rendre.
Et cela était à craindre, puisque les hauteurs de Gizaucourt n’étaient pas au pouvoir des Français, comme l’avait voulu Dumouriez. En effet, si les Prussiens, déjà maîtres des collines de la Lune, s’emparaient des collines de Gizaucourt, leur artillerie pourrait foudroyer toutes les positions françaises.
C’est bien ce que comprit le roi de Prusse. C’est pourquoi, au lieu de se porter sur Châlons, malgré l’avis de Brunswick, donna-t-il l’ordre d’attaquer, espérant jeter Dumouriez et Kellermann dans les fondrières de Sainte-Menehould.
Vers onze heures et demie du matin, les Prussiens commencèrent à descendre les collines de la Lune, en bel ordre, et ils s’arrêtèrent à mi-côte.
C’est à ce moment, c’est-à-dire au début de la bataille, qu’une colonne prussienne se rencontra sur la route de Châlons avec l’arrière-garde de Kellermann, dont quelques compagnies s’étant jetées à travers le petit bois, mirent en fuite le peloton prussien qui allait nous fusiller.
Maintenant, nous deux M. Jean, nous étions au plus fort de la mêlée, là où précisément j’avais retrouvé mes camarades de Royal-Picardie.
«Delpierre?… s’était écrié un des officiers de mon escadron, en m’apercevant au moment où les boulets commençaient à labourer nos rangs.
– Présent, mon capitaine! répondis-je.
– Eh! te voilà revenu à temps!
– Comme vous voyez, pour me battre!
– Mais tu es à pied?…
– Eh bien, mon capitaine, je me battrai à pied, et je n’en ferai pas plus mauvaise besogne!»
On nous avait donné des armes à M. Jean et à moi, chacun un fusil et un sabre. Les buffleteries se croisaient sur nos vêtements en lambeaux, et, si nous n’avions pas d’uniforme, c’est que le tailleur du régiment n’avait pas eu le temps de nous prendre mesure!
Je dois dire que les Français furent repoussés au début de l’action; mais les carabiniers du général Valence accoururent et rétablirent l’ordre un instant troublé.
Et, pendant ce temps, le brouillard, déchiré par les décharges de l’artillerie, s’était dissipé. On se battait en plein soleil. Dans l’espace de deux heures, vingt mille coups de canon s’échangèrent entre les hauteurs de Valmy et celles de la Lune. – On a dit vingt mille?… Bon!… Mettons vingt et un mille, et n’en parlons plus! En tout cas, suivant le proverbe, mieux valait entendre cela que d’être sourd!
En ce moment, la place près du moulin de Valmy était difficile à tenir. Les boulets raclaient des files entières. Le cheval de Kellermann venait d’être éventré. Non seulement les collines de la Lune appartenaient aux Prussiens, mais ils allaient s’emparer de celle de Gizaucourt. Nous avions bien, il est vrai, celles de l’Hyron, dont Clairfayt cherchait à se rendre maître avec vingt-cinq mille Autrichiens, et, s’il y réussissait, les Français seraient foudroyés de flanc et de front.
Dumouriez vit ce danger. Il envoya Stengel avec seize bataillons, afin de repousser Clairfayt, et Chazot, de manière à occuper Gizaucourt avant les Prussiens. Chazot arriva trop tard. La place était prise, et Kellermann fut réduit à se défendre dans Valmy contre une artillerie qui le broyait de toutes parts. Un caisson éclata près du moulin. Ce fut un moment de désordre. Nous étions là, M. Jean et moi, avec l’infanterie française, et c’est miracle que nous n’avions pas été tués.
Ce fut alors que le duc de Chartres accourut avec une réserve d’artillerie et put répondre heureusement au canon de la Lune et de Gizaucourt.
Toutefois, l’affaire allait devenir plus chaude encore. Les Prussiens, rangés sur trois colonnes, montaient à l’assaut du moulin de Valmy pour nous en déloger et nous jeter dans le marécage.
Je vois encore Kellermann et je l’entends aussi. Il donna l’ordre de laisser arriver l’ennemi jusqu’à la crête, avant de foncer dessus. On est prêt, on attend. Il n’y a plus qu’à sonner la charge.
Et alors, au bon moment, ce cri s’échappe de la bouche de Kellermann:
«Vive la nation!
– Vive la nation!» répondîmes-nous.
Et cela fut crié avec une telle force que les décharges de l’artillerie n’empêchèrent pas de l’entendre.
Les Prussiens étaient arrivés à la crête du mamelon. Avec leurs colonnes bien en ligne, leur pas cadencé, le sang-froid qu’ils montraient, ils étaient terribles à affronter. Mais l’élan français l’emporta. On se jeta sur eux. La mêlée fut horrible, et, de part et d’autre, l’acharnement effroyable.
Tout à coup, au milieu de la fumée des coups de feu qui éclataient autour de nous, je vis Jean Keller s’élancer le sabre haut. Il avait reconnu un des régiments prussiens que nous commencions à rejeter sur les pentes de Valmy.
C’était le régiment du colonel von Grawert. Le lieutenant Frantz se battait avec un grand courage, car ce n’est pas le courage qui manque aux officiers allemands.
M. Jean et lui se trouvèrent face à face.
Le lieutenant devait croire que nous étions tombés sous les balles prussiennes, et il nous retrouvait là! On juge s’il dut être stupéfait! Mais à peine eut-il le temps de se reconnaître. D’un bond, M. Jean se jeta sur lui, et, du revers de son sabre, il lui fendit la tête…
Le lieutenant tomba mort, et j’ai toujours pensé que cela était juste qu’il fût frappé de la main même de Jean Keller!
Cependant les Prussiens cherchaient toujours à conquérir le plateau. Ils attaquaient avec une vigueur extraordinaire. Mais nous les valions bien, et vers deux heures après-midi, ils durent cesser leurs feux et redescendre dans la plaine.
La bataille n’était que suspendue, pourtant. A quatre heures, le roi de Prusse, marchant en tête, reforma trois colonnes d’attaque avec ce qu’il avait de meilleur en infanterie et en cavalerie. Alors, une batterie de vingt-quatre pièces, établie au pied du moulin, foudroya les Prussiens avec une telle violence, qu’ils ne purent gravir les pentes balayées par les boulets. Puis, la nuit venant, ils se retirèrent.
Kellermann était resté maître du plateau, et le nom de Valmy courait la France, le jour même où la Convention, tenant sa seconde séance, décrétait la République.
![]()
![]() ous sommes arrivés au dénouement de ce récit, que j’aurais pu intituler: Histoire d’un congé en Allemagne.
ous sommes arrivés au dénouement de ce récit, que j’aurais pu intituler: Histoire d’un congé en Allemagne.
Le soir même, dans une maison du village de Valmy, Mme Keller, M. et Mlle de Lauranay, ma sœur Irma, M. Jean et moi, on se retrouvait tous ensemble.
Quelle joie ce fut de se revoir, après tant d’épreuves! Ce qui se passa entre nous, on le devine.
«Minute! dis-je alors. Je ne suis pas curieux, et, pourtant, de rester ainsi le bec dans l’eau!… Je voudrais bien comprendre…
– Comment il se fait, Natalis, que Jean soit ton compatriote? répondit ma sœur.
– Oui, Irma, et cela me paraît si singulier que vous avez dû faire erreur…
– On ne commet pas de ces erreurs-là, mon brave Natalis!» répliqua M. Jean.
Et voilà ce qui me fut raconté en quelques mots.
Au village de la Croix-aux-Bois où nous avions laissé M. de Lauranay et ses compagnes; gardées à vue dans la maison de Hans Stenger, les Autrichiens ne tardèrent pas à être remplacés par une colonne prussienne. Cette colonne comptait dans ses rangs un certain nombre de jeunes gens que la levée du 31 juillet avait arrachés à leurs familles.
Parmi ces jeunes gens se trouvait un brave garçon, nommé Ludwig Pertz, qui était de Belzingen. Il connaissait Mme Keller et vint la voir, quand il apprit qu’elle était prisonnière des Prussiens. On lui raconta alors ce qui était arrivé à M. Jean, et comment il avait dû prendre la fuite à travers les bois de l’Argonne.
Et alors, voilà Ludwig Pertz de s’écrier:
«Mais votre fils n’a plus rien à craindre, madame Keller!… On n’avait pas le droit de l’incorporer!… Il n’est pas Prussien!… Il est Français!»
On juge de l’effet que produisit cette déclaration. Et quand Ludwig Pertz fut mis en demeure de justifier son dire, il présenta à Mme Keller un numéro du Zeitblatt.
Cette gazette rapportait le jugement qui venait d’être rendu à la date du 17 août dans l’affaire Keller contre l’État. La famille Keller était déboutée de sa demande, par ce motif que la commission des fournitures ne devait être accordée qu’à un Allemand d’origine prussienne. Or, il avait été établi que les ancêtres de M. Keller n’avaient jamais demandé ni obtenu de naturalisation depuis leur établissement dans la Gueldre, après la révocation de l’Édit de Nantes, que ledit Keller n’avait jamais été prussien, qu’il avait toujours été français, et que, par conséquent, il ne lui était rien dû par l’État.
En voilà un, de jugement! Que M. Keller fût resté français, cela ne faisait plus doute! Mais ce n’était pas une raison pour ne point lui payer son dû! Enfin, voilà comment on jugeait à Berlin en 1792. Je vous prie de croire que M. Jean ne songeait point à en rappeler. Il tenait son procès pour perdu, bien perdu. Ce qui était indiscutable, c’est que, né d’un père et d’une mère français, il était tout ce qu’il y avait de plus français au monde! Et s’il lui fallait un baptême pour cela, il venait de le recevoir à la bataille de Valmy – ce baptême du feu qui en vaut bien un autre!
On le comprend, après la communication de Ludwig Pertz, il importait de retrouver M. Jean à tout prix. Précisément, on venait d’apprendre à la Croix-aux-Bois qu’il avait été pris dans l’Argonne, conduit à Longwé, puis emmené au camp prussien avec votre serviteur. Il n’y avait pas une heure à perdre. Mme Keller retrouva des forces en présence du danger qui menaçait son fils. Après le départ de la colonne autrichienne, accompagnée de M. de Lauranay, de Mlle Marthe, de ma sœur, et guidée par l’honnête Hans Stenger, elle quitta la Croix-aux-Bois, traversa le défilé, et arriva aux cantonnements de Brunswick, le matin même où on allait nous fusiller. Nous venions de sortir de cette tente où s’était tenu le conseil de guerre, quand elle s’y présenta.
En vain réclama-t-elle, en s’appuyant sur ce jugement qui faisait un Français de Jean Keller. On la repoussa. Elle se jeta alors sur la route de Châlons, du côté où on nous entraînait… On sait ce qui arriva.
Enfin, quand tout s’arrange pour que les braves gens soient heureux, lorsqu’ils sont si dignes de l’être, on reconnaîtra avec moi que Dieu fait bien les choses!
Quant à la situation des Français après Valmy, voici ce que j’ai à dire en quelques mots.
Tout d’abord, pendant la nuit, Kellermann fit occuper les hauteurs de Gizaucourt, – ce qui assurait définitivement les positions de toute l’armée.
Cependant les Prussiens nous avaient coupés de la route de Châlons, et on ne pouvait plus communiquer avec les dépôts. Mais, comme nous étions maîtres de Vitry, les convois purent toujours arriver, et l’armée n’eut point à souffrir au campement de Sainte-Menehould.
Les armées ennemies restèrent sur leurs cantonnements jusqu’aux derniers jours de septembre. Des pourparlers avaient eu lieu, qui n’avaient point abouti. Toutefois, dans le camp prussien, on avait hâte de repasser la frontière. Les vivres manquaient, la maladie faisait de grands ravages, si bien que le duc de Brunswick décampa le 1er octobre.
Il faut dire que, pendant que les Prussiens reprenaient les défilés de l’Argonne, on leur fit la conduite, pas trop vivement. On les laissait battre en retraite, sans les presser. Pourquoi? Je l’ignore. Ni moi ni bien d’autres n’ont rien compris à l’attitude de Dumouriez en cette circonstance.
Sans doute, il y avait de la politique là-dessous, et, je le répète, je n’entends goutte à la politique.
L’important était que l’ennemi eût repassé la frontière. Cela fut fait lentement, mais cela fut fait, et il n’y eut plus un seul Prussien en France, – pas même M. Jean, puisqu’il était bel et bien notre compatriote.
Dès que le départ fut possible, au milieu de la première semaine d’octobre, nous revînmes tous ensemble dans ma chère Picardie, où le mariage de Jean Keller et de Marthe de Lauranay fut enfin célébré. On s’en souvient, je devais être le témoin de M. Jean à Belzingen, et on ne sera pas surpris que je l’aie été à Saint-Sauflieu. Et si union fut assurée d’être heureuse, c’est bien celle-là, ou il n’y en aura jamais.
Pour moi, je rejoignis mon régiment quelques jours après. J’appris à lire, à écrire, et devins, comme je l’ai dit, lieutenant, puis capitaine pendant les guerres de l’Empire.
Voilà mon histoire, que j’ai rédigée pour mettre fin aux discussions de mes amis de Grattepanche. Si je n’ai pas parlé comme un livre d’église, j’ai du moins raconté les choses comme elles ont eu lieu. Et maintenant, lecteurs, permettez que je vous salue de mon épée.
Natalis DELPIERRE, Capitaine de cavalerie en retraite.
FIN