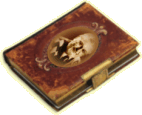Jules Verne
NORD CONTRE SUD
(Chapitre XIII-XVI)
85 dessins par Benett et une carte
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
Une vie double
![]() uelques mots suffiront à expliquer ce qui, jusqu’ici, a parue inexplicable dans cette histoire. On verra ce que peuvent imaginer certains hommes, quand leur mauvaise nature, aidée d’une réelle intelligence, les pousse dans la voie du mal.
uelques mots suffiront à expliquer ce qui, jusqu’ici, a parue inexplicable dans cette histoire. On verra ce que peuvent imaginer certains hommes, quand leur mauvaise nature, aidée d’une réelle intelligence, les pousse dans la voie du mal.
Ces hommes, devant lesquels Zermah venait subitement d’apparaître, étaient deux frères, deux jumeaux.
Où étaient-ils nés? Eux-mêmes ne le savaient pas au juste. Dans quelque petit village du Texas, sans doute – d’où ce nom de Texar, par changement de la dernière lettre du mot. On sait ce qu’est ce vaste territoire, situé au sud des États-Unis, sur le golfe du Mexique.
Après s’être révolté contre les Mexicains, le Texas, soutenu par les Américains dans son œuvre d’indépendance, s’annexa à la fédération en 1845, sous la présidence de John Tyler.
C’était, quinze ans avant cette annexion, que deux enfants abandonnés furent trouvés dans un village du littoral texien, recueillis, élevés par la charité publique.
L’attention avait été tout d’abord attirée sur ces deux enfants à cause de leur merveilleuse ressemblance. Même geste, même voix, même attitude, même physionomie, et, faut-il ajouter, mêmes instincts qui témoignaient d’une perversité précoce. Comment furent-ils élevés, dans quelle mesure reçurent-ils quelque instruction, on ne peut le dire, ni à quelle famille ils appartenaient. Peut-être, à l’une de ces familles nomades qui coururent le pays après la déclaration d’indépendance.
Dès que les frères Texar, pris d’un irrésistible désir de liberté, crurent pouvoir se suffire à eux-mêmes, ils disparurent. Ils comptaient vingt-quatre ans à eux deux. Dès lors, à n’en pas douter, leurs moyens d’existence furent uniquement le vol dans les champs, dans les fermes, ici du pain, là des fruits, en attendant le pillage à main armée et les expéditions de grande route, auxquels ils s’étaient préparés dès l’enfance.
Bref, on ne les revit plus dans les villages et hameaux texiens qu’ils avaient l’habitude de fréquenter, en compagnie de malfaiteurs qui exploitaient déjà leur ressemblance.
Bien des années s’écoulèrent. Les frères Texar furent bientôt oubliés, même de nom. Et, quoique ce nom dût avoir, plus tard, un déplorable retentissement en Floride, rien ne vint révéler que tous deux eussent passé leur premier âge dans les provinces littorales du Texas.
Comment en eût-il été autrement, puisque depuis leur disparition, par suite d’une combinaison dont il va être parlé, jamais on ne connut deux Texar? C’est même sur cette combinaison qu’ils avaient échafaudé toute une série de forfaits qu’il devait être si difficile de constater et de punir.
Effectivement, – on l’apprit plus tard, lorsque cette dualité fut découverte et matériellement établie, – pendant un certain nombre d’années, de vingt à trente ans, les deux frères vécurent séparés. Ils cherchaient la fortune par tous les moyens. Ils ne se retrouvaient qu’à de rares intervalles, à l’abri de tout regard, soit en Amérique, soit dans quelque autre partie du monde où les avait entraînés leur destinée.
On sut aussi que l’un ou l’autre, – lequel, on n’aurait pu le dire, peut-être tous les deux, – firent le métier de négriers. Ils transportaient ou plutôt faisaient transporter des cargaisons d’esclaves des côtes d’Afrique aux États du sud de l’Union. Dans ces opérations, ils ne remplissaient que le rôle d’intermédiaires entre les traitants du littoral et les capitaines des bâtiments employés à ce trafic inhumain.
Leur commerce prospéra-t-il? On ne sait. Pourtant, c’est peu probable. En tout cas, il diminua dans une proportion notable, et s’interrompit finalement, lorsque la traite, dénoncée comme un acte barbare, fut peu à peu abolie dans le monde civilisé. Les deux frères durent même renoncer à ce genre de trafic.
Cependant, cette fortune après laquelle ils couraient depuis si longtemps, qu’ils voulaient acquérir à tout prix, cette fortune n’était pas faite, et il fallait la faire. C’est alors que ces deux aventuriers résolurent de mettre à profit leur extraordinaire ressemblance.
En pareil cas, il arrive le plus souvent que ce phénomène se modifie lorsque les enfants sont devenus des hommes.
Pour les Texar, il n’en fut pas ainsi. A mesure qu’ils prenaient de l’âge, leur ressemblance physique et morale, on ne dira pas s’accentuait, mais restait ce qu’elle avait été – absolue. Impossible de distinguer l’un de l’autre, non seulement par les traits du visage ou la conformation du corps, mais aussi par les gestes ou les inflexions de la voix.
Les deux frères résolurent d’utiliser cette particularité naturelle pour accomplir les actes les plus détestables, avec la possibilité, si l’un d’eux était accusé, de pouvoir établir un alibi de nature à prouver son innocence. Aussi, pendant que l’un exécutait le crime convenu entre eux, l’autre se montrait-il publiquement en quelque lieu, de façon que, grâce à l’alibi, la non-culpabilité fût démontrée ipso facto.
Il va sans dire que toute leur adresse devait s’ingénier à ne jamais se laisser arrêter en flagrant délit. En effet, l’alibi n’aurait pu être invoqué, et la machination n’eût pas tardé à être découverte.
Le programme de leur vie ainsi arrêté, les deux jumeaux vinrent en Floride, où ni l’un ni l’autre n’étaient connus encore. Ce qui les y attirait, c’étaient les nombreuses occasions que devait offrir un État où les Indiens soutenaient toujours une lutte acharnée contre les Américains et les Espagnols.
Ce fut vers 1850 ou 1851 que les Texar apparurent dans la péninsule floridienne. C’est Texar, non les Texar qu’il convient de dire. Conformément à leur programme, jamais ils ne se montrèrent à la fois, jamais on ne les rencontra le même jour dans le même lieu, jamais on n’apprit qu’il existât deux frères de ce nom.
D’ailleurs, en même temps qu’ils couvraient leur personne du plus complet incognito, ils avaient rendu non moins mystérieux le lieu habituel de leur retraite.
On le sait, ce fut au fond de la Crique-Noire qu’ils se réfugièrent. L’îlot central, le blockhaus abandonné, ils les découvrirent pendant une exploration qu’ils faisaient sur les rives du Saint-John. C’est là qu’ils emmenèrent quelques esclaves, auxquels leur secret n’avait point été révélé. Seul, Squambô connaissait le mystère de leur double existence. D’un dévouement à toute épreuve pour les deux frères, d’une discrétion absolue sur tout ce qui les touchait, ce digne confident des Texar était l’exécuteur impitoyable de leurs volontés.
Il va sans dire que ceux-ci ne paraissaient jamais ensemble à la Crique-Noire. Lorsqu’ils avaient à causer de quelque affaire, ils s’avertissaient par correspondance. On a vu qu’à cet effet, ils n’employaient pas la poste. Un billet glissé dans les nervures d’une feuille, cette feuille fixée à la branche d’un tulipier qui croissait dans le marais voisin de la Crique-Noire, il ne leur en fallait pas plus. Chaque jour, non sans précautions, Squambô se rendait au marais. S’il était porteur d’une lettre écrite par celui des Texar qui était à la Crique-Noire, il l’accrochait à la branche du tulipier. Si c’était l’autre frère qui avait écrit, l’Indien prenait sa lettre à l’endroit convenu et la rapportait au fortin.
Après leur arrivée en Floride, les Texar n’avaient guère tardé à se lier avec ce que la population comptait de pire sur le territoire. Bien des malfaiteurs devinrent leurs complices dans nombre de vols qui furent commis à cetteépoque, puis, plus tard, leurs partisans, lorsqu’ils furent amenés à jouer un rôle pendant la guerre de sécession. Tantôt l’un tantôt l’autre se mettait à leur tête, et ils ne surent jamais que ce nom de Texar appartenait à deux jumeaux.
On s’explique, maintenant, comment, lors des poursuites exercées à propos de divers crimes, tant d’alibis purent être invoqués par les Texar et durent être admis sans contestation possible. Il en fut ainsi pour les affaires dénoncées à la justice dans la période antérieure à cette histoire, – entre autres, au sujet d’une ferme incendiée. Bien que James Burbank et Zermah eussent positivement reconnu l’Espagnol comme l’auteur de l’incendie, celui-ci fut acquitté par le tribunal de Saint-Augustine, puisque, au moment du crime, il prouva qu’il était à Jacksonville dans la tienda de Torillo – ce dont témoignèrent de nombreux témoins. De même pour la dévastation de Camdless-Bay. Comment Texar eût-il pu conduire les pillards à l’assaut de Castle-House, comment aurait-il pu enlever la petite Dy et Zermah, puisqu’il se trouvait au nombre des prisonniers faits par les fédéraux à Fernandina et détenus sur un des navires de la flottille? Le Conseil de guerre avait donc été obligé de l’acquitter, malgré tant de preuves, malgré la déposition sous serment de miss Alice Stannard.
Et même, en admettant que la dualité des Texar fût reconnue, très probablement on ne saurait jamais lequel avait pris personnellement part à ces divers crimes. Après tout, n’étaient-ils pas tous les deux coupables et au même degré, tantôt complices, tantôt auteurs principaux dans ces attentats qui, depuis tant d’années, désolaient le territoire de la haute Floride? Oui, certes, et le châtiment ne serait que trop justement mérité, qui atteindrait l’un ou l’autre – ou l’un et l’autre.
Quant à ce qui s’était passé dernièrement à Jacksonville, il est probable que les deux frères avaient joué tour à tour le même rôle, après que l’émeute eut renversé les autorités régulières de la cité. Lorsque Texar 1 s’absentait pour quelque expédition convenue, Texar 2 le remplaçait dans l’exercice de ses fonctions, sans que leurs partisans pussent s’en douter. On doit donc admettre qu’ils prirent une part égale aux excès commis à cette époque contre les colons d’origine nordiste et contre les planteurs du sud favorables aux opinions anti-esclavagistes.
Tous deux, on le comprend, devaient toujours être au courant de ce qui se passait dans les États du centre de l’Union, où la guerre civile offrait tant de phases imprévues, comme dans l’État de Floride. Ils avaient acquis, d’ailleurs, une véritable influence sur les petits blancs des comtés, sur les Espagnols, même sur les Américains, partisans de l’esclavage, enfin sur toute la partie détestable de la population. En ces conjonctures, ils avaient dû souvent correspondre, se donner rendez-vous en quelque endroit secret, conférer pour la conduite de leurs opérations, se séparer afin de préparer leurs futurs alibis.
C’est ainsi qu’au moment où l’un était détenu sur un des bâtiments de l’escadre, l’autre organisait l’expédition contre Camdless-Bay. Et, l’on sait comment il avait été renvoyé des fins de la plainte par le Conseil de guerre de Saint-Augustine.
Il a été dit plus haut que l’âge avait absolument respecté cette phénoménale ressemblance des deux frères. Cependant, il était possible qu’un accident physique, une blessure vînt altérer cette ressemblance, et que l’un oul’autre fût affecté de quelque signe particulier. Or, cela eût suffi à compromettre le succès de leurs machinations.
Et, dans cette vie aventureuse, exposée à tant de mauvais coups, ne couraient-ils pas des risques, dont les conséquences, si elles eussent été irréparables, ne leur auraient plus permis de se substituer l’un à l’autre?
Mais, du moment que ces accidents pouvaient se réparer, la ressemblance ne devait point en souffrir.
C’est ainsi que, dans une attaque de nuit, quelque temps après leur arrivée en Floride, un des Texar eut la barbe brûlée par un coup de feu qui lui fut tiré à bout portant. Aussitôt, l’autre se hâta de raser sa barbe, afin d’être imberbe comme son frère. Et, l’on s’en souvient, ce fait a été mentionné à propos de celui des Texar qui se trouvait au fortin au début de cette histoire.
Autre fait qui exige aussi une explication. On n’a pas oublié qu’une nuit, pendant qu’elle était encore à la Crique-Noire, Zermah vit l’Espagnol se faire tatouer le bras. Voici pourquoi. Son frère était au nombre de ces voyageurs floridiens qui, pris par une bande de Séminoles, avaient été marqués d’un signe indélébile au bras gauche. Immédiatement, décalque de ce signe fut envoyé au fortin, et Squambô put le reproduire par un tatouage. L’identité continua donc à être absolue.
En vérité, on serait tenté d’affirmer que, si Texar 1 avait été amputé d’un membre, Texar 2 se fût soumis à la même amputation!
Bref, pendant une dizaine d’années, les frères Texar ne cessèrent de mener cette vie en partie double, mais avec une telle habileté, une telle prudence, qu’ils avaient pu jusqu’alors déjouer toutes les poursuites de la justice floridienne.
Les deux jumeaux s’étaient-ils enrichis à ce métier? Oui, sans doute, dans une certaine mesure. Une assez forte somme d’argent, économisée sur le produit du pillage et des vols, était cachée dans un réduit secret du blockhaus de la Crique-Noire. Par précaution, cet argent avait été emporté par l’Espagnol, lorsqu’il s’était décidé à partir pour l’île Carneral, et l’on peut être certain qu’il ne le laisserait pas au wigwam, s’il était contraint de fuir au-delà du détroit de Bahama.
Cependant, cette fortune ne leur paraissait pas suffisante. Aussi voulaient-ils l’accroître, avant d’aller en jouir, sans danger, dans quelque pays de l’Europe ou du Nord-Amérique.
D’ailleurs, en apprenant que le commodore Dupont avait l’intention d’évacuer bientôt la Floride, les deux frères s’étaient dit que l’occasion se présenterait de s’enrichir encore, et qu’ils feraient payer cher aux colons nordistes ces quelques semaines de l’occupation fédérale. Ils étaient donc résolus à voir venir les choses. Une fois à Jacksonville, grâce à leurs partisans, grâce à tous les sudistes compromis avec eux, ils sauraient bien reprendre la situation qu’une émeute leur avait donnée et qu’une émeute pouvait leur rendre.
Les Texar avaient, cependant, un moyen assuré d’acquérir ce qui leur manquait pour être riches, même au-delà de leurs désirs.
En effet, que n’écoutaient-ils la proposition que Zermah venait de faire à l’un d’eux? Que ne consentaient-ils à rendre la petite Dy à ses parents désespérés? James Burbank eût certainement racheté au prix de sa fortune la liberté de son enfant. Il se serait engage à ne déposer aucune plainte, à ne provoquer aucune poursuite contrel’Espagnol. Mais, chez les Texar, la haine parlait plus haut que l’intérêt, et, s’ils voulaient s’enrichir, ils voulaient aussi s’être vengés de la famille Burbank avant de quitter la Floride.
On sait maintenant tout ce qu’il importait de connaître sur le compte des frères Texar. Il n’y a plus qu’à attendre le dénouement de cette histoire.
Inutile d’ajouter que Zermah avait tout compris, lorsqu’elle se trouva en présence de ces hommes. La reconstitution dupassé se fit instantanément dans son esprit. Stupéfaite en les regardant, elle restait immobile, comme enracinée au sol, tenant la petite fille dans ses bras. Heureusement, l’air plus abondant de cette chambre avait écarté de l’enfant tout danger de suffocation.
Quant à Zermah, son apparition en présence des deux frères, ce secret qu’elle venait de surprendre, c’était pour elle un arrêt de mort.
![]()
Zermah à l’œuvre
![]() evant Zermah, les Texar, si maîtres d’eux qu’ils fussent, n’avaient pu se contenir. Depuis leur enfance, on peut le dire, c’était la première fois qu’ils étaient vus par une tierce personne. Et cette personne était leur mortelle ennemie. Aussi, dans un premier mouvement, ils allaient s’élancer sur elle, ils allaient la tuer, afin de sauver ce secret de leur double existence.
evant Zermah, les Texar, si maîtres d’eux qu’ils fussent, n’avaient pu se contenir. Depuis leur enfance, on peut le dire, c’était la première fois qu’ils étaient vus par une tierce personne. Et cette personne était leur mortelle ennemie. Aussi, dans un premier mouvement, ils allaient s’élancer sur elle, ils allaient la tuer, afin de sauver ce secret de leur double existence.
L’enfant s’était redressée dans les bras de Zermah, et, tendant ses petites mains, criait:
«J’ai peur!… J’ai peur!»
Sur un geste des deux frères, Squambô marcha brusquement vers la métisse, il la prit par l’épaule, il la repoussa dans sa chambre, et la porte se referma sur elle.
Squambô revint alors près des Texar. Son attitude disait qu’ils n’avaient qu’à lui commander; il obéirait. Toutefois, l’imprévu de cette scène les avait troublés plus qu’on n’aurait pu l’imaginer, étant donné leur caractère audacieux et violent. Ils semblaient se consulter du regard.
Cependant Zermah s’était jetée dans un coin de la chambre, après avoir déposé la petite fille sur la couche d’herbe. Le sang-froid lui revint. Elle s’approcha de la porte, afin d’entendre ce qui allait maintenant être dit. Dans un instant, son sort serait décidé, sans doute. Mais les Texar et Squambô venaient de sortir du wigwam, et leurs paroles n’arrivaient plus à l’oreille de Zermah.
Voici les propos qui s’échangèrent entre eux:
«Il faut que Zermah meure!
– Il le faut! Dans le cas où elle parviendrait à s’échapper, comme dans le cas où les fédéraux parviendraient à la reprendre, nous serions perdus! Qu’elle meure donc!
– A l’instant!» répondit Squambô.
Et il se dirigeait vers le wigwam, son coutelas à la main, lorsqu’un des Texar l’arrêta.
«Attendons, dit-il. Il sera toujours temps de faire disparaître Zermah, dont les soins sont nécessaires à l’enfant jusqu’à ce que nous l’ayons remplacée près d’elle. Auparavant, essayons de nous rendre compte de la situation. Un détachement de nordistes bat en ce moment la cyprière par ordre de Dupont. Eh bien! explorons d’abord les environs de l’île et du lac. Rien ne prouve que ce détachement, qui descend vers le sud, se dirigera de ce côté. S’il vient, nous aurons le temps de fuir. S’il ne vient pas, nous resterons ici, et nous le laisserons s’engagerdans les profondeurs de la Floride. Là, il sera à notre merci, car nous aurons eu le temps de réunir la plus grande partie des milices qui errent sur le territoire. Au lieu de fuir, c’est nous qui le poursuivrons, en force. Il sera facile de lui couper la retraite, et, si quelques marins ont pu échapper au massacre de Kissimmee, cette fois, pas un n’en reviendra!»
Dans les circonstances actuelles, c’était évidemment le meilleur parti à prendre. Un grand nombre de sudistes occupaient alors la région n’attendant que l’occasion de tenter un coup contre les fédéraux. Quand un des Texar et ses compagnons auraient opéré une reconnaissance, ils décideraient s’ils devaient rester sur l’île Carneral, ou s’ils se replieraient vers la région du cap Sable. C’est ce qui serait établi le lendemain même. Quant à Zermah, quel que fût le résultat de l’exploration, Squambô serait chargé de s’assurer sa discrétion avec un coup de poignard.
«Pour l’enfant, ajouta l’un des frères, il est de notre intérêt de lui conserver la vie. Elle n’a pu comprendre ce qu’a compris Zermah, et elle peut devenir le prix de notre rançon au cas où nous tomberions entre les mains d’Howick. Afin de racheter sa fille, James Burbank accepterait toutes les propositions qu’il nous plairait d’imposer, non seulement la garantie de notre impunité, mais le prix, quel qu’il fût, que nous mettrions à la liberté de son enfant.
– Zermah morte, dit l’Indien, n’est-il pas à craindre que cette petite succombe?
– Non, les soins ne lui manqueront pas, répondit l’un des Texar, et je trouverai facilement une Indienne qui remplacera la métisse.
– Soit! Avant tout, il faut que nous n’ayons plus rien à redouter de Zermah!
– Bientôt, quoi qu’il arrive, elle aura cessé de vivre!»
Là finit l’entretien des deux frères, et Zermah les entendit rentrer dans le wigwam.
Quelle nuit passa la malheureuse femme! Elle se savait condamnée et ne songeait même pas à elle. De son sort, elle s’inquiétait peu, ayant toujours été prête à donner sa vie pour ses maîtres. Mais c’était Dy abandonnée aux duretés de ces hommes sans pitié. En admettant qu’ils eussent intérêt à ce que l’enfant vécût, ne succomberait-elle pas, lorsque Zermah ne serait plus là pour lui donner ses soins?
Aussi, cette pensée lui revint-elle avec une obstination, une obsession pour ainsi dire inconsciente – cette pensée de prendre la fuite, avant que Texar l’eût séparée de l’enfant.
Pendant cette interminable nuit, la métisse ne songea qu’à mettre son projet à exécution. Toutefois, dans cette conversation elle avait retenu, entre autres choses, que, le lendemain, un des Texar et ses compagnons devaient aller explorer les environs du lac. Evidemment, cette exploration ne serait faite qu’avec la possibilité de résister au détachement fédéral, si on le rencontrait. Texar se ferait donc accompagner, avec tout son personnel, des partisans amenés par son frère. Celui-ci resterait sur l’île, sans doute, autant pour n’être point reconnu que pour veiller sur le wigwam. C’est alors que Zermah tenterait de s’enfuir. Peut-être parviendrait-elle à trouver une arme quelconque, et, en cas de surprise, elle n’hésiterait pas à s’en servir.
La nuit s’écoula. Vainement Zermah avait-elle essayé de tirer une indication de tous les bruits qui se produisaient sur l’île, et toujours avec la pensée que la troupe du capitaine Howick allait peut-être arriver pour s’emparer de Texar.
Quelques instants avant le lever du jour, la petite fille, un peu reposée, se réveilla. Zermah lui donna quelques gouttes d’eau qui la rafraîchirent. Puis, la regardant comme si ses yeux ne devaient bientôt plus la voir, elle la serra contre sa poitrine. Si, en ce moment, on fût entré pour l’en séparer, elle se serait défendue avec la fureur d’une bête fauve que l’on veut éloigner de ses petits.
«Qu’as-tu, bonne Zermah? demanda l’enfant.
– Rien… rien! murmura la métisse.
– Et maman… quand la reverrons-nous?
– Bientôt… répondit Zermah. Aujourd’hui peut-être!… Oui, ma chérie!… Aujourd’hui j’espère que nous serons loin…
– Et ces hommes que j’ai vus, cette nuit?…
– Ces hommes, répondit Zermah, tu les as bien regardés?…
– Oui… et ils m’ont fait peur!
– Mais tu les as bien vus, n’est-ce pas?… Tu as remarqué comme ils se ressemblaient?…
– Oui… Zermah!
– Eh bien, souviens-toi de dire à ton père, à ton frère, qu’ils sont deux frères… entends-tu, deux frères Texar, et si ressemblants qu’on ne peut reconnaître l’un de l’autre!…
– Toi aussi, tu le diras?… répondit la petite fille.
– Je le dirai… oui!… Cependant, si je n’étais pas là, il ne faudrait pas oublier…
– Et pourquoi ne serais-tu pas là? demanda l’enfant, qui passait ses petits bras au cou de la métisse comme pour mieux s’attacher à elle.
– J’y serai, ma chérie, j’y serai!… Maintenant, si nous partons, comme nous aurons une longue route à faire… il faut prendre des forces!… Je vais faire ton déjeuner…
– Et toi?
– J’ai mangé pendant que tu dormais, et je n’ai plus faim!»
La vérité est que Zermah n’aurait pu manger, si peu que ce fût, dans l’état de surexcitation où elle se trouvait. Après son repas, l’enfant se remit sur sa couche d’herbes.
Zermah vint alors se placer près d’un interstice que les roseaux du paillis laissaient entre eux à l’angle de la chambre. De là, pendant une heure, elle ne cessa d’observer ce qui se passait au-dehors, car c’était pour elle de la plus grande importance.
On faisait les préparatifs de départ. Un des frères – un seul – présidait à la formation de la troupe qu’il allait conduire dans la cyprière. L’autre, que personne n’avait vu, avait dû se cacher, soit au fond du wigwam, soit en quelque coin de l’île.
C’est, du moins, ce que pensa Zermah, connaissant le soin qu’ils mettaient à dissimuler le secret de leur existence. Elle se dit même que ce serait peut-être à celui qui resterait dans l’île qu’incomberait la tâche de surveiller l’enfant et elle.
Zermah ne se trompait pas, ainsi qu’on va bientôt le voir.
Cependant les partisans et les esclaves étaient réunis au nombre d’une cinquantaine devant le wigwam, attendant pour partir les ordres de leur chef.
Il était environ neuf heures du matin, lorsque la troupe se disposa à gagner la lisière de la forêt – ce qui exigea un certain temps, la barge ne pouvant prendre que cinq à six hommes à la fois. Zermah les vit descendre par petits groupes, puis remonter l’autre rive. Toutefois, à travers le paillis, elle ne pouvait apercevoir la surface du canal, situé très en contrebas du niveau de l’île.
Texar, qui était resté le dernier, disparu à son tour, suivi de l’un des chiens dont l’instinct devait être utilisé pendant l’exploration. Sur un geste de son maître, l’autre limier revint vers le wigwam, comme s’il eût été seul chargé de veiller à sa porte.
Un instant après, Zermah aperçut Texar qui gravissait la berge opposée et s’arrêtait un instant pour reformer sa troupe. Puis, tous, Squambô en tête, accompagné du chien, disparurent derrière les gigantesques roseaux sous les premiers arbres de la forêt. Sans doute, un des noirs avait dû ramener la barge, afin que personne ne pût passer dans l’île. Cependant la métisse ne put le voir, et pensa qu’il avait dû suivre les bords du canal.
Elle n’hésita plus.
Dy venait de se réveiller. Son corps amaigri faisait peine à voir sous ses vêtements usés par tant de fatigues.
«Viens, ma chérie, dit Zermah.
– Où? demanda l’enfant.
– Là… dans la forêt!… Peut-être y trouverons-nous ton père… ton frère!… Tu n’auras pas peur?…
– Avec toi, jamais!» répondit la petite fille.
Alors la métisse entrouvrit la porte de sa chambre avec précaution. Comme elle n’avait entendu aucun bruit dans la chambre à côté, elle supposait que Texar ne devait pas être dans le wigwam.
En effet, il n’y avait personne.
Tout d’abord, Zermah chercha quelque arme dont elle était décidée à se servir contre quiconque tenterait de l’arrêter. Il y avait sur la table un de ces larges coutelas dont les Indiens font usage dans leurs chasses. La métisse s’en saisit et le cacha sous son vêtement. Elle prit aussi un peu de viande sèche, qui devait assurer sa nourriture pendant quelques jours.
Il s’agissait maintenant de sortir du wigwam. Zermah regarda à travers les trous du paillis dans la direction du canal. Aucun être vivant n’errait sur cette portion de l’île, pas même celui des deux chiens qui avait été laissé à la garde de l’habitation.
La métisse, rassurée, essaya d’ouvrir la porte extérieure.
Cette porte, fermée en dehors, résista.
Aussitôt, Zermah rentra dans sa chambre avec l’enfant. Il n’y avait plus qu’une chose à faire: c’était d’utiliser le trou à demi-perce déjà à travers la paroi du wigwam.
Ce travail ne fut pas difficile. La métisse put se servir de son coutelas pour trancher les roseaux entrelacés dans le paillis, – opération qui fut faite avec aussi peu de bruit que possible.
Toutefois, si le limier qui n’avait pas suivi Texar ne parut pas, en serait-il ainsi lorsque Zermah serait dehors? Ce chien n’accourrait-il pas, ne se jetterait-il pas sur elle et sur la petite fille? Autant aurait valu se trouver en face d’un tigre!
Il ne fallait pas hésiter, cependant. Aussi, le passage ouvert, Zermah attira l’enfant qu’elle embrassa dans une étreinte passionnée. La petite fille lui rendit ses baisersavec effusion. Elle avait compris: il fallait fuir, fuir par ce trou.
Zermah se glissa à travers l’ouverture. Puis, après avoir porté ses regards à droite, à gauche, elle écouta. Pas un bruit ne se faisait entendre. La petite Dyapparut alors à l’orifice du trou.
En ce moment, un aboiement retentit. Encore fort éloigné, il semblait venir de la partie ouest de l’île. Zermah avait saisi l’enfant. Le cœur lui battait à se rompre… Elle ne se croirait relativement en sûreté qu’après avoir disparu derrière les roseaux de l’autre rive.
Mais, traverser, sur une centaine de pas, l’espace qui séparait le wigwam du canal, c’était la phase la plus critique de l’évasion. On risquait d’être aperçu soit de Texar, soit de celui des esclaves qui avait dû rester sur l’île.
Heureusement, à droite du wigwam, un épais fourré de plantes arborescentes, entremêlées de roseaux, s’étendait jusqu’au bord du canal, à quelques yards seulement de l’endroit où devait se trouver la barge.
Zermah résolut de s’engager entre les végétations touffues de ce fourré, projet qui fut aussitôt mis à exécution. Les hautes plantes livrèrent passage aux deux fugitives, et le feuillage se referma sur elles. Quant aux aboiements du chien, on ne les entendait plus.
Ce glissement à travers le fourré ne se fit pas sans peine. Il fallait s’introduire entre les tiges des arbrisseaux qui ne laissaient entre eux qu’un étroit espace. Bientôt Zermah eut ses vêtements en lambeaux, ses mains en sang. Peu importait, si l’enfant pouvait éviter d’être déchirée par ces longues épines. Ce n’est pas la courageuse métisse à qui ces piqûres eussent pu arracher un signe dedouleur. Cependant, malgré tous les soins qu’elle prit, la petite fille fut plusieurs fois atteinte aux mains et bras. Dy ne poussa pas un cri, ne fit pas entendre une plainte.
Bien que la distance à franchir fût relativement courte – une soixantaine de yards au plus – il ne fallut pas moins d’une demi-heure pour atteindre le canal.
Zermah s’arrêta alors, et, à travers les roseaux, elle regarda du côté du wigwam, puis du côté de la forêt.
Personne sous les hautes futaies de l’île. Sur l’autre rive, aucun indice de la présence de Texar et de ses compagnons, qui devaient être alors à un ou deux milles dans l’intérieur. A moins de rencontre avec les nordistes, ils ne seraient pas de retour avant quelques heures.
Cependant Zermah ne pouvait croire qu’elle eût été laissée seule au wigwam. Il n’était pas supposable, non plus, que celui des Texar qui était arrivé la veille avec ses partisans eût quitté l’île pendant la nuit, ni que le chien l’eût suivi. D’ailleurs la métisse n’avait-elle pas entendu des aboiements – preuve que le limier rôdait encore sous les arbres? A tout instant, elle pouvait les voir apparaître l’un ou l’autre. Peut-être, en se hâtant, parviendrait-elle à gagner la cyprière?
On se le rappelle, tandis que Zermah observait les mouvements des compagnons de l’Espagnol, elle n’avait pu voir la barge au moment où elle traversait le canal dont le lit était caché par la hauteur et l’épaisseur des roseaux.
Or, Zermah ne doutait pas que cette barge eût été ramenée par l’un des esclaves. Cela importait à la sécurité du wigwam pour le cas où les soldats du capitaine Howick auraient tourné les sudistes.
Et pourtant, si la barge était restée sur l’autre rive, s’il avait paru prudent de ne pas la renvoyer, afin d’assurer plus rapidement le passage de Texar et des siens suivis de trop près par les fédéraux, comment la métisse ferait-elle pour se transporter sur l’autre bord? Lui faudrait-il s’enfuir à travers les futaies de l’île? Et là, devrait-elle attendre que l’Espagnol fût parti pour aller chercher un nouveau refuge au fond des Everglades? Mais, s’il se décidait à le faire, ce ne serait pas sans avoir tout tenté pour reprendre Zermah et l’enfant. Donc, tout était là: se servir de la barge afin de traverser le canal.
Zermah n’eut qu’à se glisser entre les roseaux sur un espace de cinq ou six yards. Arrivée en cet endroit, elle s’arrêta…
La barge était sur l’autre rive.
![]()
Les deux frères
![]() a situation était désespérée. Comment passer? Un audacieux nageur n’aurait pu le faire, sans courir le risque de perdre vingt fois la vie. Qu’il n’y eût qu’une centaine de pieds d’une rive à l’autre, soit! Mais, faute d’une barque, il était impossible de les franchir. Des têtes triangulaires pointaient ça et là hors des eaux, et les herbes s’agitaient sous la passée rapide des reptiles.
a situation était désespérée. Comment passer? Un audacieux nageur n’aurait pu le faire, sans courir le risque de perdre vingt fois la vie. Qu’il n’y eût qu’une centaine de pieds d’une rive à l’autre, soit! Mais, faute d’une barque, il était impossible de les franchir. Des têtes triangulaires pointaient ça et là hors des eaux, et les herbes s’agitaient sous la passée rapide des reptiles.
La petite Dy, au comble de l’épouvante, se pressait contre Zermah. Ah! si pour le salut de l’enfant, il eût suffi de se jeter au milieu de ces monstres, qui l’eussent enlacée comme un gigantesque poulpe aux mille tentacules, la métisse n’aurait pas hésité un instant!
Mais, pour la sauver, il fallait une circonstance providentielle. Cette circonstance, à Dieu seul de la faire naître. Zermah n’avait plus de recours qu’en lui. Agenouillée sur la berge, elle implorait. Celui qui dispose du hasard, dont il fait le plus souvent l’agent de ses volontés.
Cependant, d’un moment à l’autre, quelques-uns des compagnons de Texar pouvaient se montrer sur la lisière de la forêt. Si d’un moment à l’autre, celui des Texar qui était resté sur l’île revenait au wigwam, n’ytrouvant plus Dy ni Zermah, ne se mettrait-il à leur recherche?…
«Mon Dieu… s’écria la malheureuse femme, ayez pitié!…»
Soudain ses regards se portèrent sur la droite du canal.
Un léger courant entraînait les eaux vers le nord du lac où coulent quelques affluents du Calaooschatches, un des petits fleuves qui se déversent dans le golfe du Mexique, et par lequel s’alimente le lac Okee-cho-bee à l’époque des grandes marées mensuelles.
Un tronc d’arbre, qui dérivait, par la droite, venait d’accoster. Or, ce tronc ne pourrait-il suffire à la traversée du canal, puisqu’un coude de la rive, détournant le courant à quelques yards au-dessous, le rejetait vers la cyprière? Oui, évidemment. En tout cas, si, par malheur, ce tronc revenait vers l’île, les fugitives ne seraient pas plus compromises qu’elles ne l’étaient en ce moment.
Sans plus réfléchir, comme par instinct, Zermah se précipita vers l’arbre flottant. Si elle eût pris le temps de la réflexion, peut-être se fût-elle dit que des centaines de reptiles pullulaient sous les eaux, que les herbes pouvaient retenir ce tronc au milieu du canal! Oui! mais tout valait mieux que de rester sur l’île! Aussi Zermah,tenant Dy dans ses bras, après s’être accotée aux branches, s’écarta de la rive.
Aussitôt le tronc reprit le fil de l’eau, et le courant tendit à le ramener vers l’autre bord.
Cependant Zermah cherchait à se cacher au milieu du branchage qui la couvrait en partie. D’ailleurs, les deux berges étaient désertes. Aucun bruit ne venait ni du côté de l’île ni du côté de la cyprière. Une fois le canal traversé, la métisse saurait bien trouver un abri jusqu’au soir, en attendant qu’elle pût s’enfoncer dans la forêt sans courir le risque d’être aperçue. L’espoir lui était revenu. A peine se préoccupait-elle des reptiles, dont les gueules s’ouvraient de chaque côté du tronc d’arbre et qui se glissaient jusque dans ses basses branches. La petite fille avait fermé les yeux. D’une main, Zermah la tenait serrée contre sa poitrine. De l’autre, elle était prête à frapper ces monstres. Mais, soit qu’ils fussent effrayés à la vue du coutelas qui les menaçait, soit qu’ils ne fussent redoutables que sous les eaux, ils ne s’élancèrent pas sur l’épave.
Enfin le tronc atteignit le milieu du canal, dont le courant portait obliquement vers la forêt. Avant un quart d’heure, s’il ne s’embarrassait pas dans les plantes aquatiques, il devait avoir accosté l’autre berge. Et alors, si grands que les dangers fussent encore, Zermah se croirait hors des atteintes de Texar.
Soudain, elle serra plus étroitement l’enfant dans ses bras.
Des aboiements furieux éclataient sur l’île. Presque aussitôt, un chien apparut le long de la rive qu’il descendait en bondissant.
Zermah reconnut le limier, laissé à la surveillance du wigwam, que l’Espagnol n’avait point emmené avec lui.
Là, le poil hérissé, l’œil en feu, il était prêt à s’élancer, au milieu des reptiles qui s’agitaient à la surface des eaux.
Au même moment, un homme parut sur la berge.
C’était celui des frères Texar, resté sur l’île. Prévenu par les aboiements du chien, il venait d’accourir.
Ce que fut sa colère quand il aperçut Dy et Zermah sur cet arbre en dérive, il serait difficile de l’imaginer. Il ne pouvait se mettre à leur poursuite, puisque la barge se trouvait de l’autre côté du canal. Pour les arrêter, il n’y avait qu’un moyen: tuer Zermah, au risque de tuer l’enfant avec elle!
Texar, armé de son fusil, l’épaula, et visa la métisse qui cherchait à couvrir la petite fille de son corps.
Tout à coup, le chien, en proie à une excitation folle, se précipita dans le canal. Texar pensa qu’il fallait d’abord le laisser faire.
Le chien se rapprochait rapidement du tronc. Zermah, son coutelas bien emmanché dans sa main, se tenait prête à le frapper… Cela ne fut pas nécessaire.
En un instant, les reptiles eurent enlacé l’animal, qui, après avoir répondu par des coups de crocs à leurs venimeuses morsures, disparut bientôt sous les herbes.
Texar avait assisté à la mort du chien, sans avoir eu le temps de lui porter secours. Zermah allait lui échapper…
«Meurs donc!» s’écria-t-il en tirant sur elle.
Mais l’épave avait alors atteint vers l’autre rive, et la balle ne fit qu’effleurer l’épaule de la métisse.
Quelques instants plus tard, le tronc accostait. Zermah, emportant la petite fille, prenait pied sur la berge, disparaissait au milieu des roseaux, où un second coup de feu n’eût pu l’atteindre, et s’engageait sous les premiers arbres de la cyprière.
Cependant, si la métisse n’avait plus rien à redouter de celui des Texar qui était retenu sur l’île, elle risquait encore de retomber entre les mains de son frère.
Aussi, tout d’abord, sa préoccupation fut-elle de s’éloigner le plus vite et le plus loin possible de l’île Carneral. La nuit venue, elle chercherait à se diriger vers le lac Washington. Employant tout ce qu’elle possédait de force physique, d’énergie morale, elle courut plutôt qu’elle ne marcha, au hasard, tenant dans ses bras l’enfant, qui n’aurait pu la suivre sans la retarder. Les petites jambes de Dy se seraient refusées à courir sur ce sol inégal, au milieu des fondrières qui fléchissaient comme des trappes de chasseurs, entre ces larges racines dont l’enchevêtrement formait autant d’obstacles insurmontables pour elles.
Zermah continua donc à porter son cher fardeau, dont elle ne semblait même pas sentir le poids. Parfois, elle s’arrêtait – moins pour reprendre baleine que pour prêter l’oreille à tous les bruits de la forêt. Tantôt elle croyait entendre des aboiements qui auraient été ceux de l’autre limier emmené par Texar, tantôt quelques coups de feu lointains. Alors elle se demandait si les partisans sudistes n’étaient pas aux prises avec le détachement fédéral. Puis, lorsqu’elle avait reconnu que ces divers bruits n’étaient que les cris d’un oiseau imitateur ou la détonation de quelque branche sèche dont les fibres éclataient comme des coups de pistolet sous la brusque expansion de l’air, elle reprenait sa marche un instant interrompue. Maintenant, remplie d’espoir, elle ne voulait rien voir des dangers qui la menaçaient, avant qu’elle eût atteint les sources du Saint-John.
Pendant une heure, elle s’éloigna ainsi du lac Okee-cho-bee, obliquant vers l’est, afin de se rapprocher du littoral de l’Atlantique. Elle se disait avec raison que les navires de l’escadre devaient croiser sur la côte de la Floride pour attendre le détachement envoyé sous les ordres du capitaine Howick. Et ne pouvait-il se faire que plusieurs chaloupes fussent en observation le long du rivage?…
Tout à coup, Zermah s’arrêta. Cette fois, elle ne se trompait pas. Un furieux aboiement retentissait sous les arbres, et se rapprochait sensiblement. Zermah reconnut celui qu’elle avait si souvent entendu, pendant que les limiers rôdaient autour du blockhaus de la Crique-Noire.
«Ce chien est sur nos traces, pensa-t-elle, et Texar ne peut être loin maintenant!»
Aussi son premier soin fut-il de chercher un fourré pour s’y blottir avec l’enfant. Mais pourrait-elle échapper au flair d’un animal aussi intelligent que féroce, dressé autrefois à poursuivre les esclaves marrons, à découvrir leur piste?
Les aboiements se rapprochaient de plus en plus, et déjà même des cris lointains se faisaient entendre.
A quelques pas de là se dressait un vieux cyprès, creusé par l’âge, sur lequel les serpentaires et les lianes avaient jeté un épais réseau de brindilles.
Zermah se blottit dans cette cavité assez grande pour contenir la petite fille et elle, et dont le réseau de lianes les recouvrit toutes deux.
Mais le limier était sur leurs traces. Un instant après, Zermah l’aperçut devant l’arbre. Il aboyait avec une fureur croissante et s’élança d’un bond sur le cyprès.
Un coup de coutelas le fît reculer, puis hurler avec plus de violence.
Presque aussitôt, un bruit de pas se fit entendre. Des voix s’appelaient, se répondaient, et, parmi elles, les voix si reconnaissables de Texar et de Squambô.
C’étaient bien l’Espagnol et ses compagnons qui gagnaient du côté du lac, afin d’échapper au détachement fédéral. Ils l’avaient inopinément rencontré dans la cyprière, et, n’étant pas en force, ils se dérobaient en toute hâte. Texar cherchait à regagner l’île Carneral par le plus court, afin de mettre une ceinture d’eau entre les fédéraux et lui. Comme ceux-ci ne pourraient franchir le canal sans une embarcation, ils seraient arrêtés devant cet obstacle. Alors, pendant ces quelques heures de répit, les partisans sudistes chercheraient à atteindre l’autre côté de l’île; puis, la nuit venue, ils essaieraient d’utiliser la barge pour débarquer sur la rive méridionale du lac.
Lorsque Texar et Squambô arrivèrent en face du cyprès devant lequel le chien aboyait toujours, ils virent le sol rouge du sang qui s’écoulait par une blessure ouverte au flanc de l’animal.
«Voyez!… Voyez! s’écria l’Indien.
– Ce chien a été blessé? répondit Texar.
– Oui!… blessé d’un coup de couteau, il n’y a qu’un instant!… Son sang fume encore!
– Qui a pu?…»
En ce moment, le chien se précipita de nouveau sur le réseau de feuillage que Squambô écarta du bout de son fusil.
«Zermah!… s’écria-t-il.
– Et l’enfant!… répondit Texar.
– Oui!… Comment ont-elles pu s’enfuir?…
– A mort, Zermah, à mort!»
La métisse, désarmée par Squambô au moment où elle allait frapper l’Espagnol, fut tirée si brutalement de la cavité que la petite fille lui échappa et roula au milieu de ces champignons géants, de ces pézizes si abondantes au milieu des cyprières.
Au choc, un des champignons éclata comme une arme à feu. Une poussière lumineuse fusa dans l’air. A l’instant, d’autres pézizes firent explosion à leur tour. Ce fut un fracas général, comme si la forêt eût été emplie de pièces d’artifices qui se croisaient en tous sens.
Aveuglé par ces myriades de spores, Texar avait dû lâcher Zermah qu’il tenait sous son coutelas, tandis que Squambô était aveuglé par ces brûlantes poussières. Par bonheur, la métisse et l’enfant, étendues sur le sol, n’étaient pas atteintes par ces spores qui crépitaient au-dessus d’elles.
Cependant Zermah ne pouvait échapper à Texar. Déjà, après une dernière série d’explosions, l’air était redevenu respirable…
De nouvelles détonations éclatèrent alors – détonations d’armes à feu, cette fois.
C’était le détachement fédéral qui se jetait sur les partisans sudistes. Ceux-ci, aussitôt entourés par les marins du capitaine Howick, durent mettre bas les armes. A ce moment, Texar, qui venait de ressaisir Zermah, la frappa en pleine poitrine.
«L’enfant!… Emporte l’enfant!» cria-t-il à Squambô.
Déjà l’Indien avait pris la petite fille et fuyait du côté du lac, quand un coup de feu retentit… Il tomba mort, frappé d’une balle que Gilbert venait de lui envoyer à travers le cœur.
Maintenant, tous étaient là, James et Gilbert Burbank, Edward Carrol, Perry, Mars, les noirs de Camdless-Bay, les marins du capitaine Howick qui tenaient en joue les sudistes, et, parmi eux, Texar, debout près du cadavre de Squambô.
Quelques-uns avaient pu s’échapper, cependant, du côté de l’île Carneral. Et qu’importait! La petite fille n’était-elle entre les bras de son père, qui la serrait comme s’il eût craint qu’on la lui ravît de nouveau? Gilbert et Mars, penchés sur Zermah, essayaient de la ranimer. La pauvre femme respirait encore, mais ne pouvait parler. Mars lui soutenait la tête, l’appelait, l’embrassait…
Zermah ouvrit les yeux. Elle vit l’enfant dans les bras de M. Burbank, elle reconnut Mars qui la couvrait de baisers, elle fui sourit. Puis, ses paupières se refermèrent…
Mars, s’étant relevé, aperçut alors Texar, et bondit sur lui, répétant ces mots qui étaient si souvent sortis de sa bouche:
«Tuer Texar!… Tuer Texar!
– Arrête, Mars, dit le capitaine Howick, et laisse-nous faire justice de ce misérable!»
Se retournant alors vers l’Espagnol:
«Vous êtes Texar, de la Crique-Noire? demanda-t-il.
– Je n’ai pas à répondre, répliqua Texar.
– James Burbank, le lieutenant Gilbert, Edward Carrol, Mars, vous connaissent et vous reconnaissent!
– Soit!…
– Vous allez être fusillé!
– Faites!»
Alors, à l’extrême surprise de tous ceux qui l’entendirent, la petite Dy, s’adressant à M. Burbank:
«Père, dit-elle, ils sont deux frères… deux méchants hommes… qui se ressemblent…
– Deux hommes?…
– Oui!… ma bonne Zermah m’a bien recommandé de te le dire!…»
Il eût été difficile de comprendre ce que signifiaient ces singulières paroles de l’enfant. Mais l’explication en fut presque aussitôt donnée et d’une façon très inattendue.
En effet, Texar avait été conduit au pied d’un arbre. Là, regardant James Burbank en face, il fumait une cigarette qu’il venait d’allumer, quand, soudain, au moment où s’alignait le peloton d’exécution, un homme bondit et vint se placer près du condamné.
C’était le second Texar, auquel ceux de ses partisans qui avaient regagné l’île damerai, venaient d’apprendre l’arrestation de son frère.
Le vue de ces deux hommes, si ressemblants, expliqua ce que signifiaient les paroles de la petite fille. On eut enfin l’explication de cette vie de crimes, toujours protégée par d’inexplicables alibis.
Et maintenant le passé des Texar, reconstitué rien que par leur présence, se dressait devant eux.
Toutefois, l’intervention du frère allait amener une certaine hésitation dans l’accomplissement des ordres du commodore.
En effet, l’ordre d’exécution immédiate, donné par Dupont, ne concernait que l’auteur du guet-apens dans lequel avaient péri les officiers et les marins des chaloupes fédérales. Quant à l’auteur du pillage de Camdless-Bay et du rapt, celui-là devrait être ramené à Saint-Augustine, où il serait jugé à nouveau et condamné sans nul doute.
Et pourtant, ne pouvait-on considérer les deux frères comme également responsables de cette longue série de crimes qu’ils avaient pu impunément commettre?
Oui, certes! Cependant, par respect de la légalité, le capitaine Howick crut devoir leur poser la question suivante:
«Lequel de vous deux, demanda-t-il, se reconnaît coupable du massacre de Kissimmee?»
Il n’obtint aucune réponse.
Évidemment, les Texar étaient résolus à garder le silence à toutes les demandes qui leur seraient faites.
Seule, Zermah aurait pu indiquer la part qui revenait à chacun dans ces crimes. En effet, celui des deux frères qui se trouvait avec elle à la Crique-Noire le 22 mars ne pouvait être l’auteur du massacre, commis, ce jour-là, à cent milles dans le sud de la Floride. Or, celui-là, le véritable auteur du rapt, Zermah aurait eu un moyen de le reconnaître. Mais n’était-elle pas morte à présent?…
Non, et soutenue par son mari, on la vit apparaître. Puis, d’une voix qu’on entendait à peine:
«Celui qui est coupable de l’enlèvement, dit-elle, a le bras gauche tatoué…»
A ces paroles, on put voir le même sourire de dédain se dessiner sur les lèvres des deux frères, et, relevant leur manche, ils montrèrent sur leur bras gauche un tatouage identique.
Devant cette nouvelle impossibilité de les distinguer l’un de l’autre, le capitaine Howick se borna à dire:
«L’auteur des massacres de Kissimmee doit être fusillé. – Quel est-il de vous deux?
– Moi!» répondirent en même temps les deux frères.
Sur cette réponse, le peloton d’exécution mit en joueles condamnés qui s’étaient embrassés pour la dernière fois.
Une détonation retentit. La main dans la main tous deux tombèrent.
Ainsi finirent ces hommes, chargés de tous ces crimes qu’une extraordinaire ressemblance leur avait permis de commettre impunément depuis tant d’années. Le seul sentiment humain qu’ils eussent jamais éprouvé, cette farouche amitié de frère à frère qu’ils ressentaient l’un pour l’autre, les avait suivis jusque dans la mort.
![]()
Conclusion
![]() ependant la guerre civile se poursuivait avec ses phases diverses. Quelques événements s’étaient récemment accomplis, dont James Burbank n’avait pu avoir connaissance depuis son départ de Camdless-Bay et qu’il n’apprit qu’au retour.
ependant la guerre civile se poursuivait avec ses phases diverses. Quelques événements s’étaient récemment accomplis, dont James Burbank n’avait pu avoir connaissance depuis son départ de Camdless-Bay et qu’il n’apprit qu’au retour.
En somme, il semblait que, pendant cette période, l’avantage eût été obtenu par les confédérés concentrés autour de Corinth, au moment où les fédéraux occupaient la position de Pittsburg-Landing. L’armée séparatiste avait, pour la commander, Johnston, général en chef, et sous lui, Beauregard, Hardee, Braxton-Bagg, l’évêque Polk, autrefois élève de West-Point, et elle profita habilement de l’imprévoyance des nordistes. Le 5 avril, à Shiloh, ceux-ci s’étaient laissé surprendre – ce qui avait amené la dispersion de la brigade Heabody et la retraite de Sherman. Toutefois, les confédérés payèrent cruellement le succès qu’ils venaient d’obtenir; l’héroïque Johnston fut tué pendant qu’il repoussait l’armée fédérale.
Le surlendemain, le combat s’engagea sur toute la ligne, et Sherman parvint à reprendre Shiloh. A leur tour, les confédérés durent fuir devant les soldats de Grant. Sanglante bataille! Sur quatre-vingt mille hommes engagés, vingt mille blessés ou morts!
Ce fut ce dernier fait de guerre que James Burbank et ses compagnons apprirent le lendemain de leur arrivée à Castle-House, où ils avaient pu rentrer dès le 7 avril.
En effet, après l’exécution des frères Texar, ils avaient suivi le capitaine Howick, qui conduisait son détachement et ses prisonniers vers le littoral. Au cap Malabar stationnait un des bâtiments de la flottille en croisière sur la côte. Ce bâtiment les amena à Saint-Augustine. Puis, une canonnière, qui les prit à Picolata, vint les débarquer au pier de Camdless-Bay.
Tous étaient donc de retour à Castle-House – même Zermah, qui avait survécu à ses blessures. Transportée jusqu’au navire fédéral par Mars et ses camarades, les soins ne lui avaient pas manqué à bord. Et, d’ailleurs, si heureuse d’avoir sauvé sa petite Dy, d’avoir retrouvé tous ceux qu’elle aimait, aurait-elle pu mourir?
Après tant d’épreuves, on comprend ce que dut être la joie de cette famille, dont tous les membres étaient enfin réunis pour ne plus jamais se séparer. Mme Burbank, son enfant près d’elle, revint peu à peu à la santé. N’avait-elle pas près d’elle son mari, son fils, miss Alice qui allait devenir sa fille, Zermah et Mars? Et plus rien à craindre désormais du misérable ou plutôt des deux misérables, dont les principaux complices étaient entre les mains des fédéraux.
Cependant un bruit s’était répandu, et, on ne l’a pas oublié, il en avait été question dans l’entretien des deux frères à l’île Carneral. On disait que les nordistes allaient abandonner Jacksonville, que le commodore Dupont, bornant son action au blocus du littoral, se préparait à retirer les canonnières qui assuraient la sécurité du Saint-John. Ce projet pouvait évidemment compromettre la sécurité des colons dont on connaissait la sympathie pour les idées anti-esclavagistes – et plus particulièrement de James Burbank.
Le bruit était fondé. En effet, à la date du 8, le lendemain du jour où toute la famille s’était retrouvée à Castle-House, les fédéraux opéraient l’évacuation de Jacksonville. Aussi, quelques-uns des habitants, qui s’étaient montrés favorables à la cause unioniste, crurent-ils devoir se réfugier, les uns à Port-Royal, les autres à New-York.
James Burbank ne jugea pas à propos de les imiter. Les noirs étaient revenus à la plantation, non comme esclaves, mais comme affranchis, et leur présence pouvait assurer la sécurité de Camdless-Bay. D’ailleurs, la guerre entrait dans une phase nouvelle au Nord – ce qui allait permettre à Gilbert de rester quelque temps à Castle-House, pour célébrer son mariage avec Alice Stannard.
Les travaux de la plantation avaient donc recommencé, et l’exploitation eut bientôt repris son cours. Il n’était plus question de mettre en demeure James Burbank d’exécuter l’arrêté qui expulsait les affranchis du territoire de la Floride. Texar et ses partisans n’étaient plus là pour soulever la populace. D’ailleurs, les canonnières du littoral auraient promptement rétabli l’ordre à Jacksonville.
Quant aux belligérants, ils allaient être aux prises pendant trois ans encore, et, même, la Floride était destinée à recevoir de nouveau quelques contrecoups de la guerre.
En effet, cette année, au mois de septembre, les navires du commodore Dupont apparurent à la hauteur du Saint-John-Bluffs, vers l’embouchure du fleuve, et Jacksonville fut reprise une deuxième fois. Une troisième fois, en 1866, le général Seymour vint l’occuper, sans avoir éprouvé de résistance sérieuse.
Le 1er janvier 1863, une proclamation du président Lincoln avait aboli l’esclavage dans tous les États de l’Union. Toutefois, la guerre ne fut terminée que le 9 avril 1865. Ce jour-là, à Appomaltox-Court-House, le général Lee se rendit avec toute son armée au général Grant, après une capitulation qui fut à l’honneur des deux partis.
Il y avait donc eu quatre ans d’une lutte acharnée entre le Nord et le Sud. Elle avait coûté deux milliards sept cents millions de dollars, et fait tuer plus d’un demi-million d’hommes; mais l’esclavage était aboli dans toute l’Amérique du Nord.
Ainsi fut à jamais assurée l’indivisibilité de la République des États-Unis, grâce aux efforts de ces Américains, dont, près d’un siècle avant, les ancêtres avaient affranchi leur pays dans la guerre de l’Indépendance.
FIN