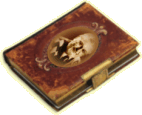Jules Verne
La Superbe Orénoque
(Chapitre XIII-XIV)
Illustrations de George Roux
Collection Hetzel
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
Deux mois à la mission
![]() epuis la disparition du colonel de Kermor, depuis son départ pour le Nouveau-Monde, quatorze ans s’étaient écoulés, et l’histoire de ces quatorze années tiendra en quelques lignes.
epuis la disparition du colonel de Kermor, depuis son départ pour le Nouveau-Monde, quatorze ans s’étaient écoulés, et l’histoire de ces quatorze années tiendra en quelques lignes.
Ce fut en 1872 qu’il apprit, avec le naufrage du Norton, la nouvelle que sa femme et son enfant avaient péri dans ce sinistre maritime. Les conditions où s’était produite la catastrophe ne lui permettaient pas de croire que, de ces deux êtres si chers, l’un, sa fille Jeanne, toute petite alors, eût été sauvée. Il ne la connaissait même pas, puisqu’il avait dû quitter la Martinique quelques mois avant sa naissance.
Pendant un an encore, le colonel de Kermor resta à la tête de son régiment. Puis, après avoir donné sa démission, aucun lien de famille ne le rattachant au monde, il résolut de consacrer le reste de sa vie à cette œuvre si généreuse des missions étrangères.
Il y avait toujours eu en lui, avec l’âme d’un soldat, l’âme d’un apôtre. L’officier était tout préparé à se fondre dans le prêtre, le prêtre militant, qui se consacre à la conversion, en d’autres termes, à la civilisation des tribus sauvages.
Le colonel de Kermor, sans avoir mis personne, – pas même le sergent Martial, – dans la confidence de ses projets, quitta secrètement la France en 1875, et se rendit au Venezuela, où tant de tribus indiennes étaient vouées à l’ignorance, à la dégradation physique et morale.
Dès qu’il eut terminé ses études ecclésiastiques dans ce pays, il reçut l’ordination, et entra dans la Compagnie des missions étrangères sous le nom de Père Esperante, qui devait assurer l’incognito de sa nouvelle existence.
Sa démission d’officier datait de 1873, et son ordination datait de 1878, alors qu’il avait quarante-neuf ans.
Ce fut à Caracas que le Père Esperante prit la résolution d’aller vivre sur ces territoires presque inconnus du Venezuela méridional, où les missionnaires se montraient rarement. Nombre de peuplades indigènes n’avaient jamais reçu les enseignements civilisateurs du christianisme, ou, du moins, étaient demeurées à l’état sauvage. Les chercher jusqu’à ces régions limitrophes de l’empire du Brésil, telle fut l’œuvre à laquelle le missionnaire français se sentit appelé, et, personne ne soupçonnant rien de sa vie antérieure, il partit au commencement de l’année 1879.
Après avoir remonté le cours moyen de l’Orénoque, le Père Esperante, qui parlait l’espagnol comme sa langue maternelle, arriva à San-Fernando, où il séjourna quelques mois. C’est de cette bourgade qu’il adressa une lettre à l’un de ses amis, notaire à Nantes. Cette lettre, – la dernière qui devait être signée de son vrai nom et que nécessitait le règlement d’une affaire de famille, – il priait le destinataire de la tenir secrète.
Il convient de rappeler ici que ladite lettre, trouvée dans les papiers de ce notaire, ne fut communiquée au sergent Martial qu’en 1891, alors que Jeanne de Kermor était déjà revenue près de lui depuis six ans.
A San-Fernando, grâce à ses ressources personnelles, le Père Esperante put se procurer le matériel nécessaire à la création d’un établissement au-delà des sources du fleuve. Ce fut aussi dans cette bourgade qu’il s’adjoignit le frère Angelos, déjà familiarisé avec les mœurs indiennes, et qui devait apporter un concours non moins utile que dévoué à son œuvre.
Le frère Angelos appela l’attention du Père Esperante sur ces Guaharibos, dont le plus grand nombre errent le long des rives du haut Orénoque et dans le voisinage de la sierra Parima. En évangélisant ces Indiens, il y avait à faire acte de charité, car ils étaient des plus misérables, acte de civilisation, car ils comptaient parmi les plus farouches des indigènes du Venezuela. Ces Guaharibos avaient, on ne l’ignore pas, une réputation de pillards, de massacreurs et même d’anthropophages, réputation qu’ils ne méritaient point. Or, cela n’était pas pour arrêter un homme aussi déterminé que l’ex-colonel de Kermor, et il résolut de créer un centre de mission dans le nord du Roraima, en groupant autour de lui les indigènes de la région.
Le Père Esperante et le frère Angelos quittèrent San-Fernando sur deux pirogues, largement approvisionnées des objets indispensables au début de leur établissement. Le reste du matériel devait leur être envoyé au fur et à mesure des besoins de la petite colonie. Les falcas remontèrent le fleuve, relâchant aux principales bourgades et aux ranchos riverains, et elles atteignirent le rio Torrida, sur le territoire des Guaharibos.
Après plus d’une tentative infructueuse, après bien des déboires, bien des dangers, les Indiens furent entraînés par les promesses du Père Esperante, par sa bonté, par sa générosité. Un village prit place sur la carte, auquel le missionnaire donna le nom de Santa-Juana, – Juana, ce nom qui avait été celui de sa fille…
Quatorze ans s’écoulèrent. La Mission avait prospéré, on sait dans quelles conditions. Il semblait donc que rien ne relierait plus le Père Esperante à son douloureux passé, lorsque se produisirent les événements sur lesquels repose cette histoire.
Après les paroles du sergent Martial, le colonel avait pressé Jeanne dans ses bras, et ce fut comme un baptême de larmes qu’il répandit sur le front de son enfant. En quelques mots, la jeune fille lui raconta sa vie, son sauvetage à bord du Vigo, son existence dans la famille Eredia à la Havane, son retour en France, les quelques années vécues dans la maison de Chantenay, la résolution qui fut prise dès que le sergent Martial et elle eurent connaissance de la lettre écrite de San-Fernando, le départ pour le Venezuela sous le nom et l’habit de Jean, le voyage sur l’Orénoque, l’attaque du forçat Alfaniz et des Quivas au gué de Frascaès, et enfin cette miraculeuse délivrance…
Tous deux revinrent alors vers la charrette, près du vieux soldat. Le sergent Martial se sentait ranimé. Il rayonnait… il pleurait aussi, et toujours ces mots qui s’échappaient de ses lèvres:
«Mon colonel… mon colonel!… maintenant que notre Jeanne a retrouvé son père… je puis mourir…
– Je te le défends bien, mon vieux compagnon!
– Ah! si vous me le défendez…
– Nous te soignerons… nous te guérirons…
– Si vous me soignez… je ne mourrai pas… bien sûr!…
– Mais il te faut du calme…
– J’en ai, mon colonel! Tenez… voilà le sommeil qui me reprend… et c’est du bon sommeil, cette fois…
– Dors, mon vieil ami, dors!… Nous allons revenir à Santa-Juana… La route ne te causera aucune fatigue, et tu seras sur pied dans quelques jours.»
Le colonel de Kermor s’était penché sur la litière, il avait posé ses lèvres sur le front du sergent Martial, et «son vieil ami» s’était endormi tout souriant.
«Mon père, s’écria Jeanne, nous le sauverons…
– Oui… ma Jeanne chérie… avec l’aide de Dieu!» répondit le missionnaire.
Du reste, Germain Paterne et lui avaient examiné la blessure du sergent Martial, et il ne leur semblait pas qu’elle dût avoir des suites mortelles. On sut alors que l’assassin, c’était Alfaniz, qui avait frappé le vieux soldat au moment où celui-ci, dans un accès de fureur, s’était jeté sur lui.
Le Père Esperante dit alors:
«Aujourd’hui, j’entends que mes braves Indiens se reposent et aussi vos compagnons, monsieur Helloch, car ils en ont besoin… Demain matin, nous reprendrons le chemin de la Mission, et Gomo nous y guidera par le plus court…
– C’est à ce courageux enfant que nous devons notre salut… fit observer Jeanne.
– Je le sais», répondit le Père Esperante.
Et, appelant le jeune Indien:
«Viens, Gomo, dit-il, viens!… Je t’embrasse pour tous ceux que tu as sauvés!»
Et, après être sorti des bras du Père Esperante, Gomo passa entre ceux de Jeanne qu’il continuait, dans son trouble, d’appeler: mon ami Jean!…
Comme la jeune fille n’avait point abandonné les vêtements masculins qu’elle portait depuis le commencement du voyage, son père se demandait si ses compagnons savaient que «monsieur Jean» était Mlle Jeanne de Kermor.
Il n’allait pas tarder à l’apprendre.
Dès qu’il eut serré les mains de Jacques Helloch et de Germain Paterne, de Parchal et de Valdez, ces deux honnêtes patrons dont le dévouement, au cours de cette longue et pénible navigation, n’avait jamais faibli, Jeanne prit la parole:
«Mon père, il faut que je vous dise tout ce que je dois à mes deux compatriotes envers lesquels il me sera impossible de jamais m’acquitter…
– Mademoiselle… répondit Jacques Helloch, dont la voix tremblait, je vous en prie… je n’ai rien fait…
– Laissez-moi parler, monsieur Helloch…
– Alors parlez de Jacques, mais non de moi, mademoiselle de Kermor, s’écria Germain Paterne en riant, car je ne mérite aucunement.
– Je suis votre obligée à tous les deux, mes chers compagnons, reprit Jeanne, oui… à tous les deux, mon père!… Si M. Helloch m’a sauvé la vie…
– Vous avez sauvé la vie de ma fille?…» s’écria le colonel de Kermor.
Et il fallut bien que Jacques Helloch entendît le récit que fit Jeanne du naufrage des pirogues en vue de San-Fernando, et comment, grâce à son dévouement, elle avait échappé à la mort.
Et la jeune fille ajouta:
«Je disais, mon père, que M. Helloch m’a sauvé la vie, mais il a fait plus encore, en nous accompagnant, Martial et moi, en s’associant à nos recherches… avec M. Germain Paterne…
– Par exemple! répliqua ce dernier en protestant. Croyez bien… mademoiselle… nous avions l’intention de remonter jusqu’aux sources de l’Orénoque… C’était notre mission… le ministre de l’Instruction publique…
– Non, monsieur Germain, non, répondit Jeanne en souriant. Vous deviez vous arrêtez à San-Fernando, et si vous êtes venus jusqu’à Santa-Juana…
– C’est que c’était notre devoir!» déclara simplement Jacques Helloch.
Il va de soi que des détails plus complets seraient ultérieurement donnés au colonel de Kermor, et qu’il connaîtrait les divers incidents de cet aventureux voyage. Mais, en attendant, malgré la réserve voulue de Jacques Helloch, en voyant Jeanne si reconnaissante, le père ne comprenait-il pas déjà quels sentiments débordaient du cœur de sa fille…?
Pendant que Jeanne de Kermor, Jacques Helloch, Germain Paterne et lui causaient de ces choses, Parchal et Valdez préparaient le campement en vue d’y passer le reste de la journée et la nuit suivante. Leurs hommes avaient transporté dans la forêt les corps de tous ceux qui avaient succombé.
Quant aux Guaharibos blessés dans la lutte, Germain Paterne allait s’occuper de leur pansement.
Puis, après que les provisions eurent été retirées des charrettes, afin que chacun en prît sa part, tandis que des foyers de bois s’allumaient à différentes places, Jacques Helloch et Germain Paterne, suivis du colonel de Kermor et de sa fille, se dirigèrent vers les deux pirogues, à sec sur la grève. N’avaient-elles pas été détruites par les Quivas?
Il n’en était rien, car Alfaniz comptait s’en servir pour revenir vers les territoires de l’ouest, en remontant le Ventuari. Qu’une crue du fleuve vînt à se produire, et les deux falcas seraient prêtes à redescendre son cours.
«Merci à ces coquins, s’écria Germain Paterne, qui ont bien voulu respecter mes collections!… Me voyez-vous revenant sans elles en Europe!… Après avoir tant photographié en route, ne pas rapporter un seul cliché!… Jamais je n’aurais osé me représenter devant le ministre de l’Instruction publique !»
On conçoit cette joie du naturaliste, et aussi la satisfaction des autres passagers de la Gallinetta et de la Moriche, en retrouvant à bord leur matériel de voyage, sans parler des armes qu’ils ramassèrent dans la clairière.
A présent les pirogues pouvaient rester sans rien craindre près de l’embouchure du rio Torrida, sous la garde des équipages. Lorsque l’heure serait venue de se rembarquer, – tout au moins dans la Moriche, – Jacques Helloch et Germain Paterne n’auraient qu’à monter à bord.
En somme, il n’était pas encore question de départ. Le Père Esperante allait ramener à Santa-Juana sa fille Jeanne, le sergent Martial, le jeune Gomo et le plus grand nombre de ses Indiens. Et comment les deux Français n’eussent-ils pas accepté de passer quelques jours, ou même quelques semaines, à la Mission, dans la maison d’un compatriote?…
Ils acceptèrent.
«Il le faut, fit observer Germain Paterne à Jacques Helloch. Nous vois-tu retourner en Europe sans avoir visité Santa-Juana!… Jamais je n’oserais me présenter devant le ministre de l’Instruction publique, – ni toi, Jacques…
– Ni moi, Germain…
– Parbleu!»
Pendant cette journée, les repas furent pris en commun sur les réserves des pirogues et les approvisionnements apportés de la bourgade. Le sergent Martial seul y manqua, mais il était si heureux, si heureux d’avoir retrouvé son colonel, – même sous la robe du Père Esperante!… Le bon air de Santa-Juana le rétablirait en quelques jours!… Il n’en doutait pas…
Il va sans dire que Jacques Helloch et Jeanne avaient dû faire au colonel de Kermor un récit détaillé du voyage. Il les écoutait, il observait, il devinait sans peine les sentiments dont le cœur de Jacques Helloch était rempli, et il demeurait pensif… En effet, quels nouveaux devoirs allait lui créer cette situation nouvelle?…
Il va sans dire que la jeune fille revêtit dès ce jour-là les vêtements de son sexe, – vêtements soigneusement renfermés dans une valise placée sous le rouf de la Gallinetta.
Et Germain Paterne de déclarer à son ami:
«Charmante en garçon… charmante en fille!… Il est vrai… je n’y entends rien!…»
Le lendemain, après avoir pris congé de Parchal et de Valdez, lesquels préféraient demeurer à la garde des pirogues, le Père Esperante, ses hôtes et les Guaharibos quittèrent le campement du pic Maunoir. Avec les chevaux et les charrettes, le cheminement s’effectuerait sans fatigues à travers les forêts et la savane.
On ne crut pas devoir se diriger par la route antérieurement suivie vers les sources de l’Orénoque. Le plus court était de longer la rive droite du rio, ainsi que l’avait fait Jacques Helloch sous la conduite du jeune Indien. Et la marche fut si rapide que, dès midi, on avait atteint le gué de Frascaès.
Aucune trace des Quivas, dispersés maintenant, n’avait été retrouvée, et ils n’étaient plus à craindre.
Là, il y eut une courte halte, et, le mouvement de la charrette n’ayant point trop fatigué le sergent Martial, on se remit en marche vers Santa-Juana.
La distance entre le gué et la bourgade put être franchie en quelques heures, et, dans l’après-midi, la Mission était atteinte.
A l’accueil dont le Père Esperante fut l’objet, Jacques Helloch et ses compagnons comprirent combien il était aimé de ses fidèles Indiens. Deux chambres furent réservées dans le presbytère à Jeanne de Kermor et au sergent Martial, deux autres à Jacques Helloch et à Germain Paterne dans une case voisine, dont le frère Angelos leur fit les honneurs.
Le lendemain, la cloche de l’église appela toute la bourgade à une messe d’action de grâces. Pendant cette messe dite par le Père Esperante, quelle impression éprouva la jeune fille, lorsqu’elle vit pour la première fois son père devant l’autel. Et quelle eût été celle du sergent Martial, s’il avait pu être présent à cet office célébré par son colonel!…
Il est inutile de raconter par le menu ces journées qui s’écoulèrent à la Mission de Santa-Juana. Que l’on sache, avant tout, que la santé du blessé se refit à vue d’œil. Dès la fin de la semaine, il avait permission de s’asseoir dans un bon fauteuil de cuir de cerf, à l’ombre des palmiers.
Le colonel de Kermor et sa fille avaient eu de longues conversations sur le passé. Jeanne apprit alors comment, époux privé de sa femme, père privé de ses enfants, il avait voulu mettre toute sa vie dans cette œuvre apostolique. Pourrait-il donc l’abandonner maintenant, la laissant inachevée?… Non, assurément… Jeanne resterait près de lui… elle lui consacrerait son existence entière…
Et, à ces entretiens succédaient ceux du Père Esperante et du sergent Martial.
Le missionnaire remerciait le vieux soldat de ce qu’il avait fait pour sa fille… Il le remerciait d’avoir consenti à ce voyage… Puis il l’interrogeait sur le compte de Jacques Helloch… Il lui demandait s’il ne les avait pas observés tous deux… Jeanne et lui…
«Que voulez-vous, mon colonel, répondait le sergent Martial, j’avais pris toutes mes précautions… C’était Jean… un jeune gars de Bretagne… un neveu que son oncle faisait voyager dans ce pays de sauvages… Il a fallu que Jacques Helloch et notre chère fille se soient rencontrés en route… J’ai tout fait pour empêcher… je n’ai pas pu!… Le diable s’en est mêlé…
– Non… Dieu, mon brave compagnon!…» répondit le Père Esperante.
Cependant le temps marchait et les choses n’avançaient pas. En somme, pourquoi Jacques Helloch hésitait-il à parler?… Se trompait-il donc?… Non… ni sur ses propres sentiments, ni sur ceux qu’il avait inspirés à Jeanne de Kermor. Mais, par une discrétion qui l’honorait, il gardait le silence… C’eût été là, lui semblait-il, réclamer le prix des services rendus…
Très à propos, Germain Paterne brusqua les choses, et, un jour, il dit à son ami:
«Quand partons-nous?…
– Quand tu voudras, Germain.
– Entendu!… Seulement, lorsque je le voudrai, tu ne le voudras pas…
– Et pourquoi?…
– Parce que Mlle de Kermor sera mariée alors…
– Mariée!…
– Oui… car je vais demander sa main…
– Tu vas… s’écria Jacques.
– Pas pour moi… bien sûr… mais pour toi!…»
Et il fit comme il disait, – sans s’arrêter à des objections qu’il jugeait inacceptables.
Jacques Helloch et Jeanne de Kermor comparurent devant le missionnaire en présence de Germain Paterne et du sergent Martial. Puis, sur la demande que lui fit son père:
«Jacques, dit la jeune fille d’une voix profondément émue, je suis prête à devenir votre femme… et ce ne sera pas trop de toute ma vie pour vous prouver ma reconnaissance…
– Jeanne… ma chère Jeanne… répondit Jacques Helloch, je vous aime… oui!… je vous aime…
– N’en dis pas davantage, cher ami, s’écria Germain Paterne. Tu ne trouverais pas mieux!»
Et le colonel de Kermor attira ses deux enfants qui s’unirent sur son cœur.
Il fut convenu que le mariage serait célébré dans une quinzaine de jours à Santa-Juana. Après les avoir mariés comme chef civil de la Mission, le Père Esperante donnerait aux nouveaux époux la bénédiction nuptiale, qui serait aussi la bénédiction paternelle. Jacques Helloch, libre de sa personne, et dont le colonel de Kermor avait autrefois connu la famille, n’avait aucun consentement à demander. Sa fortune et celle de Jeanne, confiée au sergent Martial, suffiraient à leur assurer une large aisance. Quelques semaines après le mariage, ils partiraient, ils passeraient par la Havane afin d’y voir la famille Eredia. Puis ils retourneraient en Europe, en France, en Bretagne pour terminer leurs affaires. Enfin ils reviendraient à Santa-Juana, où ils retrouveraient le colonel de Kermor et son vieux soldat.
Ainsi allèrent les choses, et le 25 novembre, devant la population en fête, en présence de Germain Paterne et du sergent Martial, témoins des jeunes époux, le père célébra le mariage civil et religieux de sa fille Jeanne de Kermor avec Jacques Helloch.
Touchante cérémonie, et qu’on ne s’étonne pas de l’émotion profonde qu’elle produisit, qui se manifesta par une joie débordante chez ces braves Guaharibos.
Près d’un mois s’écoula, et il vint à l’esprit de Germain Paterne qu’il était peut-être temps d’aller rendre compte de la mission scientifique dont son compagnon et lui avaient été chargés par le ministre de l’Instruction publique. On le voit, c’était toujours son ministre qu’il faisait intervenir.
«Déjà?…» répondit Jacques Helloch.
C’est qu’il n’avait pas compté les jours… Il était trop heureux pour se livrer à de tels calculs!
«Oui… déjà!… répliqua Germain Paterne. Son Excellence doit croire que nous avons été dévorés par des jaguars venezueliens… à moins que ce ne soit dans l’estomac des Caraïbes que nous ayons terminé notre carrière scientifique!»
D’accord avec le Père Esperante, le départ de la Mission fut fixé au 22 décembre.
Ce n’était pas sans un serrement de cœur que le colonel de Kermor voyait arriver l’heure de se séparer de sa fille, bien qu’elle dût lui revenir dans quelques mois. Il est vrai, ce voyage se ferait en des conditions favorables, et Mme Jacques Helloch ne courrait plus les mêmes dangers que Jeanne de Kermor. Cette descente du fleuve s’effectuerait rapidement jusqu’à Ciudad-Bolivar. Sans doute, on serait privé de MM. Miguel, Felipe et Varinas, car ils devaient avoir quitté San-Fernando.
Mais, en cinq semaines, les pirogues auraient atteint Caïcara, où l’on prendrait le paquebot du bas Orénoque. Quant au retour à Santa-Juana… on pouvait s’en rapporter à Jacques Helloch, il s’accomplirait avec toutes les chances de rapidité et de sécurité possibles.
«Et puis, mon colonel, fit observer le sergent Martial, notre fille a un bon mari pour la défendre, et ça vaut mieux qu’un vieux bonhomme de soldat… une vieille bête… qui n’a pas même été capable de la sauver… ni des flots de l’Orénoque… ni de l’amour de ce brave Jacques Helloch !»
![]()
Au revoir
![]() e 25 décembre, dans la matinée, les pirogues étaient prêtes à redescendre le cours du fleuve.
e 25 décembre, dans la matinée, les pirogues étaient prêtes à redescendre le cours du fleuve.
À cette époque de l’année, les crues n’avaient pas encore relevé le niveau de l’Orénoque. Il avait donc fallu traîner la Gallinetta et la Moriche à cinq kilomètres en aval, à l’embouchure d’un petit rio de la rive droite, où la profondeur de l’eau était suffisante. À partir de cet endroit elles ne couraient plus que le risque de s’engraver pendant quelques heures, et non celui de demeurer à sec jusqu’au début de la saison pluvieuse.
Le Père Esperante voulut reconduire ses enfants au nouveau campement. Le sergent Martial, entièrement rétabli, se joignit à lui, en même temps que le jeune Indien, devenu enfant adoptif de la Mission de Santa-Juana.
Une cinquantaine de Guaharibos leur firent escorte, et tous arrivèrent heureusement à l’embouchure du rio.
L’heure du départ venue, Valdez prit son poste dans la Gallinetta, où Jacques Helloch et sa femme devaient s’embarquer. Parchal reprit le sien dans la Moriche, dont le rouf abriterait à la fois les précieuses collections de Germain Paterne et sa non moins précieuse personne.
Comme les deux falcas devaient naviguer de conserve, et le plus souvent bord à bord, Germain Paterne n’en serait pas réduit à sa seule société. Autant qu’il le voudrait, il tiendrait compagnie aux jeunes époux. En outre, – cela va de soi, – les repas se prendraient en commun à bord de la Gallinetta, sauf le cas où Jacques et Jeanne Helloch accepteraient une invitation de Germain Paterne à bord de la Moriche.
Le temps était favorable, c’est-à-dire que le vent soufflait de l’est en bonne brise. Les rayons solaires tamisés par un léger voile de nuages, rendaient la température très supportable.
Le colonel de Kermor et le sergent Martial descendirent au pied de la berge pour embrasser leurs chers enfants. Ni les uns ni les autres ne cherchèrent à se défendre d’une émotion bien naturelle. Jeanne, si énergique pourtant, pleurait silencieusement entre les bras de son père…
«Je te ramènerai à lui, ma chère Jeanne!… dit Jacques Helloch. Dans quelques mois, nous serons tous les deux de retour à Santa-Juana…
– Tous les trois… ajouta Germain Paterne, car j’ai dû oublier de récolter quelques-unes de ces plantes rares… qui ne poussent que sur les territoires de la Mission… et je prouverai au ministre de l’Instruction publique…
– Adieu… mon bon Martial… adieu, dit la jeune femme, en embrassant le vieux soldat.
– Oui… Jeanne… et pense à ton bonhomme d’oncle… qui ne t’oubliera jamais!…»
Puis, ce fut le tour de Gomo, lequel eut sa bonne part de ces embrassements.
«Adieu… mon père… dit Jacques Helloch en serrant la main du missionnaire, et au revoir… au revoir!»
Jacques Helloch, sa femme et Germain Paterne embarquèrent dans la Gallinetta.
Les voiles furent hissées, les amarres larguées, et les deux pirogues suivirent le fil du courant, au moment où le Père Esperante tendait le bras pour leur donner une dernière bénédiction.
Puis le sergent Martial, le jeune Indien et lui, escortés des Guaharibos, reprirent le chemin de la Mission.
Il n’y a pas lieu de raconter étape par étape cette navigation des falcas à la descente de l’Orénoque. Le voyage, grâce au courant, exigerait trois ou quatre fois moins de temps et dix fois moins d’efforts, il présenterait dix fois moins de dangers que s’il se fût agi de remonter vers les sources du fleuve. L’emploi de l’espilla ne devint jamais nécessaire pour le halage des pirogues, et les palancas suffirent, lorsque la brise tombait ou devenait contraire.
Les passagers revirent alors comme dans un tableau mouvant les lieux par lesquels ils avaient déjà passé, – les mêmes villages, les mêmes ranchos, les mêmes raudals, les mêmes rapides. La crue commençant à se faire sentir, les falcas trouvèrent assez d’eau pour éviter un déchargement, et le voyage s’accomplissait sans peine ni fatigues.
Mais quel contraste, lorsque la jeune femme et son mari se rappelaient les tourments, les inquiétudes, les périls de cette navigation quelques semaines avant!
En vue du sitio du capitan de Mavaca, Jeanne se souvint: c’est là qu’elle eût succombé à la fièvre, si Jacques Helloch n’eût découvert ce précieux coloradito qui avait empêché le retour d’un mortel accès…
Puis on reconnut, non loin du cerro Guaraco, l’endroit où le troupeau de bœufs avait été attaqué par ces terribles gymnotes électriques…
Puis, à Danaco, Jacques Helloch présenta sa femme à Manuel Assomption, chez lequel, en compagnie de Germain Paterne, ils acceptèrent l’hospitalité d’un jour. Et quelle fut la surprise des braves gens du rancho, lorsqu’ils retrouvèrent dans cette belle jeune femme le neveu Jean qui avait occupé avec son oncle Martial une des cases du village mariquitare!…
Enfin, le 4 janvier, la Gallinetta et la Moriche abandonnèrent le cours de l’Orénoque pour celui de l’Atabapo, et elles vinrent s’amarrer au quai de la bourgade.
Il y avait trois mois, Jacques Helloch et ses compagnons avaient laissé à San-Fernando MM. Miguel, Felipe et Varinas. Les trois collègues s’y trouvaient-ils encore?… On avouera que c’était improbable. Après avoir traité à fond la question de l’Orénoque, du Guaviare et de l’Atabapo, ils devaient s’être remis en route pour Ciudad-Bolivar.
Et, maintenant, lequel des trois fleuves l’avait emporté, c’est ce que Germain Paterne était assez curieux de savoir. Or, comme les falcas exigeraient une relâche de quelques jours afin de se ravitailler avant de descendre vers Caïcara, il aurait le temps de satisfaire sa curiosité.
Jacques Helloch, sa femme et Germain Paterne débarquèrent donc et prirent logement dans la case que le sergent Martial avait déjà habitée.
Le jour même, ils firent visite au gouverneur, lequel apprit avec satisfaction les événements dont la Mission de Santa-Juana avait été le théâtre, – d’une part, la destruction presque complète de la bande d’Alfaniz, – de l’autre, l’heureux résultat du voyage.
Quant à M. Miguel, à M. Felipe, à M. Varinas, – qu’on ne s’en étonne pas! – ils n’avaient point quitté la bourgade, encore moins d’accord sur la question hydrographique des trois fleuves qu’ils ne l’étaient au départ de Ciudad-Bolivar.
En effet, le soir même, les passagers de la Gallinetta et de la Moriche purent serrer la main des trois passagers de la Maripare.
Quel bon accueil M. Miguel et ses collègues firent à leurs anciens compagnons de voyage! On imagine aussi leur surprise, lorsqu’ils virent Jean… leur cher Jean… au bras de Jacques Helloch, avec des vêtements de femme.
«Nous direz-vous pourquoi il est ainsi travesti?… demanda M. Varinas.
– Parce que je l’ai épousé… répondit Jacques Helloch.
– Vous avez épousé Jean de Kermor?… s’écria M. Felipe, dont les yeux s’agrandirent démesurément.
– Non… Mlle Jeanne de Kermor.
– Quoi!… dit M. Miguel, Mlle de Kermor?…
– Est la sœur de Jean! répondit en riant Germain Paterne. Hein! comme ils se ressemblent!»
Tout s’expliqua, et les compliments les plus sincères furent adressés aux nouveaux époux, comme les plus vives félicitations à Mme Jacques Helloch, puisqu’elle avait retrouvé son père, le colonel de Kermor, dans le missionnaire de Santa-Juana.
«Et l’Orénoque?… demanda Germain Paterne… Il est toujours à sa place?…
– Toujours, déclara M. Miguel.
– Eh bien… est-ce lui dont les eaux ont porté nos pirogues jusqu’aux sources de la sierra Parima?…»
A cette question, les figures de MM. Varinas et Felipe se rembrunirent. Leurs yeux lancèrent des éclairs, précurseurs d’orages, tandis que M. Miguel hochait la tête.
Et alors la discussion de reprendre avec une vigueur que le temps n’avait pu diminuer, entre le partisan de l’Atabapo et le partisan du Guaviare. Non!… ils n’étaient point d’accord, ils ne le seraient jamais, et, plutôt que de céder l’un à l’autre, ils eussent donné raison à M. Miguel et conclu en faveur de l’Orénoque!
«Répondez à ceci, monsieur, s’écria M. Varinas, et niez, si vous l’osez, que le Guaviare n’ait pas été désigné maintes fois sous le nom d’Orénoque occidental par des géographes d’une véritable compétence…
– D’une incompétence égale à la vôtre, monsieur!» s’écria M. Felipe.
Et l’on remarquera que, dès les premiers mots, la discussion s’élevait à son maximum d’intensité. Qu’on n’en soit pas étonné, d’ailleurs, puisque, chaque jour, du lever au coucher du soleil, cette discussion mettait aux prises les deux adversaires. Et si leurs arguments n’étaient pas usés jusqu’à la corde, c’est que probablement ils étaient inusables!
Et M. Varinas de répliquer:
«Prendre sa source dans la sierra Suma-Paz, à l’est du haut Magdalena, sur les territoires de la Colombie, cela est autrement honorable que de sourdre on ne sait d’où…
– On ne sait d’où, monsieur?… riposta aigrement M. Felipe. Vous avez l’aplomb d’employer de pareils termes, lorsqu’il s’agit de l’Atabapo, qui descend de ces llanos arrosés par le rio Negro, et alors que ce grand fleuve établit une communication avec le bassin de l’Amazone!
– Mais les eaux de votre Atabapo sont noires et ne parviennent même pas à se mélanger avec celles de l’Orénoque!
– Mais les eaux de votre Guaviare sont d’un blanc jaunâtre, et vous ne seriez pas capable de les distinguer à quelques kilomètres en aval de San-Fernando!
– Mais le Guaviare, monsieur Varinas, est un fleuve à caïmans, il en possède des milliers comme l’Orénoque, tandis que l’Atabapo en est réduit à des poissons ridicules, qui sont sans valeur, malingres et noirs comme lui-même!
– Envoyez donc des navires sur votre Atabapo, monsieur Felipe, et vous verrez s’ils iront loin, à moins de portages, tandis que ceux du Guaviare peuvent le remonter pendant mille kilomètres jusqu’au confluent de l’Ari-Ari… et même au-delà!
– Portages ou non, monsieur Varinas, il n’en est pas moins vrai que nous sommes le lien hydrographique entre l’Amazonie et la république venezuelienne!
– Et nous entre le Venezuela et la Colombie!
– Allons donc!… N’avez-vous pas l’Apure pour former ce lien de navigation?…
– Et vous… n’avez-vous pas le Cassiquiare?…
– Votre Guaviare n’a seulement pas de tortues…
– Votre Atabapo n’a seulement pas de moustiques…
– Enfin le Guaviare se jette dans l’Atabapo… ici même… de l’avis de tout le monde…
– Non… c’est l’Atabapo qui se jette dans le Guaviare, ainsi que tous les gens de bonne foi en conviennent, et l’apport du Guaviare n’est pas inférieur à trois mille deux cents mètre cubes…
– Et, comme le Danube, dit alors Germain Paterne, en citant le poète des Orientales:
…Il coule
De l’Occident à l’Orient.»
Un argument dont M. Varinas ne s’était pas encore servi, mais qu’il inséra précieusement dans le dossier du Guaviare.
Pendant cet échange de répliques en faveur des deux tributaires, M. Miguel ne cessait de sourire, laissant tranquillement couler l’Orénoque sur les deux mille cinq cents kilomètres de son parcours, entre la sierra Parima et l’estuaire de ses cinquante bras, qui se ramifient à travers le littoral de l’Atlantique.
Cependant les préparatifs avançaient. Les pirogues, visitées, réparées, mises en parfait état, réapprovisionnées, seraient prêtes pour le 9 janvier.
Jacques et Jeanne Helloch écrivirent alors une lettre à leur père, – lettre dans laquelle n’étaient oubliés ni le sergent Martial ni le jeune Indien. Cette lettre arriverait à Santa-Juana par les marchands qui, d’ordinaire, remontent le fleuve au début de la saison pluvieuse. Elle disait tout ce que pouvaient dire deux cœurs heureux et reconnaissants.
La veille du départ, les passagers furent conviés une dernière fois chez le gouverneur de San-Fernando. Durant cette soirée il y eut suspension d’armes, et la discussion hydrographique ne se renouvela pas. Non qu’elle fût épuisée, mais les discuteurs avaient des mois et des années pour la reprendre.
«Ainsi, monsieur Miguel, demanda la jeune femme, votre Maripare ne va pas accompagner la Gallinetta et la Moriche?…
– Il paraît que non, madame, répondit M. Miguel, très résigné, d’ailleurs, à prolonger son séjour au confluent de l’Atabapo et du Guaviare.
– Nous avons encore quelques points importants à établir… déclara M. Varinas.
– Et des recherches à faire… ajouta M. Felipe.
– Alors, au revoir, messieurs… dit Jacques Helloch.
– Au revoir?… demanda M. Miguel.
– Oui… répondit Germain Paterne… à San-Fernando… lorsque nous repasserons… dans six mois… car il n’est pas probable que l’interminable question de l’Orénoque…»
Le lendemain, 9 janvier, après avoir reçu les adieux du gouverneur, de M. Miguel et de ses collègues, les voyageurs s’embarquèrent, et, entraînées par le rapide courant du fleuve, – qu’il se nommât Orénoque, Atabapo ou Guaviare, – les deux pirogues eurent bientôt perdu de vue la bourgade de San-Fernando.
À une heure de là, la jeune femme revit l’endroit où les falcas s’étaient échouées sur la rive droite, la place même où Jacques l’avait sauvée au péril de sa vie, pendant cette terrible tourmente du chubasco!
«Oui… ma Jeanne chérie… dit Jacques, et c’est là…
– C’est là, mon Jacques, que te vint la pensée de ne point abandonner ton cher Jean… de l’accompagner au milieu de tant de périls jusqu’au terme de son voyage…
– Et qui ne fut pas content?… s’écria Germain Paterne. Ce fut bien le sergent Martial!… Oh! pas content du tout, l’oncle à son neveu!»
Pendant les jours suivants, les pirogues, favorisées par la brise, eurent une navigation très rapide. Elles franchirent sans trop de difficultés, puisqu’il ne s’agissait que de les descendre, les raudals de Maipure et d’Ature, puis dépassèrent l’embouchure du Meta et le village de Cariben. Les îles giboyeuses du fleuve fournissaient tout le gibier nécessaire, et la pêche ne cessait d’être fructueuse.
On arriva devant le rancho de M. Marchal à la Tigra. Là, promesse faite, promesse tenue. Les passagers des falcas furent pendant vingt-quatre heures les hôtes de cet excellent homme. Et avec quelle joie il les complimenta sur l’issue de leur entreprise, envisagée au double point de vue de la présence du colonel de Kermor à Santa-Juana et de «ce qui s’en était suivi!»
À la Urbana les pirogues eurent à se ravitailler pour la dernière partie de leur expédition.
«Et les tortues?… s’écria Germain Paterne. Jacques… te rappelles-tu les tortues… les myriades de tortues… Hein! être arrivés ici à tortues…
– C’est dans ce village que nous nous sommes rencontrés… la première fois, monsieur Germain, dit la jeune femme.
– Et grâce à ces excellentes bêtes… auxquelles nous devons bien quelque reconnaissance… déclara Jacques Helloch.
– Et nous la leur prouverons en les mangeant, car elle est excellente, la tortue de l’Orénoque!» s’écria Germain Paterne, qui envisageait toujours les choses à un point de vue spécial.
Bref, le 25 janvier, les falcas atteignirent Caïcara.
Ce fut en cette bourgade que Jacques Helloch, Jeanne, Germain Paterne se séparèrent des patrons et de leurs équipages, non sans avoir remercié de tout cœur ces braves gens si dévoués, et dont ils reconnurent généreusement les services.
De Caïcara, le paquebot de l’Apure transporta les voyageurs en deux jours à Ciudad-Bolivar, d’où le chemin de fer les conduisit à Caracas.
Dix jours après, ils étaient à la Havane, près de la famille Eredia, et vingt-cinq jours plus tard en Europe, en France, en Bretagne, à Saint-Nazaire, à Nantes.
Et alors Germain Paterne de dire:
«Sais-tu bien, Jacques… c’est cinq mille kilomètres que nous avons faits sur l’Orénoque!… Est-ce que cela ne t’a point paru un peu long?…
– Pas en redescendant!…» répondit Jacques Helloch, qui regardait Jeanne, heureuse et souriante.