Jules Verne
Le sphinx des glaces
(Chapitre XIII-XVI)
68illustrations par George Roux
12 grandes gravures en chromotypographie et une carte
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
Dirk Peters à la mer.
![]() a question de l’hivernage était tranchée. Des trente-trois hommes embarqués sur l’Halbrane à son départ des Falklands, vingt-trois étaient arrivés sur cette terre, et, de ceux-là, treize venaient de s’enfuir afin de regagner les parages de pêche au-delà de la banquise… Et ce n’était pas le sort qui les avait désignés!… Non!… Afin d’échapper aux horreurs d’un hivernage, ils avaient déserté lâchement!
a question de l’hivernage était tranchée. Des trente-trois hommes embarqués sur l’Halbrane à son départ des Falklands, vingt-trois étaient arrivés sur cette terre, et, de ceux-là, treize venaient de s’enfuir afin de regagner les parages de pêche au-delà de la banquise… Et ce n’était pas le sort qui les avait désignés!… Non!… Afin d’échapper aux horreurs d’un hivernage, ils avaient déserté lâchement!
Par malheur, Hearne n’avait pas seulement entraîné ses camarades. Deux des nôtres, le matelot Burry et le maître-voilier Martin Holt s’étaient joints à lui, – Martin Holt, ne se rendant peut-être pas compte de ses actes sous le coup de l’effroyable révélation que le sealing-master venait de lui faire!…
En somme, la situation n’était pas changée pour ceux que le sort n’eût pas destinés à partir. Nous n’étions plus que neuf, – le capitaine Len Guy, le lieutenant Jem West, le bosseman Hurliguerly, le maître-calfat Hardie, le cuisinier Endicott, les deux matelots Francis et Stern, Dirk Peters et moi. Quelles épreuves nous réservait cet hivernage, alors que s’approchait l’effroyable hiver des pôles!… Quels terribles froids aurions-nous à subir, – plus rigoureux qu’en aucun autre point du globe terrestre, enveloppés d’une nuit permanente de six mois!… On ne pouvait, sans épouvante, songer à ce qu’il faudrait d’énergie morale et physique pour résister dans ces conditions si en dehors de l’endurance humaine!…
Et, cependant, tout compte fait, les chances de ceux qui nous avaient quittés étaient-elles meilleures?… Trouveraient-ils la mer libre jusqu’à la banquise?… Parviendraient-ils à gagner le cercle antarctique?… Et, au-delà, rencontreraient-ils les derniers navires de la saison?… Les provisions ne leur manqueraient-elles pas au cours d’une traversée d’un millier de milles?… Qu’avait pu emporter ce canot déjà trop chargé de treize personnes?… Oui… lesquels étaient les plus menacés, d’eux ou de nous?… Question à laquelle seul l’avenir pouvait répondre!
Lorsque l’embarcation eut disparu, le capitaine Len Guy et ses compagnons, remontant la pointe, revinrent vers la caverne. Enveloppés de l’interminable nuit, c’était là que nous allions passer tout ce temps pendant lequel il nous serait interdit de mettre le pied au-dehors!
Je songeai tout d’abord à Dirk Peters, resté en arrière, après le coup de feu tiré par Hearne, tandis que nous nous hâtions à regagner l’autre côté de la pointe.
Revenu à la caverne, je n’aperçus pas le métis. Avait-il donc été blessé grièvement?… Aurions-nous à regretter la mort de cet homme qui nous était fidèle comme il l’était à son pauvre Pym?…
J’espérais – nous espérions tous – que sa blessure n’offrait pas de gravité. Encore était-il nécessaire de la soigner, et Dirk Peters avait disparu.
«Mettons-nous à sa recherche, monsieur Jeorling, s’écria le bosseman…
– Allons… répondis-je.
– Nous irons ensemble, dit le capitaine Len Guy. Dirk Peters était des nôtres… Jamais il ne nous eût abandonnés, et nous ne l’abandonnerons pas!
– Le malheureux voudra-t-il revenir, fis-je observer, maintenant que l’on sait ce que je croyais n’être su que de lui et de moi?…»
J’appris à mes compagnons pourquoi, dans le récit d’Arthur Pym, le nom de Ned Holt avait été changé en celui de Parker et en quelles circonstances le métis m’en avait informé. Et, d’ailleurs, je fis valoir tout ce qui était à sa décharge.
«Hearne, déclarai-je, a dit que Dirk Peters avait frappé Ned Holt!… Oui!… c’est vrai!… Ned Holt était embarqué sur le Grampus, et son frère, Martin Holt, a pu croire qu’il avait péri soit dans la révolte, soit dans le naufrage. Eh bien, non!… Ned Holt avait survécu avec Auguste Barnard, Arthur Pym, le métis, et, bientôt, tous quatre furent en proie aux tortures de la faim… Il fallut sacrifier l’un d’eux… celui que le sort désignerait… On tira à la courte paille… Ned Holt eut la mauvaise chance… Il tomba sous le couteau de Dirk Peters… Mais si le métis eut été désigné par le sort, c’est lui qui aurait servi de proie aux autres!»
Le capitaine Len Guy fit alors cette observation:
«Dirk Peters n’avait confié ce secret qu’à vous seul, monsieur Jeorling…
– A moi seul, capitaine…
– Et vous l’avez gardé?…
– Absolument.
– Je ne m’explique pas alors comment il a pu venir à la connaissance de Hearne…
– J’avais d’abord pensé, répondis-je, que Dirk Peters avait pu parler pendant son sommeil, et que c’était au hasard que le sealing-master devait de connaître ce secret. Après réflexions, je me suis rappelé la circonstance que voici: lorsque le métis me raconta cette scène du Grampus, lorsqu’il m’apprit que Parker n’était autre que Ned Holt, il se trouvait dans ma cabine dont le châssis latéral était relevé… Or, j’ai lieu de croire que notre conversation a été surprise par l’homme qui se trouvait alors à la barre… Et, cet homme, c’était précisément Hearne, qui, pour mieux entendre, sans doute, avait abandonné la roue, si bien que l’Halbrane fit une embardée…
– Je m’en souviens, dit Jem West, j’interpellai vivement le misérable et l’envoyai à fond de cale.
– Eh bien, capitaine, repris-je, c’est à partir de ce jour que Hearne se lia davantage avec Martin Holt, Hurliguerly me l’avait fait remarquer…
– Parfaitement, répondit le bosseman, car Hearne, n’étant pas capable de diriger le canot dont il songeait à s’emparer, avait besoin d’un maître comme Martin Holt…
– Aussi, repris-je, ne cessa-t-il plus d’exciter Martin Holt à questionner le métis sur le sort de son frère, et vous savez dans quelles conditions il lui apprit cet effroyable secret… Martin Holt fut comme affolé par cette révélation… Les autres l’entraînèrent… et maintenant, il est avec eux!»
Chacun fut d’avis que les choses avaient dû se passer de la sorte. En fin de compte, la vérité étant connue, n’avions-nous pas lieu de craindre que Dirk Peters, dans la disposition d’esprit où il était, eût voulu se soustraire à nos yeux?… Consentirait-il à reprendre sa place parmi nous ?…
Tous, immédiatement, nous avons quitté la caverne, et, après une heure, nous rejoignîmes le métis.
Dès qu’il nous aperçut, son premier mouvement fut de s’enfuir. Enfin Hurliguerly et Francis parvinrent à l’approcher et il ne fit aucune résistance. Je lui parlai… les autres m’imitèrent… le capitaine Len Guy lui tendit la main… Tout d’abord il hésita à la prendre. Puis, sans prononcer un seul mot, il revint vers la grève.
De ce jour, il ne fut plus jamais question entre lui et nous de ce qui s’était passé à bord du Grampus.
Quant à la blessure de Dirk Peters, il n’y eut pas à s’en inquiéter. La balle n’avait fait que pénétrer dans la partie supérieure de son bras gauche, et, rien que par la pression de la main, il était parvenu à l’en faire sortir. Un morceau de toile à voile ayant été appliqué sur la plaie, il endossa sa vareuse, et, dès le lendemain, sans qu’il parût en être autrement gêné, il se remit à ses occupations habituelles.
L’installation fut organisée en vue d’un long hivernage. L’hiver menaçait, et, depuis quelques jours, c’est à peine si le soleil se montrait à travers les brumes. La température tomba à 36° (2° 22 C. sur zéro) et ne devait plus se relever. Les rayons solaires, en allongeant démesurément les ombres sur le sol, ne donnaient pour ainsi dire aucune chaleur. Le capitaine Len Guy nous avait fait prendre de chauds vêtements de laine, sans attendre que le froid devînt plus rigoureux.
Entre-temps, les icebergs, les packs, les streams, les drifts, venaient du sud en plus grand nombre. Si quelques-uns se jetaient encore sur le littoral déjà encombré de glaces, la plupart disparaissaient dans la direction du nord-est.
«Tous ces morceaux-là, me dit le bosseman, c’est autant de matériaux pour consolider la banquise. Pour peu que le canot de ce gueux de Hearne ne les devance pas, j’imagine que ses gens et lui trouveront la porte fermée, et comme ils n’auront pas de clef pour l’ouvrir…
– Ainsi, Hurliguerly, demandai-je, vous pensez que nous courons moins de dangers à hiverner sur cette côte que si nous avions pris place dans l’embarcation?…
– Je le pense et l’ai toujours pensé, monsieur Jeorling! répondit le bosseman. Et puis, savez-vous une chose?… ajouta-t-il en employant sa formule habituelle.
– Dites, Hurliguerly.
– Eh bien, c’est que ceux qui montent le canot seront plus embarrassés que ceux qui ne le montent pas, et, je vous le répète, si le sort m’avait désigné, j’aurais cédé mon tour à un autre!… Voyez-vous, c’est déjà quelque chose que de sentir une terre solide sous son pied!… Après tout, bien que nous ayons été lâchement abandonnés, je ne veux la mort de personne… Mais si Hearne et les autres ne parviennent pas à franchir la banquise, s’ils sont condamnés à passer l’hiver au milieu des glaces, réduits à ces vivres dont ils n’ont que pour quelques semaines, vous savez le sort qui les attend!
– Oui… pire que le nôtre! répondis-je.
– Et j’ajoute, dit le bosseman, qu’il ne suffit pas d’atteindre le cercle antarctique, et si les baleiniers ont déjà quitté les lieux de pêche, ce n’est pas une embarcation chargée et surchargée qui pourra tenir la mer jusqu’en vue des terres australiennes!»
C’était bien mon avis, comme aussi l’avis du capitaine Len Guy et de Jem West. Servi par une navigation favorable, ne portant que ce qu’il pouvait porter, assuré de provisions durant plusieurs mois, enfin avec toutes les chances, peut-être le canot aurait-il été dans des conditions à effectuer ce voyage… En était-il ainsi?… Non, assurément.
Pendant les jours suivants, 14, 15,16 et 17 février, on acheva l’installation du personnel et du matériel.
Quelques excursions furent faites à l’intérieur du pays. Le sol présentait partout la même aridité, ne produisant que ces raquettes épineuses qui poussent dans le sable et dont les grèves étaient abondamment pourvues.
Si le capitaine Len Guy eût conservé un dernier espoir à l’égard de son frère et des matelots de la Jane, s’il s’était dit qu’après avoir pu quitter l’île Tsalal avec une embarcation, les courants les avaient conduits jusqu’à cette côte, il dut reconnaître qu’il n’y existait aucune trace d’un débarquement.
Une de nos excursions nous amena environ à quatre milles au pied d’une montagne d’accès pas difficile, grâce à la longue obliquité de ses pentes, et dont l’altitude mesurait de six à sept cents toises.
De cette excursion que firent le capitaine Len Guy, le lieutenant, le matelot Francis et moi, il ne résulta aucune découverte. Vers le nord et vers l’ouest se déroulait la même succession de collines dénudées, capricieusement découpées à leur cime, et, lorsqu’elles disparaîtraient sous l’immense tapis de neige, il serait difficile de les distinguer des icebergs immobilisés par le froid à la surface de la mer.
Cependant, à propos de ce que nous avions pris pour des apparences de terre à l’est, nous eûmes à constater qu’en cette direction s’étendait une côte dont les hauteurs, éclairées par le soleil de l’après-midi, apparurent assez nettement dans l’objectif de la longue-vue marine.
Était-ce un continent qui bordait ce côté du détroit, n’était-ce qu’une île? Dans tous les cas, l’un ou l’autre devaient être frappés de stérilité comme la terre de l’ouest, et, comme elle, inhabités, inhabitables.
Et lorsque mes pensées revenaient à l’île Tsalal, dont le sol possédait une puissance de végétation si extraordinaire, lorsque je me reportais aux descriptions d’Arthur Pym, je ne savais qu’imaginer. Évidemment, cette désolation dont s’affligeaient nos regards, reproduisait mieux l’idée que l’on se fait des régions australes. Pourtant, l’archipel tsalalais, situé presque à la même latitude, était fertile et populeux, avant que le tremblement de terre l’eût détruit en presque totalité.
Le capitaine Len Guy, ce jour-là, fit la proposition de dénommer géographiquement cette contrée sur laquelle nous avait jetés l’iceberg. Elle fut appelée Halbrane-Land, en souvenir de notre goélette. En même temps, afin de les associer dans un même souvenir, le nom de Jane-Sund fut donné au détroit qui séparait les deux parties du continent polaire.
On s’occupa alors de chasser les pingouins, qui pullulaient sur les roches, et aussi de capturer un certain nombre de ces amphibies qui s’ébattaient le long des grèves. Le besoin de viande fraîche se faisait sentir. Accommodée par Endicott, la chair de phoque et de morse nous parut très acceptable. En outre, la graisse de ces animaux pouvait, à la rigueur, servir au chauffage de la caverne et à la cuisson des aliments. Ne point oublier que notre plus redoutable ennemi serait le froid, et tous les moyens propres à le combattre devaient être utilisés. Restait à savoir si, aux approches de l’hiver, ces amphibies n’iraient pas chercher sous de plus basses latitudes un climat moins rigoureux…
Par bonne chance, il y avait encore des centaines d’autres animaux, qui auraient garanti notre petit monde contre la faim, et, au besoin, contre la soif. Sur les grèves rampaient nombre de ces tortues galapagos, auxquelles on a donné le nom d’un archipel de l’océan équinoxial. Telles étaient celles dont parle Arthur Pym et qui servaient à la nourriture des insulaires, telles celles que Dirk Peters et lui trouvèrent au fond du canot indigène, lors de leur départ de l’île Tsalal.
Énormes, ces chéloniens, à marche mesurée, lourde, lente, au cou grêle long de deux pieds, à la tête triangulaire de serpent, et qui peuvent rester des années sans manger. Ici, d’ailleurs, à défaut de céleri, de persil et de pourpier sauvage, ils s’alimentaient des raquettes qui végétaient entre les pierres du littoral.
Si Arthur Pym s’est permis de comparer aux dromadaires les tortues antarctiques, c’est que, comme ces ruminants, elles ont, à la naissance du cou, une poche remplie d’eau fraîche et douce, d’une contenance de deux à trois gallons. D’après son récit, avant la scène de la courte paille, c’était à l’une de ces tortues que les naufragés du Grampus devaient de n’avoir succombé ni à la soif ni à la faim. A l’en croire, il est de ces tortues de terre ou de mer qui pèsent de douze à quinze cents livres. Si celles d’Halbrane-Land ne dépassaient pas sept à huit cents, leur chair n’en était pas moins aussi nourrissante que savoureuse.
Donc, et bien que nous fussions à la veille d’hiverner à moins de cinq degrés du pôle, la situation, quelque rigoureux que dût être le froid, n’était pas de nature à désespérer des cœurs fermes. La seule question – dont je ne nie pas la gravité – était celle du retour, dès que la mauvaise saison serait passée. Pour que cette question fût résolue, il fallait: 1° que nos compagnons, partis dans le canot, eussent réussi à se rapatrier; 2° que leur premier soin eût été d’envoyer un bâtiment à notre recherche. Et, sur ce point, à défaut des autres, nous pouvions espérer que Martin Holt ne nous oublierait pas. Mais ses camarades et lui parviendraient-ils à atteindre les terres du Pacifique à bord d’un baleinier?… Et puis, la prochaine saison d’été serait-elle propice à une navigation si avancée à travers les mers de l’Antarctide ?…
Nous causions le plus souvent de ces bonnes et mauvaises chances. Entre tous, le bosseman continuait à se montrer confiant, grâce à son heureuse nature et à sa belle endurance. Le cuisinier Endicott partageait sa confiance, ou du moins ne s’inquiétait guère des éventualités à venir, et cuisinait comme s’il eût été devant le fourneau du Cormoran-Vert. Les matelots Stern et Francis écoutaient sans rien dire, et qui sait s’ils ne regrettaient pas de n’avoir point accompagné Hearne et ses compagnons!… Quant au maître-calfat Hardie, il attendait les événements, sans chercher à deviner quelle tournure ils prendraient dans cinq ou six mois.
Le capitaine Len Guy et le lieutenant, comme d’habitude, étaient unis dans les mêmes pensées, les mêmes résolutions. Tout ce qui devrait être tenté pour le salut commun, ils le tenteraient. Peu rassurés sur le sort réservé au canot, peut-être songeaient-ils à essayer d’un voyage vers le nord en traversant à pied les icefields, et pas un de nous n’eût hésité à les suivre. Au surplus, l’heure d’une pareille tentative n’était pas encore arrivée, et il serait temps de se décider, lorsque la mer serait solidifiée jusqu’au cercle antarctique.
Telle était donc la situation, et rien ne semblait devoir la modifier, lorsque, à la date du 19 février, se produisit un incident – incident providentiel, dirai-je, pour ceux qui admettent l’intervention de la Providence au cours des choses humaines.
Il était huit heures du matin. Le temps était calme, le ciel assez clair, le thermomètre à 32° Fahrenheit (zéro C.).
Réunis dans la caverne – moins le bosseman –, en attendant le déjeuner que venait d’apprêter Endicott, nous allions nous asseoir à table, lorsqu’une voix appela du dehors.
Ce ne pouvait être que la voix d’Hurliguerly, et comme ses appels se renouvelaient, nous sortîmes en toute hâte.
Dès qu’il nous aperçut:
«Venez… venez donc!…» cria-t-il.
Debout sur une roche, au pied du morne qui terminait Halbrane-Land au-delà de la pointe, il nous montrait la mer.
«Qu’y a-t-il donc?… demanda le capitaine Len Guy.
– Un canot.
– Un canot?… m’écriai-je.
– Serait-ce celui de l’Halbrane qui reviendrait?… demanda le capitaine Len Guy.
– Non… ce n’est pas lui!…» répondit Jem West.
En effet, une embarcation, que sa forme et ses dimensions ne permettaient pas de confondre avec celle de notre goélette, dérivait sans avirons ni pagaies.
Il semblait bien qu’elle fût abandonnée au courant…
Nous n’eûmes qu’une même idée – s’emparer à tout prix de cette embarcation qui assurerait peut-être notre salut… Mais comment l’atteindre, comment la ramener à cette pointe d’Halbrane-Land?…
Le canot était encore à un mille, et, en moins de vingt minutes, il arriverait par le travers du morne, puis il le dépasserait, car aucun remous ne s’étendait au large, et en vingt autres minutes, il serait hors de vue…
Nous étions là, regardant l’embarcation qui continuait à dériver sans se rapprocher du littoral. Au contraire, le courant tendait à l’en éloigner.
Soudain, un jaillissement d’eau se produisit au pied du morne, comme si un corps fût tombé à la mer.
C’était Dirk Peters qui, débarrassé de ses vêtements, venait de se précipiter du haut d’une roche, et, lorsque nous l’aperçûmes à dix brasses déjà, il nageait dans la direction du canot.
Un hurrah s’échappa de nos poitrines.
Le métis tourna un instant la tête, et, d’une coupe puissante, bondit – c’est le mot – à travers le léger clapotis des lames, ainsi que l’eût fait un marsouin dont il possédait la force et la vitesse. Je n’avais jamais rien vu de pareil, et que ne devait-on pas attendre de la vigueur d’un tel homme!
Dirk Peters parviendrait-il à atteindre l’embarcation avant que le courant l’eût emportée vers le nord-est?…
Et s’il l’atteignait, parviendrait-il, sans avirons, à la ramener vers la côte dont elle s’écartait, ainsi que le faisaient en passant la plupart des icebergs?…
Après nos hurrahs, un encouragement jeté au métis, – nous étions restés immobiles, nos cœurs battant à se rompre. Seul, le bosseman criait de temps en temps: «Va…Dirk…va!»
En quelques minutes, le métis eut gagné de plusieurs encablures dans un sens oblique vers le canot. On ne voyait plus sa tête que comme un point noir à la surface des longues houles. Rien n’annonçait que la fatigue commençât à le prendre. Ses deux bras et ses deux jambes repoussaient l’eau méthodiquement, et il maintenait sa vitesse sous l’action régulière de ces quatre puissants propulseurs.
Oui !… cela ne paraissait plus douteux. Dirk Peters accosterait l’embarcation… Mais, ensuite, ne serait-il pas entraîné avec elle, à moins que – tant sa force était prodigieuse, – il ne pût, en nageant, la remorquer jusqu’à la cote ?…
«Après tout, pourquoi n’y aurait-il pas d’avirons dans ce canot?…» fit observer le bosseman.
Nous verrions bien, lorsque Dirk Peters serait à bord, et il fallait qu’il y fût en quelques minutes, car le canot ne tarderait pas à le dépasser.
«Dans tous les cas, dit alors Jem West, portons-nous en aval… Si l’embarcation atterrit, ce ne sera que très au-dessous du morne.
– Il l’a… il l’a !… Hurrah… Dirk… hurrah!…» cria le bosseman, incapable de se contenir et auquel Endicott joignit son formidable écho.
En effet, le métis, ayant accosté, venait de s’élever à mi-corps le long du canot. Son énorme main le saisit, et, au risque de le faire chavirer, il se hissa sur le plat-bord, l’enjamba, puis s’assit pour reprendre haleine.
Presque aussitôt un cri retentissant arriva jusqu’à nous, poussé par Dirk Peters…
Qu’avait-il donc trouvé au fond de cette embarcation?… C’étaient des pagaies, car on le vit s’installer à l’avant, et, se mettant en direction du rivage, pagayer avec une nouvelle vigueur afin de sortir du courant.
«Venez!» dit le capitaine Len Guy.
Et, dès que nous eûmes contourné la base du morne, nous voilà courant à la lisière de la grève entre les pierres noirâtres dont elle était semée.
A trois ou quatre cents toises, le lieutenant nous fit arrêter.
En effet, le canot avait rencontré l’abri d’une petite pointe qui se projetait en cet endroit, et il fut évident qu’il viendrait y atterrir de lui-même.
Or, il n’était plus qu’à cinq ou six encablures et le remous l’en rapprochait, lorsque Dirk Peters, abandonnant les pagaies, se baissa vers l’arrière, puis se redressa, tenant un corps inerte.
Quel cri déchirant se fit entendre!…
«Mon frère… mon frère!…»
Len Guy venait de reconnaître William Guy dans ce corps que soulevait le métis.
«Vivant… vivant !…» cria Dirk Peters.
Un instant plus tard, le canot avait accosté, et le capitaine Len Guy pressait son frère entre ses bras…
Trois de ses compagnons gisaient inanimés au fond de l’embarcation…
Et ces quatre hommes, c’était tout ce qui restait de l’équipage de la Jane!
![]()
Onze ans en quelques pages.
![]() e titre donné à ce chapitre indique que les aventures de William Guy et de ses compagnons après la destruction de la goélette anglaise, les détails de leur existence sur l’île Tsalal depuis le départ d’Arthur Pym et de Dirk Peters, vont être très succinctement racontés.
e titre donné à ce chapitre indique que les aventures de William Guy et de ses compagnons après la destruction de la goélette anglaise, les détails de leur existence sur l’île Tsalal depuis le départ d’Arthur Pym et de Dirk Peters, vont être très succinctement racontés.
Transportés à la caverne, William Guy et les trois autres matelots, Trinkle, Roberts, Covin, avaient pu être rappelés à la vie. En réalité, c’était la faim – rien que la faim –, qui avait réduit ces malheureux à un état de faiblesse voisin de la mort.
Un peu de nourriture prise avec modération, et quelques tasses de thé brûlant additionné de whisky, leur rendirent presque aussitôt des forces.
Je n’insiste pas sur la scène d’attendrissement dont nous fûmes émus jusqu’au fond de l’âme, lorsque William reconnut son frère Len. Les larmes nous vinrent aux yeux en même temps que les remerciements envers la Providence nous venaient aux lèvres. Ce que nous réservait l’avenir, nous n’y songions même pas, tout à la joie du présent, et qui sait si notre situation n’allait pas changer, grâce à l’arrivée de cette embarcation au rivage d’Halbrane-Land?…
Je dois dire que William Guy, avant d’entamer son histoire, fut mis au courant de nos propres aventures. En peu de mots, il apprit ce qu’il avait hâte d’apprendre, – la rencontre du cadavre de Patterson, le voyage de notre goélette jusqu’à l’île Tsalal, son départ pour de plus hautes latitudes, son naufrage au pied de l’iceberg: enfin la trahison d’une partie de l’équipage qui nous avait abandonnés sur cette terre.
Il connut également ce que Dirk Peters savait de relatif à Arthur Pym, et aussi sur quelles hypothèses peu fondées reposait l’espoir du métis de retrouver son compagnon, dont la mort ne faisait pas plus doute pour William Guy que celle des autres marins de la Jane, écrasés sous les collines de Klock-Klock.
A ce récit, William Guy répondit par le résumé des onze ans qu’il avait passés sur l’île Tsalal.
On ne l’a point oublié, le 8 février 1828, l’équipage de la Jane, n’ayant aucunement lieu de soupçonner la mauvaise foi de la population tsalalaise et de son chef Too-Wit, débarqua, afin de se rendre au village de Klock-Klock, non sans avoir mis en état de défense la goélette à bord de laquelle six hommes étaient restés.
L’équipage, en comptant le capitaine William, le second Patterson, Arthur Pym et Dirk Peters, formait un groupe de trente-deux hommes armés de fusils, de pistolets et de couteaux. Le chien Tigre l’accompagnait.
Arrivée à l’étroite gorge qui conduisait au village, précédée et suivie des nombreux guerriers de Too-Wit, la petite troupe se divisa. Arthur Pym, Dirk Peters et le matelot Allen s’engagèrent à travers une fissure de la colline. A partir de ce moment, leurs compagnons ne devaient plus les revoir.
En effet, à peu de temps de là, une secousse se fit sentir. La colline opposée s’abattit d’un bloc, ensevelissant William Guy et ses vingt-huit compagnons.
De ces malheureux, vingt-deux furent écrasés du coup, et leurs cadavres ne furent jamais retrouvés sous cette masse de terre.
Sept, miraculeusement abrités au fond d’une large déchirure de la colline, avaient survécu. C’étaient William Guy, Patterson, Roberts, Covin, Trinkle, plus Forbes et Lexton, morts depuis. Quant à Tigre, avait-il péri sous l’éboulement ou avait-il échappé, ils l’ignoraient.
Cependant William Guy et ses six compagnons ne pouvaient demeurer en cet endroit étroit et obscur, où l’air respirable ne tarderait pas à manquer. Ainsi que l’avait tout d’abord pensé Arthur Pym, ils s’étaient crus victimes d’un tremblement de terre. Mais, ainsi que lui, ils allaient reconnaître que si la gorge était comblée par les débris chaotiques de plus d’un million de tonnes de terre et de pierre, c’est que cet éboulement avait été artificiellement préparé par Too-Wit et les insulaires de Tsalal. Comme Arthur Pym, il leur fallut, le plus vite possible, échapper à la noirceur des ténèbres, au défaut d’air, aux exhalaisons suffocantes de la terre humide, – alors que, pour employer les expressions du récit, «ils se trouvaient exilés au-delà des confins les plus lointains de l’espérance et qu’ils étaient dans la condition spéciale des morts».
De même que dans la colline de gauche, il existait des labyrinthes à travers la colline de droite, et ce fut en rampant le long de ces sombres couloirs que William Guy, Patterson et les autres atteignirent une cavité où le jour et l’air pénétraient en abondance.
C’est de là qu’ils virent, eux aussi, l’attaque de la Jane par une soixantaine de pirogues, la défense des six hommes demeurés à bord, les pierriers vomissant boulets ramés et mitraille, l’envahissement de la goélette par les sauvages, enfin l’explosion finale qui causa la mort d’un millier d’indigènes en même temps que la destruction complète du navire.
Too-Wit et les Tsalalais furent d’abord épouvantés des effets de cette explosion, mais peut-être encore plus désappointés. Leurs instincts de pillage ne pourraient être satisfaits, puisque, de la coque, du gréement, de la cargaison, il ne restait plus que des épaves sans valeur. Comme ils devaient supposer que l’équipage avait également péri dans l’éboulement de la colline, ils n’avaient pas eu la pensée que quelques-uns eussent survécu. De là vint que Arthur Pym et Dirk Peters, d’une part, William Guy et les siens, de l’autre, purent, sans être inquiétés, séjourner au fond des labyrinthes de Klock-Klock, où ils se nourrirent de la chair de ces butors dont il était facile de s’emparer à la main, et du fruit des nombreux noisetiers qui poussaient sur les flancs de la colline. Quant au feu, ils s’en procurèrent en frottant des morceaux de bois tendre contre des morceaux de bois dur, dont il y avait quantité autour d’eux.
Enfin, après sept jours de séquestration, si Arthur Pym et le métis parvinrent – on le sait – à quitter leur cachette, à descendre au rivage, à s’emparer d’une embarcation, à abandonner l’île Tsalal, William Guy et ses compagnons n’avaient pas trouvé jusqu’alors l’occasion de s’enfuir.
A vingt et un jours de là, le capitaine de la Jane et les siens, toujours enfermés dans le labyrinthe, voyaient arriver le moment où ces oiseaux dont ils vivaient leur feraient défaut. Afin d’échapper à la faim – sinon à la soif, puisqu’une source intérieure leur procurait une eau limpide –, il n’y avait qu’un moyen: c’était de gagner le littoral, puis de s’aventurer au large dans une embarcation indigène… Il est vrai, où les fugitifs iraient-ils et que deviendraient-ils sans provisions?… Néanmoins, ils n’eussent pas hésité à tenter l’aventure s’ils avaient pu profiter de quelques heures de nuit. Or, à cette époque, le soleil ne se couchait pas encore derrière l’horizon du 24° parallèle.
Il est donc probable que la mort fût venue mettre un terme à tant de misères, si la situation n’eût changé dans les circonstances que voici.
Un matin – c’était le 22 février –, dans la matinée, William Guy et Patterson, dévorés d’inquiétude, causaient à l’orifice de la cavité qui donnait sur la campagne. Ils ne savaient plus comment subvenir aux besoins de sept personnes, réduites, alors, à se nourrir uniquement de noisettes, ce qui leur causait de violentes douleurs de tête et d’intestins. Ils apercevaient bien de grosses tortues rampant sur le rivage. Mais comment se fussent-ils risqués à les rejoindre, puisque des centaines de Tsalalais occupaient les grèves, allant, venant, vaquant à leurs occupations, en poussant leur éternel cri de tékéli-li.
Soudain, cette foule parut en proie à une extraordinaire agitation. Hommes, femmes, enfants, se dispersèrent de tous les côtés. Quelques sauvages se jetèrent dans leurs canots comme si un terrible danger les menaçait…
Que se passait-il?…
William Guy et ses compagnons, eurent bientôt l’explication du tumulte qui se produisait sur cette partie du littoral de l’île.
Un animal, un quadrupède, venait d’apparaître, et, se précipitant au milieu des insulaires, il s’acharnait à les mordre, il leur sautait à la gorge, tandis que sa bouche écumante vomissait de rauques hurlements.
Et cependant il était seul, ce quadrupède, et on pouvait l’accabler de pierres ou de flèches… Pourquoi donc des centaines de sauvages manifestaient-ils une pareille épouvante, pourquoi prenaient-ils la fuite, pourquoi paraissaient-ils ne pas oser se défendre contre l’animal qui s’élançait sur eux?…
L’animal était blanc de poil, et, à sa vue, se produisait ce phénomène observé déjà, cette inexplicable horreur du blanc commune à tous les indigènes de Tsalal… Non! on ne saurait se figurer avec quelle frayeur ils poussaient, avec leur tékéli-li, ces cris d’anamoo-moo et de lama-lama!
Et, quelle fut la surprise de William Guy et de ses compagnons, lorsqu’ils reconnurent le chien Tigre!…
Oui! Tigre, qui, échappé à l’effondrement de la colline, s’était sauvé à l’intérieur de l’île… Et, après avoir rôdé aux alentours de Klock-Klock pendant quelques jours, le voici qui était revenu, jetant l’effroi parmi ces sauvages…
On se souvient que le pauvre animal avait déjà éprouvé les atteintes de l’hydrophobie dans la cale du Grampus ?… Eh bien, cette fois, il était enragé… oui ! enragé et menaçait de ses morsures toute cette population affolée…
Voilà pourquoi la plupart des Tsalalais avaient pris la fuite, et aussi leur chef Too-Wit et aussi les Wampos, qui étaient les principaux personnages de Klock-Klock!… Ce fut dans ces extraordinaires circonstances qu’ils abandonnèrent non seulement le village, mais l’île, où nulle puissance n’aurait pu les retenir, où ils ne devaient point remettre le pied!…
Cependant, si les canots suffirent à en transporter le plus grand nombre sur les îles voisines, plusieurs centaines d’indigènes avaient dû rester à Tsalal, faute de moyens de s’enfuir. Quelques-uns ayant été mordus par Tigre, des cas de rage s’étaient déclarés, après une assez courte période d’incubation. Alors – spectacle dont il est impossible de retracer l’horreur –, il s’étaient précipités les uns sur les autres, ils s’étaient déchirés à coups de dents… Et, les ossements que nous avions rencontrés aux environs de Klock-Klock, c’étaient ceux de ces sauvages, qui, depuis onze années, blanchissaient à cette place!…
Quant au malheureux chien, il était allé mourir en un coin de ce littoral, où Dirk Peters avait retrouvé son squelette, auquel tenait encore un collier gravé du nom d’Arthur Pym…
Ainsi, c’est à cette catastrophe – et la puissance géniale d’un Edgar Poe était certes capable de l’imaginer – que fut dû l’abandon définitif de Tsalal. Réfugiés dans l’archipel du sud-ouest, les indigènes avaient pour jamais quitté cette île, où «l’animal blanc» venait d’apporter l’épouvante et la mort…
Puis, après que ceux qui n’avaient pu s’enfuir eussent péri jusqu’au dernier dans cette épidémie de rage, William Guy, Patterson, Trinkle, Covin, Roberts, Forbes, Lexton, se hasardèrent à sortir du labyrinthe, où ils étaient à la veille de mourir de faim.
Durant les années qui suivirent, quelle fut l’existence des sept survivants de cette expédition?…
En somme, elle avait été moins pénible qu’on ne l’aurait dû croire. Leur vie était assurée par les productions naturelles d’un sol extrêmement fertile et la présence d’un certain nombre d’animaux domestiques. Il ne leur manquait que les moyens d’abandonner Tsalal, de revenir vers la banquise, de franchir ce cercle antarctique dont la Jane avait forcé le passage au prix de mille dangers, menacée par la furie des tempêtes, le choc des glaces, les rafales de grêle et de neige!
Quant à construire un canot capable d’affronter un aussi périlleux voyage, comment William Guy et ses compagnons l’auraient-ils fait, faute d’outils nécessaires, et lorsqu’ils en étaient réduits à leurs seules armes, fusils, pistolets et coutelas?…
Donc, il n’y avait à se préoccuper que de s’installer du mieux possible, en attendant une occasion de quitter l’île. Et d’où pourrait-elle venir, si ce n’est de l’un de ces hasards dont dispose seule la Providence?…
Et, en premier lieu, sur l’avis du capitaine et du second, on résolut d’établir un campement sur la côte du nord-ouest. Du village de Klock-Klock, on n’apercevait pas le large. Or, il importait d’être constamment en vue de la mer, pour le cas – si improbable, hélas! – où quelque bâtiment apparaîtrait sur les parages de Tsalal!…
Le capitaine William Guy, Patterson et leur cinq compagnons redescendirent donc à travers le ravin à demi rempli des décombres de la colline, au milieu des scories friables, des blocs de granit noir et de marne grenaillée, où scintillaient des points métalliques. Tel s’était présenté aux yeux d’Arthur Pym l’aspect de ces lugubres régions, «qui, dit-il, marquaient remplacement de la Babylone en ruine !…»
Avant de quitter cette gorge, William Guy eut la pensée d’explorer la faille de droite où Arthur Pym, Dirk Peters et Allen avaient disparu. Cette faille étant obstruée, il lui fut impossible de pénétrer à l’intérieur du massif. Aussi ne connut-il jamais l’existence de ce labyrinthe naturel ou artificiel, qui faisait le pendant de celui qu’il venait d’abandonner, lesquels communiquaient peut-être l’un avec l’autre sous le lit desséché du torrent.
Après avoir franchi cette barrière chaotique qui interceptait la route du nord, la petite troupe se dirigea rapidement vers le nord-ouest.
Là, sur le littoral, à trois milles environ de Klock-Klock, on procéda à une installation définitive au fond d’une grotte à peu près semblable à celle que nous occupions actuellement sur la côte d’Halbrane-Land.
Et c’est en cet endroit que, pendant de longues et désespérantes années, les sept survivants de la Jane vécurent, comme nous allions le faire nous-mêmes, – il est vrai, dans des conditions meilleures, puisque la fertilité du sol de Tsalal offrait des ressources qui manquaient à celui d’Halbrane-Land. En réalité, si nous étions condamnés à périr, lorsque nos provisions seraient épuisées, eux ne l’étaient pas. Ils pouvaient indéfiniment attendre… et ils attendirent…
Ce qui ne faisait aucun doute dans leur esprit, c’est qu’Arthur Pym, Dirk Peters et Allen avaient péri dans l’éboulement – et ce n’était que trop certain pour ce dernier. En effet, auraient-ils jamais imaginé qu’Arthur Pym et le métis, après s’être emparés d’un canot, avaient pu prendre la mer?…
Ainsi que nous le dit William Guy, aucun incident, ne vint rompre la monotonie de cette existence de onze années, aucun, – pas même l’apparition des insulaires, auxquels l’épouvante interdisait l’approche de l’île Tsalal. Nul danger ne les avait menacés pendant cette période. D’autre part, à mesure qu’elle se prolongeait, ils perdaient de plus en plus l’espoir d’être jamais recueillis. Au début, avec le retour de la belle saison, quand la mer redevenait libre, ils s’étaient dit qu’un navire serait envoyé à la recherche de la Jane. Mais, lorsque quatre ou cinq ans se furent écoulés, ils perdirent toute espérance…
En même temps que les produits du sol – et parmi eux ces précieuses plantes antiscorbutiques, le cochléaria, le céleri brun, qui abondaient aux environs de la caverne – William Guy avait ramené du village une certaine quantité de volatiles, des poules, des canards d’espèce excellente, et aussi nombre de ces porcs noirs, très multipliés sur l’île. En outre, sans avoir besoin de recourir aux armes à feu, il fut aisé d’abattre des butors au plumage d’un noir de jais. A ces diverses ressources alimentaires, il convenait d’ajouter les centaines d’œufs d’albatros et de tortues galapagos, enfouis sous le sable des grèves, et, rien que ces tortues de dimensions énormes, d’une chair salubre et nourrissante, auraient suffi aux hiverneurs de l’Antarctide.
Restaient encore les inépuisables réserves de la mer, de ce Jane-Sund, où foisonnaient toutes sortes de poissons jusqu’au fond des criques, – des saumons, des morues, des raies, des antoys, des soles, des rougets, des mulets, des carrelets, des scares, et aussi, sans parler des mollusques, ces savoureuses biches de mer, dont la goélette anglaise comptait prendre une cargaison afin de la vendre sur les marchés du Céleste-Empire.
Il n’y a pas lieu de s’étendre sur cette période, qui va de l’année 1828 à l’année 1839. Certes, les hivers furent très durs. En effet, si l’été faisait généreusement sentir sa bienfaisante influence aux îles du groupe Tsalal, la mauvaise saison, avec son cortège de neiges, de pluies, de rafales, de tourmentes, ne lui épargnait pas ses rigueurs. Le terrible froid régnait en maître sur tout le domaine des terres antarctiques. La mer, encombrée de glaces flottantes, se solidifiait pour six à sept mois. Il fallait attendre la réapparition du soleil avant de retrouver ces eaux libres, telles que les avait vues Arthur Pym, telles que nous les avions rencontrées depuis la banquise.
En somme, l’existence avait été relativement facile à l’île de Tsalal. En serait-il ainsi sur ce littoral aride d’Halbrane-Land que nous occupions? Si abondantes qu’elles fussent, nos provisions finiraient par s’épuiser, et, l’hiver venu, les tortues ne regagnaient-elles pas de plus basses latitudes?…
Ce qui est certain, c’est que, sept mois auparavant, le capitaine William Guy n’avait pas encore perdu un seul de ceux qui s’étaient tirés sains et saufs du guet-apens de Klock-Klock, et cela, grâce à leur robuste constitution, à leur remarquable endurance, à leur grande force de caractère… Hélas! le malheur allait bientôt s’abattre sur eux.
Le mois de mai arrivé – qui correspond en ces contrées au mois de novembre de l’hémisphère septentrional –, déjà commençaient à dériver, au large de Tsalal, les glaces que le courant entraînait vers le nord.
Un jour, l’un des sept hommes ne rentra pas à la caverne. On l’appela, on l’attendit, on se mit à sa recherche… Ce fut en vain.,. Victime de quelque accident, noyé sans doute, il ne reparut pas.,. il ne devait pas reparaître.
C’était Patterson, le second de la Jane, le fidèle compagnon de William Guy.
Quelle douleur causa à tous ces braves gens cette disparition de l’un d’eux, de l’un des meilleurs?… Et n’était-ce pas le présage de prochaines catastrophes?…
Or, ce que William Guy ignorait, ce que nous lui apprîmes alors, c’est que Patterson – dans quelles circonstances, on ne le saurait jamais – avait été emporté à la surface d’un glaçon sur lequel il allait mourir de faim. Et c’était sur ce glaçon, parvenu à la hauteur des îles du Prince-Édouard, rongé par les eaux plus chaudes, et près de se dissoudre, que le bosseman avait découvert le cadavre du second de la Jane…
Lorsque le capitaine Len Guy eut raconté comment, grâce aux notes trouvées dans la poche de son malheureux compagnon, l’Halbrane s’était dirigée vers les mers antarctiques, son frère ne put retenir de grosses larmes…
A la suite de ce premier malheur, d’autres survinrent.
Les sept survivants de la Jane n’étaient plus que six, et bientôt ils n’allaient plus être que quatre, après avoir été réduits à chercher leur salut dans la fuite.
En effet, la disparition de Patterson ne datait que de cinq mois, lorsque, au milieu d’octobre, un tremblement de terre vint bouleverser l’île Tsalal de fond en comble, en même temps qu’il anéantissait presque entièrement le groupe du sud-ouest.
On ne saurait se figurer avec quelle violence s’accomplit ce bouleversement. Nous avions pu en juger, lorsque le canot de notre goélette avait accosté la falaise rocheuse indiquée par Arthur Pym. Assurément, William Guy et ses cinq compagnons n’eussent pas tardé à succomber, s’ils n’avaient eu le moyen de fuir cette île qui maintenant se refusait à les nourrir.
Deux jours après, à quelques centaines de toises de leur caverne, le courant amena un canot qui avait été entraîné au large de l’archipel du sud-ouest.
Charger cette embarcation d’autant de provisions qu’elle en pouvait contenir, s’y embarquer pour abandonner l’île devenue inhabitable, c’est ce que William Guy, Roberts, Covin, Trinkle, Forbes et Lexton voulurent faire sans attendre même vingt-quatre heures.
Par malheur, il régnait alors une brise d’une violence extrême, due aux phénomènes sismiques qui avaient troublé les profondeurs du sol comme les profondeurs du ciel. Résister à cette brise ne fut pas possible, et elle rejeta l’embarcation vers le sud, livrée à ce courant auquel obéissait notre iceberg, lorsqu’il dérivait jusqu’au littoral d’Halbrane-Land.
Pendant deux mois et demi, les malheureux allèrent ainsi à travers la mer libre, sans parvenir à modifier leur direction. Ce fut seulement le 2 janvier de la présente année 1840, qu’ils aperçurent une terre, – celle précisément que baignait à l’est le Jane-Sund.
Or, ce que nous avions reconnu déjà, c’est que cette terre n’était pas éloignée de cinquante milles d’Halbrane-Land. Oui! telle était la distance, relativement faible, qui nous séparait de ceux que nous avions cherchés si loin à travers les régions antarctiques, et que nous n’espérions plus revoir!
C’était beaucoup plus dans le sud-est, par rapport à nous, que l’embarcation de William Guy avait atterri. Mais, là, quelle différence avec l’île Tsalal, ou, plutôt, quelle ressemblance avec l’Halbrane-Land! Un sol impropre à la culture, rien que du sable et des roches, ni arbres, ni arbustes, ni plantes d’aucune sorte! Aussi, leurs provisions presque épuisées, William Guy et ses compagnons furent-ils bientôt réduits à l’extrême misère, et deux succombèrent, Forbes et Lexton…
Les quatre autres, William Guy, Roberts, Covin et Trinkle ne voulurent pas demeurer un jour de plus sur cette côte où ils étaient condamnés à mourir de faim. Avec le peu de vivres qui leur restait, ils s’embarquèrent dans le canot, et se livrèrent une seconde fois au courant, sans avoir été à même, faute d’instruments, de relever leur position.
Or, comme ils naviguèrent vingt-cinq jours dans ces conditions, leurs ressources s’épuisèrent, et ils étaient à la veille de succomber, n’ayant pas mangé depuis quarante-huit heures, lorsque l’embarcation, au fond de laquelle ils gisaient inanimés, parut en vue d’Halbrane-Land.
C’est à cet instant que le bosseman l’aperçut, et Dirk Peters s’était jeté à la mer, pour la rejoindre, et avait manœuvré de manière à la ramener vers le rivage. Au moment où il mettait le pied dans le canot, le métis avait reconnu le capitaine de la Jane et les matelots Roberts, Trinkle, Covin. Après s’être assuré qu’ils respiraient encore, il prit les pagaies, nagea vers la terre, et, lorsqu’il ne fut plus qu’à une encablure, soulevant la tête de William Guy:
«Vivant… vivant!» avait-il crié d’une voix si puissante qu’elle arriva jusqu’à nous.
Et, maintenant, les deux frères étaient enfin réunis sur ce coin perdu d’Halbrane-Land.
![]()
Le Sphinx des Glaces.
![]() deux jours de là, sur ce point du littoral antarctique, il ne restait plus un seul des survivants des deux goélettes.
deux jours de là, sur ce point du littoral antarctique, il ne restait plus un seul des survivants des deux goélettes.
Ce fut le 21 février, à six heures du matin, que l’embarcation, dans laquelle nous étions au nombre de treize, quitta la petite crique et doubla la pointe d’Halbrane-Land.
Dès l’avant-veille nous avions discuté la question du départ. Si elle devait être résolue affirmativement, il ne fallait pas différer d’un jour à prendre le large. Pendant un mois encore – un mois au plus –, la navigation serait possible sur cette portion de mer comprise entre les 86e et 70e parallèles, c’est-à-dire jusqu’aux latitudes ordinairement barrées par la banquise. Puis, au-delà, si nous parvenions à nous dégager, peut-être aurions-nous la chance de rencontrer quelque baleinier finissant la saison de pêche, ou, – qui sait? – un bâtiment anglais, français ou américain, achevant une campagne de découvertes sur les limites de l’océan austral?… Passé la mimars, ces parages seraient délaissés des navigateurs comme des pêcheurs, et tout espoir d’être recueilli devrait être abandonné.
On s’était d’abord demandé s’il n’y aurait pas avantage à hiverner là où nous eussions été contraints de le faire avant l’arrivée de William Guy, à s’installer pour les sept ou huit mois d’hiver de cette région que les longues ténèbres et les froids excessifs ne tarderaient pas d’envahir. Au commencement de l’été prochain, alors que la mer serait redevenue libre, l’embarcation aurait fait route vers l’océan Pacifique, et nous aurions eu plus de temps pour franchir le millier de milles qui nous en séparaient. N’eût-ce pas été acte de prudence et de sagesse ?…
Cependant, si résignés que nous fussions, comment ne pas s’effrayer à la pensée d’un hivernage sur cette côte, bien que la caverne nous offrît un suffisant abri, bien que les conditions de la vie y fussent assurées, du moins en ce qui concernait la nourriture?… Oui! résignés… on l’est tant que la résignation est commandée par les circonstances… Mais, à présent que l’occasion se présentait de partir, comment ne pas faire un dernier effort en vue d’un prochain rapatriement, comment ne pas tenter ce qu’avait tenté Hearne avec ses compagnons et dans des conditions infiniment plus favorables?…
Le pour et le contre de la question furent examinés de très près. Après avis demandé à chacun, on fit valoir que, à la rigueur, si quelque obstacle arrêtait la navigation, l’embarcation pourrait toujours regagner cette partie de la côte, dont nous connaissions l’exact gisement. Le capitaine de la Jane se montra très partisan d’un départ immédiat, dont Len Guy et Jem West ne redoutaient point les conséquences. Je me rangeai volontiers à leur avis que partagèrent nos compagnons.
Seul, Hurliguerly opposa quelque résistance. Il lui semblait imprudent de laisser le certain pour l’incertain… Trois ou quatre semaines seulement pour cette distance comprise entre Halbrane-Land et le cercle antarctique, serait-ce assez?… Et comment, s’il le fallait, revenir contre le courant qui portait au nord?… Enfin le bosseman fit valoir certains arguments qui méritaient d’être pesés. Toutefois, je dois le dire, il n’y eut qu’Endicott à se ranger de son bord, par l’habitude qu’il avait d’envisager les choses sous le même angle que lui. D’ailleurs, tout cela discuté et bien discuté, Hurliguerly se déclara prêt à partir, puisque nous étions tous de cet avis.
Les préparatifs furent achevés à bref délai, et c’est pourquoi, le 21, dès sept heures du matin, grâce à la double action du courant et du vent, la pointe d’Halbrane-Land nous restait à cinq milles en arrière. Dans l’après-midi s’effacèrent graduellement les hauteurs qui dominaient cette partie du littoral, dont la plus élevée nous avait permis d’apercevoir la terre sur la rive ouest du Jane-Sund.
Notre canot était une de ces embarcations qui sont en usage dans l’archipel de Tsalal pour la communication entre les îles. Nous savions, d’après le récit d’Arthur Pym, que ces canots ressemblaient les uns à des radeaux ou à des bateaux plats, les autres à des pirogues à balancier, – la plupart très solides. A la dernière catégorie appartenait celui que nous montions, long d’une quarantaine de pieds, large de six, l’arrière et l’avant de même forme relevée – ce qui permettait d’éviter les virages –, et il se manœuvrait avec plusieurs paires de pagaies.
Ce que je dois faire particulièrement observer, c’est que dans la construction de ce canot, il n’entrait pas un seul morceau de fer, – ni clous, ni chevilles, ni semelles, pas plus à l’étrave qu’à l’étambot, ce métal étant absolument inconnu des Tsalalais. Des ligatures faites d’une sorte de liane, ayant la résistance d’un fil de cuivre, assuraient l’adhérence du bordé avec autant de solidité que le plus serré des rivetages. L’étoupe était remplacée par une mousse sur laquelle s’appliquait un brai de gomme, qui prenait une dureté métallique au contact de l’eau.
Telle était cette embarcation, à laquelle nous donnâmes le nom de Paracuta, – celui d’un poisson de ces parages, qui était assez grossièrement sculpté sur le plat-bord.
Le Paracuta avait été chargé d’autant d’objets qu’il en pouvait contenir, sans trop gêner les passagers destinés à y prendre place, – vêtements, couvertures, chemises, vareuses, caleçons, pantalons de grosse laine et capotes cirées, quelques voiles, quelques espars, grappin, avirons, gaffes, puis des instruments pour faire le point, des armes et des munitions dont nous aurions peut-être l’occasion de nous servir, fusils, pistolets, carabines, poudre, plomb et balles. La cargaison se composait de plusieurs barils d’eau douce, de whisky et de gin, de caisses de farine, de viande au demi-sel, de légumes secs, d’une bonne réserve de café et de thé. On y avait joint un petit fourneau et plusieurs sacs de charbon pour alimenter ce fourneau pendant quelques semaines. Il est vrai, si nous ne parvenions pas à dépasser la banquise, s’il fallait hiverner au milieu des icefields, comme ces ressources ne tarderaient pas à s’épuiser, tous nos efforts devraient alors tendre à revenir vers Halbrane-Land, où la cargaison de la goélette devait assurer notre existence pendant de longs mois encore.
Eh bien – même si nous n’y réussissions pas –, y aurait-il lieu de perdre tout espoir?… Non, et il est dans la nature humaine de se rattacher à la moindre de ses lueurs. Je me souvenais de ce qu’Edgar Poe dit de l’Ange du bizarre, «ce génie qui préside aux contretemps dans la vie, et dont la fonction est d’amener ces accidents qui peuvent étonner, mais qui sont engendrés par la logique des faits…» Pourquoi ne verrions-nous pas apparaître cet ange à l’heure suprême?…
Il va de soi que la plus grande part de la cargaison de l’Halbrane avait été laissée dans la caverne, à l’abri des intempéries de l’hiver, à la disposition de naufragés, si jamais il en venait sur cette côte. Un espar, que le bosseman avait dressé sur le morne, ne manquerait pas d’attirer leur attention. D’ailleurs, après nos deux goélettes, quel navire oserait s’élever à de telles latitudes?
Voici quelles étaient les personnes embarquées sur le Paracuta: le capitaine Len Guy, le lieutenant Jem West, le bosseman Hurliguerly, le maître-calfat Hardie, les matelots Francis et Stern, le cuisinier Endicott, le métis Dirk Peters et moi, tous de l’Halbrane, – puis, le capitaine William Guy et les matelots Roberts, Covin, Trinkle de la Jane. Au total, treize, le chiffre fatidique.
Avant de partir, Jem West et le bosseman avaient eu soin d’implanter un mât à peu près au tiers de notre embarcation. Ce mât, maintenu par un étai et des haubans, pouvait porter une large misaine qui fut découpée dans le hunier de la goélette. Le Paracuta mesurant six pieds de largeur au maître-bau, on avait pu donner un peu de croisure à cette voile de fortune.
Sans doute, ce gréement ne permettrait pas de naviguer au plus près. Mais, depuis le vent arrière jusqu’au grand largue, cette voile nous imprimerait une vitesse suffisante pour enlever en cinq semaines, avec une moyenne de trente milles par vingt-quatre heures, le millier de milles qui nous séparaient de la banquise. Compter sur cette vitesse n’avait rien d’excessif, si le courant et la brise continuaient à pousser le Paracuta vers le nord-est. En outre, les pagaies nous serviraient, lorsque le vent viendrait à refuser, et quatre paires, maniées par huit hommes, assureraient encore une certaine vitesse à l’embarcation.
Je n’ai rien de particulier à mentionner pendant la semaine qui suivit le départ. La brise ne cessa de souffler du sud. Aucun contre-courant défavorable ne se manifesta entre les rives du Jane-Sund.
Autant que possible et tant que la côte d’Halbrane-Land ne s’écarterait pas trop à l’ouest, les deux capitaines entendaient la longer à une ou deux encablures. Elle nous eût offert refuge en cas qu’un accident eût mis notre canot hors d’usage. Il est vrai, sur cette terre aride, au début de l’hiver, que serions-nous devenus?… Mieux valait, je pense, n’y point songer.
Durant ces premiers huit jours, en pagayant dès que la brise venait à mollir, le Paracuta n’avait rien perdu de la moyenne de vitesse indispensable pour atteindre l’océan Pacifique en ce court laps de temps.
L’aspect de la terre ne changeait pas, – toujours le même sol infertile, des blocs noirâtres, des grèves sablonneuses semées de rares raquettes, des hauteurs abruptes et dénudées en arrière-plan. Quant au détroit, il charriait déjà quelques glaces, des drifts flottants, des packs longs de cent cinquante à deux cents pieds, les uns de forme allongée, les autres circulaires, – et aussi des icebergs que notre embarcation dépassait sans peine. Ce qu’il y avait de peu rassurant, c’est que ces masses se dirigeaient vers la banquise, et n’en fermeraient-elles point les passes, qui devaient être encore libres à cette époque?…
Inutile de noter que l’entente était parfaite entre les treize passagers du Paracuta. Nous n’avions plus à craindre la rébellion d’un Hearne. Et, à ce propos, on se demandait si le sort avait favorisé ces malheureux entraînés par le sealing-master. A bord de leur canot surchargé, que le moindre coup de mer mettrait en péril, comment s’était accomplie cette navigation si dangereuse?… Et qui sait, cependant, si Hearne ne réussirait pas, alors que nous échouerions, pour être partis dix jours après lui?…
Je mentionnerai, en passant, que Dirk Peters, à mesure qu’il s’éloignait de ces lieux où il n’avait retrouvé aucune trace de son pauvre Pym, était plus taciturne que jamais – ce que je n’aurais pas cru possible –, et il ne me répondait plus, lorsque je lui adressais la parole.
Cette année 1840 étant bissextile, j’ai dû porter sur mes notes la date du 29 février. Or, ce jour étant précisément l’anniversaire de la naissance d’Hurliguerly, le bosseman demanda que cet anniversaire fût célébré avec quelque éclat à bord du canot.
«C’est bien le moins, dit-il en riant, puisqu’on ne peut me le fêter qu’une année sur quatre!»
Et l’on but à la santé de ce brave homme, un peu trop bavard, mais le plus confiant, le plus endurant de tous, et qui nous ragaillardissait par son inaltérable bonne humeur.
Ce jour-là, l’observation donna 79° 17’ pour la latitude et 118° 37’ pour la longitude.
On le voit, les deux rives du Jane-Sund couraient entre le 118e et le 119e méridien, et le Paracuta n’avait plus qu’une douzaine de degrés à franchir jusqu’au cercle polaire.
Après avoir fait ce relèvement, très difficile à obtenir à cause du peu d’élévation du soleil au-dessus de l’horizon, les deux frères avaient déployé sur un banc la carte si incomplète alors des régions antarctiques. Je l’étudiais avec eux, et nous cherchions à déterminer approximativement quelles terres déjà reconnues gisaient dans cette direction.
Depuis que notre iceberg avait dépassé le pôle sud, il ne faut pas oublier que nous étions entrés dans la zone des longitudes orientales, comptées du zéro de Greenwich au 190e degré. Donc, tout espoir devait être abandonné soit d’être rapatriés aux Falklands, soit de trouver des baleiniers sur les parages des Sandwich, des South-Orkneys ou de la Géorgie du Sud.
En somme, voici ce qu’il était permis de déduire, eu égard à notre position actuelle.
Il va de soi que le capitaine William Guy ne pouvait rien savoir des voyages antarctiques entrepris depuis le départ de la Jane. Il ne connaissait que ceux de Cook, de Krusenstern, de Weddell, de Bellingshausen, de Morrell, et ne pouvait être au courant des campagnes ultérieures, la deuxième de Morrell et celle de Kemp, qui avaient quelque peu étendu le domaine géographique en ces lointaines contrées. Par suite de ce que lui apprit son frère, il sut que, depuis nos propres découvertes, on devait tenir pour certain qu’un large bras de mer – le Jane-Sund – partageait en deux vastes continents la région australe.
Une remarque que fit, ce jour-là, le capitaine Len Guy, c’est que si le détroit se prolongeait entre les 118e et 119e méridiens, le Paracuta passerait près de la position attribuée au pôle magnétique. C’est à ce point – on ne l’ignore pas –, que se réunissent tous les méridiens magnétiques, point situé à peu près aux antipodes de celui des parages arctiques, et sur lequel l’aiguille de la boussole prend une direction verticale. Je dois dire qu’à cette époque, le relèvement de ce pôle n’avait pas été fait avec la précision qu’on y a apportée plus tard1.
Cela n’avait pas d’importance, d’ailleurs, et cette constatation géographique ne pouvait avoir aucun intérêt pour nous. Ce qui devait nous préoccuper davantage, c’est que le Jane-Sund se rétrécissait sensiblement, et se réduisait alors à dix ou douze milles de largeur. Grâce à cette configuration du détroit, on apercevait distinctement la terre des deux côtés.
«Eh! fit observer le bosseman, espérons qu’il y restera assez de large pour notre embarcation!… Si ce détroit-là allait finir en cul-de-sac…
– Ce n’est pas à craindre, répondit le capitaine Len Guy. Puisque le courant se propage dans cette direction, c’est qu’il trouve une issue vers le nord, et, à mon avis, nous n’avons rien autre chose à faire qu’à le suivre.»
C’était l’évidence même. Le Paracuta ne pouvait avoir un meilleur guide que ce courant. Si, par malheur, nous l’eussions eu contre nous, il aurait été impossible de le remonter, sans être servi par une très forte brise.
Peut-être, cependant, quelques degrés plus loin, ce courant s’infléchirait-il vers l’est ou vers l’ouest, étant donné la conformation des côtes? Néanmoins, au nord de la banquise, tout permettait d’affirmer que cette partie du Pacifique baignait les terres de l’Australie, de la Tasmanie ou de la Nouvelle-Zélande. Peu importait, on en conviendra, quand il s’agissait d’être rapatriés, que le rapatriement se fit ici ou là…
Notre navigation se prolongea dans ces conditions une dizaine de jours. L’embarcation tenait bien l’allure du grand largue. Les deux capitaines et Jem West n’en étaient plus à apprécier sa solidité, quoique, je le répète, aucun morceau de fer n’eût été employé à sa construction. Il n’avait pas été une seule fois nécessaire de reprendre ses coutures, d’une parfaite étanchéité. Il est vrai, nous avions la mer belle, à peine ridée d’un léger clapotis à la surface de ses longues houles.
Le 10 mars, avec même longitude, l’observation donna 76° 13’ pour latitude.
Puisque le Paracuta avait franchi environ six cents milles depuis son départ d’Halbrane-Land, et que ce parcours s’était opéré en vingt jours, il avait obtenu une vitesse de trente milles par vingt-quatre heures.
Que cette moyenne ne faiblît pas durant trois semaines, et toutes les chances seraient pour que les passes ne fussent point fermées ou que la banquise pût être contournée, – et aussi que les navires n’eussent pas abandonné les lieux de pêche.
Actuellement, le soleil se traînait presque au ras de l’horizon, et l’époque approchait où tout le domaine de l’Antarctide serait enveloppé des ténèbres de la nuit polaire. Fort heureusement, à s’élever vers le nord, nous gagnions des parages d’où la lumière n’était pas bannie encore.
Nous fûmes alors témoin d’un phénomène aussi extraordinaire que ceux dont est rempli le récit d’Arthur Pym. Pendant trois à quatre heures, de nos doigts, de nos cheveux, de nos poils de barbe, s’échappèrent de courtes étincelles, accompagnées d’un bruit strident. C’était une tempête de neige électrique, aux gros flocons peu serrés, dont le contact produisait des aigrettes lumineuses. Le Paracuta fut plusieurs fois à l’instant d’être englouti, tant la mer déferlait avec fureur, mais on s’en tira sains et saufs.
Cependant, l’espace ne s’éclairait déjà plus que d’une manière imparfaite. De fréquentes brumes réduisaient à quelques encablures seulement l’extrême portée de la vue. Aussi la surveillance dut-elle être établie de manière à éviter toute collision avec les glaces flottantes, dont la vitesse de déplacement était inférieure à celle du Paracuta. Il y a également lieu de noter que, du côté du sud, le ciel s’illuminait souvent de larges lueurs, dues à l’irradiation des aurores polaires.
La température s’abaissait d’une manière assez sensible, et n’était plus que de 23° (5° C. sous zéro).
Cet abaissement ne laissait pas de causer de vives inquiétudes. S’il ne pouvait influencer les courants dont la direction restait favorable, il tendait à modifier l’état atmosphérique. Par malheur, pour peu que le vent mollît avec l’accentuation du froid, la marche du canot serait diminuée de moitié. Or, un retard de deux semaines suffirait à compromettre notre salut en nous obligeant à hiverner au pied de la banquise. Dans ce cas, ainsi que je rai dit, mieux vaudrait essayer de revenir au campement d’Halbrane-Land. Serait-il libre alors, ce Jane-Sund, que le Paracuta venait de remonter si heureusement?… Plus favorisés que nous, Hearne et ses compagnons, qui nous devançaient d’une dizaine de jours, n’avaient-ils pas déjà franchi la barrière de glaces?
Quarante-huit heures après, le capitaine Len Guy et son frère voulurent fixer notre position par une observation que le ciel, dégagé de brumes, allait rendre possible. Il est vrai, c’est à peine si le soleil débordait l’horizon méridional, et l’opération présenterait de réelles difficultés. Cependant on parvint à prendre hauteur avec une certaine approximation, et les calculs donnèrent les résultats suivants:
Latitude: 75° 17’ sud.
Longitude: 118° 3’ est.
Donc, à cette date du 12 mars, le Paracuta n’était plus séparé que par la distance de quatre cents milles des parages du cercle antarctique.
Une remarque qui fut faite alors, c’est que le détroit, très restreint à la hauteur du 77° parallèle, s’élargissait à mesure qu’il se développait vers le nord. Même avec les longues-vues, on n’apercevait plus rien des terres de l’est. C’était là une circonstance fâcheuse, car le courant, moins resserré entre deux côtes, ne tarderait pas à diminuer de vitesse, et finirait par ne plus se faire sentir.
Durant la nuit du 12 au 13 mars, une brume assez épaisse se leva après une accalmie de la brise. Il y avait lieu de le regretter, car cela accroissait les dangers de collision avec les glaces flottantes. Il est vrai, l’apparition des brouillards ne pouvait nous étonner en de tels parages. Toutefois, ce qui eut lieu de surprendre, c’est que, loin de décroître, la vitesse de notre canot s’augmenta graduellement, bien que la brise eût calmi. A coup sûr, cette accélération n’était pas due au courant, puisque le clapotis des eaux à l’étrave prouvait que nous marchions plus vite que lui.
Cet état de choses dura jusqu’au matin, sans que nous pussions nous rendre compte de ce qui se passait, lorsque, vers dix heures, la brume commença à se dissoudre dans les basses zones. Le littoral de l’ouest reparut – un littoral de roches, sans arrière-plan de montagnes, que longeait le Paracuta.
Et alors se dessina, à un quart de mille, une masse qui dominait la plaine d’une cinquantaine de toises sur une circonférence de deux à trois cents. Dans sa forme étrange, ce massif ressemblait volontiers à un énorme sphinx, le torse redressé, les pattes étendues, accroupi dans l’attitude du monstre ailé que la mythologie grecque a placé sur la route de Thèbes.
Était-ce un animal vivant, un monstre gigantesque, un mastodonte de dimension mille fois supérieure à ces énormes éléphants des régions polaires dont les débris se retrouvent encore?… Dans la disposition d’esprit où nous étions, on l’aurait pu croire, – croire aussi que le mastodonte allait se précipiter sur notre embarcation et la broyer sous ses griffes…
Après un premier moment d’inquiétude peu raisonnée et peu raisonnable, nous reconnûmes qu’il n’y avait là qu’un massif de conformation singulière, dont la tête venait de se dégager des brumes.
Ah! ce sphinx!… Un souvenir me revint, c’est que, la nuit pendant laquelle s’effectua la culbute de l’iceberg et l’enlèvement de l’Halbrane, j’avais rêvé d’un animal fabuleux de cette espèce, assis au pôle du monde, et dont seul un Edgar Poe, avec sa génialité intuitive, eût pu arracher les secrets!…
Mais de plus étranges phénomènes allaient attirer notre attention, provoquer notre surprise, notre épouvante même !…
J’ai dit que, depuis quelques heures, la vitesse du Paracuta s’accroissait graduellement. Maintenant elle était excessive, celle du courant lui restant inférieure. Or, voici que, tout à coup, le grappin de fer, qui provenait de l’Halbrane et placé à l’avant de notre canot, s’échappe hors de l’étrave, comme s’il eût été attiré par une puissance irrésistible, et la corde qui le retient est tendue à se rompre… Il semble que ce soit ce grappin qui nous remorque, en rasant la surface des eaux, vers le rivage…
«Qu’y a-t-il donc?… s’écria William Guy.
– Coupe, bosseman, coupe, ordonna Jem West, ou nous allons nous briser contre les roches!»
Hurliguerly s’élance vers l’avant du Paracuta pour couper la corde. Soudain le couteau qu’il tenait à la main lui est arraché, la corde casse, et le grappin, comme un projectile, file dans la direction du massif.
Et, en même temps, ne voilà-t-il pas que tous les objets de fer déposés dans l’embarcation, les ustensiles de cuisine, les armes, le fourneau d’Endicott, nos couteaux arrachés de nos poches, prennent le même chemin, pendant que le canot, courant sur son erre, va buter contre la grève !…
Qu’y avait-il donc, et, pour expliquer ces inexplicables choses, fallait-il admettre que nous étions dans la région des étrangetés que j’attribuais aux hallucinations d’Arthur Pym?…
Non! c’étaient des faits physiques dont nous venions d’être témoins, non des phénomènes imaginaires!…
D’ailleurs, le temps de la réflexion nous manqua, et, dès que nous eûmes pris terre, notre attention fut détournée par la vue d’une embarcation échouée sur le sable.
«Le canot de l’Halbrane!» s’écria Hurliguerly.
C’était bien le canot volé par Hearne. Il gisait à cette place, les bordages disjoints, la membrure larguée de la quille, en complète dislocation… Plus rien que des débris informes – en un mot, ce qui reste d’une embarcation, à la suite d’un coup de mer qui l’a écrasée contre les roches!…
Ce qui fut aussitôt remarqué, c’est que les ferrures de ce canot avaient disparu… oui! toutes… les clous du bordé, la semelle de la quille, les garnitures de l’étrave et de l’étambot, les gonds du gouvernail…
Que signifiait tout cela?…
Un appel de Jem West nous ramena vers une petite grève, à droite de l’embarcation.
Trois cadavres étaient couchés sur le sol, – celui de Hearne, celui du maître-voilier Martin Holt, celui de l’un des Falklandais… Des treize qui accompagnaient le sealing-master, il ne restait que ces trois-là, dont la mort devait remonter à quelques jours…
Qu’étaient devenus les dix manquants?… Avaient-ils été entraînés au large?…
Des perquisitions furent faites le long du littoral, au fond des criques, entre les écueils… On ne trouva rien, – ni les traces d’un campement, ni même les vestiges d’un débarquement.
«Il faut, dit William Guy, que leur canot ait été abordé en mer par un iceberg en dérive… La plupart des compagnons de Hearne se seront noyés, et, ces trois corps sont venus à la côte, déjà privés de vie…
– Mais, demanda le bosseman, comment expliquer que l’embarcation soit dans un tel état…
– Et, surtout, ajouta Jem West, que toutes ses ferrures lui manquent?…
– En effet, repris-je, il semble qu’elles ont été violemment arrachées…»
Laissant le Paracuta à la garde de deux hommes, nous remontâmes vers l’intérieur, afin d’étendre nos recherches sur un plus large rayon.
Nous approchions du massif, maintenant sorti des brumes et dont la forme s’accusait avec plus de netteté. C’était, je l’ai dit, à peu près celle d’un sphinx, – un sphinx de couleur fuligineuse, comme si la matière qui le composait eût été oxydée par les longues intempéries du climat polaire.
Et alors, une hypothèse surgit dans mon esprit, – une hypothèse, qui expliquait ces étonnants phénomènes.
«Ah ! m’écriai-je, un aimant… Il y a là… là… un aimant… doué d’une force d’attraction prodigieuse!…»
Je fus compris, et, en un instant, la dernière catastrophe dont Hearne et ses complices avaient dû être victimes, s’illumina d’une terrible clarté.
Ce massif n’était qu’un aimant colossal. C’est sous son influence que les ligatures de fer du canot de l’Halbrane avaient été arrachées et projetées, comme si elles eussent été lancées par le ressort d’une catapulte!… C’est lui qui venait d’attirer avec une force irrésistible tous les objets de fer du Paracuta!… Et notre embarcation aurait eu le sort de l’autre, si sa construction eût employé un seul morceau de ce métal!…
Était-ce donc la proximité du pôle magnétique qui produisait de tels effets?…
L’idée nous en vint tout d’abord. Puis, réflexion faite, cette explication dut être rejetée…
Du reste, à l’endroit où se croisent les méridiens magnétiques, il n’en résulte d’autre phénomène que la position verticale prise par l’aiguille aimantée en deux points similaires du globe terrestre. Ce phénomène, déjà expérimenté aux régions arctiques par des observations faites sur place, devait être identique dans les régions de l’Antarctide.
Ainsi donc, il existait un aimant d’une intensité prodigieuse dans la zone d’attraction duquel nous étions entrés. Sous nos yeux s’était produit un de ces surprenants effets, qui avaient été jusqu’alors relégués au rang des fables. Qui donc a jamais voulu admettre que des navires pussent être irrésistiblement attirés par une force magnétique, leurs ligatures de fer larguant de toutes parts, leurs coques s’entrouvrant, la mer les engloutissant dans ses profondeurs?… Et cela était pourtant!…
En somme, voici quelle explication de ce phénomène me paraît pouvoir être donnée:
Les vents alizés amènent d’une façon constante, vers les extrémités de l’axe terrestre, des nuages ou des brumes dans lesquels sont emmagasinées d’immenses quantités d’électricité, que les orages n’ont pas complètement épuisées. De là une formidable accumulation de ce fluide aux pôles, et qui s’écoule vers la terre d’une manière permanente.
Telle est la cause des aurores boréales et australes, dont les lumineuses magnificences s’irradient au-dessus de l’horizon, surtout pendant la longue nuit polaire, et qui sont visibles jusqu’aux zones tempérées, lorsqu’elles atteignent leur maximum de culmination. Il est même admis – fait non constaté, je le sais – qu’au moment où une violente décharge d’électricité positive s’opère dans les régions arctiques, les régions antarctiques sont soumises aux décharges d’électricité de nom contraire.
Eh bien, ces courants continus aux pôles, qui affolent les boussoles, doivent posséder une extraordinaire influence, et il suffirait qu’une masse de fer fût soumise à leur action pour qu’elle se changeât en un aimant d’une puissance proportionnelle à l’intensité du courant, au nombre de tours de l’hélice électrique, et à la racine carrée du diamètre du massif de fer aimanté.
Précisément, on pouvait chiffrer par des milliers de mètres cubes, le volume de ce sphinx, qui se dressait sur ce point des terres australes.
Or, pour que le courant circulât autour de lui et en fit un aimant par induction, que fallait-il?… Rien qu’un filon métallique, dont les innombrables spires, sinuant à travers les entrailles de ce sol, fussent souterrainement reliées à la base dudit massif.
Je pense aussi que ce massif devait être placé dans l’axe magnétique, comme une sorte de calamite gigantesque, d’où se dégageait le fluide impondérable et dont les courants faisaient un inépuisable accumulateur dressé aux confins du monde. Quant à déterminer s’il se trouvait précisément au pôle magnétique des régions australes, notre boussole ne l’aurait pu, car elle n’était pas construite à cet effet. Tout ce que j’ai à dire, c’est que son aiguille, affolée et instable, ne marquait plus aucune orientation. Peu importait, d’ailleurs, pour ce qui concernait la constitution de cet aimant artificiel et la manière dont les nuages et le filon entretenaient sa force attractive.
C’est de cette façon très plausible que je fus conduit à expliquer ce phénomène, – par instinct. Il n’était pas douteux que nous fussions à proximité d’un aimant, dont la puissance produisait ces effets aussi terribles que naturels…
Je communiquai mon idée à mes compagnons, et il leur parut que cette explication s’imposait en présence des faits physiques dont nous venions d’être témoins.
«Il n’y a aucun danger pour nous à gagner le pied du massif, je pense? demanda le capitaine Len Guy.
– Aucun, répliquai-je.
– Là… oui… là !»
Je ne saurais peindre l’impression que nous causèrent ces trois mots, qui furent jetés comme trois cris venus des profondeurs de l’ultra-monde, eût dit Edgar Poe.
C’était Dirk Peters qui avait parlé, et le corps du métis était tendu dans la direction du sphinx, comme si, devenu de fer, il eût été lui aussi attiré par l’aimant…
Puis, le voilà qui court dans cette direction, et ses compagnons le suivirent à la surface d’un sol où s’entassaient des pierres noirâtres, des éboulis de moraines, des débris volcaniques de toutes sortes.
Le monstre grandissait à mesure que nous en approchions, sans rien perdre de ses formes mythologiques. Je ne saurais peindre l’effet qu’il produisait, isolé à la surface de cette immense plaine. Il y a de ces impressions que ni la plume ni la parole ne peuvent rendre… Et – ce ne devait être qu’une illusion de nos sens –, il semblait que nous fussions attirés vers lui par la force de son attraction magnétique…
Lorsque nous eûmes atteint sa base, nous retrouvâmes les divers objets de fer sur lesquels s’était exercée sa puissance. Armes, ustensiles, grappin du Paracuta, adhéraient à ses flancs. Là, également, se voyaient ceux qui provenaient du canot de l’Halbrane, et aussi les clous, les chevilles, les tolets, les semelles de la quille, les ferrures du gouvernail.
Il n’y avait donc plus de doute possible sur la cause de destruction du canot qui portait Hearne et ses compagnons. Brutalement déclinqué, il était venu se briser contre les roches, et tel eût été le sort du Paracuta, si, par sa construction même, il n’eût échappé à cette irrésistible attraction magnétique…
Quant à rentrer en possession des objets qui adhéraient au flanc du massif, fusils, pistolets, ustensiles, telle était leur adhérence qu’il fallut y renoncer. Et Hurliguerly furieux de ne pouvoir rattraper son couteau, collé à la hauteur d’une cinquantaine de pieds, de s’écrier en montrant le poing à l’impassible monstre:
«Voleur de sphinx!»
On ne sera point étonné qu’il n’y eût pas à cette place d’autres objets que ceux qui provenaient soit du Paracuta, soit du canot de l’Halbrane. Assurément, jamais navire ne s’était élevé à cette latitude de la mer antarctique. Hearne et ses complices, d’abord, le capitaine Len Guy et ses compagnons ensuite, nous étions les premiers qui eussions foulé ce point du continent austral. Pour conclure, tout bâtiment qui se fût approché de ce colossal aimant, eût couru à sa complète destruction, et notre goélette aurait eu le même sort que son canot, dont il ne restait plus que d’informes débris.
Cependant Jem West nous rappela qu’il était imprudent de prolonger notre relâche sur cette Terre du Sphinx – nom qu’elle devait conserver. Le temps pressait, et un retard de quelques jours nous eût imposé d’hiverner au pied de la banquise.
L’ordre de regagner le rivage venait donc d’être donné, lorsque la voix du métis retentit encore, et ces trois mots ou plutôt ces trois cris furent de nouveau jetés par Dirk Peters:
«Là!… là!… là!…»
Après avoir contourné le revers de la patte droite du monstre, nous aperçûmes Dirk Peters agenouillé, les mains tendues devant un corps ou plutôt un squelette revêtu de peau, que le froid de ces régions avait conservé intact, et qui gardait une rigidité cadavérique. Il avait la tête inclinée, une barbe blanche qui lui tombait jusqu’à la ceinture, des mains et des pieds armés d’ongles longs comme des griffes…
Comment ce corps était-il appliqué contre le flanc du massif à deux toises au-dessus du sol?
En travers du torse, maintenu par sa bretelle de cuir, nous vîmes le canon d’un fusil tordu, à demi rongé par la rouille…
«Pym… mon pauvre Pym!» répétait Dirk Peters d’une voix déchirante.
Alors il essaya de se relever pour s’approcher… pour baiser les restes ossifiés de son pauvre Pym…
Ses genoux fléchirent… un sanglot lui serra la gorge… un spasme lui fit éclater le cœur… et il tomba à la renverse… mort…
Ainsi donc, depuis leur séparation, le canot avait entraîné Arthur Pym à travers ces régions de l’Antarctide!… Comme nous, après avoir dépassé le pôle austral, il était tombé dans la zone d’attraction du monstre!… Et là, tandis que son embarcation s’en allait avec le courant du nord, saisi par le fluide magnétique avant d’avoir pu se débarrasser de l’arme qu’il portait en bandoulière, il avait été projeté contre le massif…
A présent, le fidèle métis repose sur la Terre du Sphinx, à côté d’Arthur Gordon Pym, ce héros dont les étranges aventures avaient trouvé dans le grand poète américain un non moins étrange narrateur!
![]()
Douze sur soixante-dix!
![]() e jour même, dans l’après-midi, le Paracuta abandonnait le littoral de la Terre du Sphinx que nous avions toujours eue à l’ouest depuis le 21 février.
e jour même, dans l’après-midi, le Paracuta abandonnait le littoral de la Terre du Sphinx que nous avions toujours eue à l’ouest depuis le 21 février.
Il y avait quatre cents milles environ à parcourir jusqu’à la limite du cercle antarctique. Arrivés sur ces parages de l’océan Pacifique, aurions-nous, je le répète, l’heureuse chance d’être recueillis par un baleinier attardé aux derniers jours de sa saison de pêche, ou même par quelque navire d’une expédition polaire?…
Cette seconde hypothèse avait sa raison d’être. En effet, lorsque la goélette se trouvait en relâche aux Falklands, n’était-il pas question de l’expédition du lieutenant Wilkes de la marine américaine? Sa division, composée de quatre bâtiments, le Vincennes, le Peacock, le Porpoise, le Flying-Fish, n’avait-elle pas quitté la Terre-de-Feu en février 1839, avec plusieurs conserves, en vue d’une campagne à travers les mers australes?
Ce qui s’était passé depuis lors, nous l’ignorions. Mais, après avoir essayé de remonter les longitudes occidentales, pourquoi Wilkes n’aurait-il pas eu la pensée de chercher le passage en remontant les longitudes orientales?2. Dans ce cas, il eût été possible que le Paracuta fit la rencontre de l’un de ses bâtiments.
En somme, ce qui devait être le plus difficile, c’était de devancer l’hiver de ces régions, de profiter de la mer libre, où toute navigation ne tarderait pas à devenir impraticable.
La mort de Dirk Peters avait réduit à douze le chiffre des passagers du Paracuta. Voilà ce qui restait du double équipage des deux goélettes, la première comprenant trente-huit hommes, la seconde en comprenant trente-deux, – en tout soixante-dix! Mais, qu’on ne l’oublie pas, l’expédition de l’Halbrane avait été entreprise pour remplir un devoir d’humanité, et quatre des survivants de la Jane lui devaient leur salut.
Et maintenant, allons au plus vite. Sur le voyage de retour, qui fut favorisé par la constance des courants et de la brise, il n’y a pas lieu de s’étendre. D’ailleurs, les notes qui servirent à rédiger mon récit ne furent point renfermées dans une bouteille jetée à la mer, recueillie par hasard sur les mers de l’Antarctide. Je les ai rapportées moi-même, et, bien que la dernière partie du voyage ne se soit pas accomplie sans grandes fatigues, grandes misères, grands dangers, terribles inquiétudes surtout, cette campagne a eu notre sauvetage pour dénouement.
Et d’abord, quelques jours après le départ de la Terre du Sphinx, le soleil s’était enfin couché derrière l’horizon de l’ouest, et ne devait plus reparaître de tout l’hiver.
C’est donc au milieu de la demi-obscurité de la nuit australe que le Paracuta poursuivit sa monotone navigation. Il est vrai, les aurores polaires apparaissaient fréquemment, – ces admirables météores que Cook et Forster aperçurent pour la première fois en 1773. Quelle magnificence dans le développement de leur arc lumineux, leurs rayons qui s’allongent ou se raccourcissent capricieusement, l’éclat de ces opulentes draperies qui augmente ou diminue avec une soudaineté merveilleuse en convergeant vers le point du ciel indiqué par la verticalité de l’aiguille des boussoles! Et quelle prestigieuse variété de formes dans les plis et replis de leurs faisceaux, qui se colorent depuis le rouge clair jusqu’au vert émeraude!
Oui!… mais ce n’était plus le soleil, ce n’était pas cet astre irremplaçable qui, durant les mois de l’été antarctique, avait sans cesse illuminé nos horizons. De cette longue nuit des pôles se dégage une influence morale et physique dont personne ne peut s’abstraire, une impression funeste et accablante à laquelle il est bien difficile d’échapper.
Des passagers du Paracuta, il n’y avait guère que le bosseman et Endicott à conserver leur habituelle bonne humeur, insensibles aux ennuis comme aux périls de cette navigation. J’excepte aussi l’impassible Jem West, prêt à faire face à n’importe quelles éventualités, en homme qui est toujours sur la défensive. Quant aux deux frères Guy, le bonheur de s’être retrouvés leur faisait le plus souvent oublier les préoccupations de l’avenir.
En vérité, je ne saurais trop faire l’éloge de ce brave homme d’Hurliguerly, et l’on se réconfortait rien qu’à l’entendre répéter de sa voix rassurante:
«Nous arriverons à bon port, mes amis, nous arriverons!… Et, si vous comptez bien, vous verrez que pendant notre voyage, le chiffre des bonnes chances l’a emporté sur celui des mauvaises!… Oui!…je le sais… Il y a la perte de notre goélette!… PauvreHalbrane, enlevée dans les airs comme un ballon, puis précipitée dans l’abîme comme une avalanche!… Mais, par compensation, il y a l’iceberg qui nous a conduits à la côte, et le canot tsalalais qui nous a rejoints avec le capitaine William Guy et ses trois compagnons!… Et soyez sûrs que ce courant et cette brise, qui nous ont poussés jusqu’ici, nous pousseront plus loin encore!… Il me semble bien que la balance est en notre faveur!… Avec tant d’atouts dans son jeu, il n’est pas possible de perdre la partie!… Un seul regret, c’est que nous allons être rapatriés en Australie ou à la Nouvelle-Zélande, au lieu d’aller jeter l’ancre aux Kerguelen, près du quai de Christmas-Harbour, devant le Cormorant-Vert!…»
Gros désappointement, en effet, pour l’ami de maître Atkins, bien fâcheuse éventualité, dont nous prendrions aisément notre parti, cependant!
Durant huit jours, cette route a été maintenue sans aucun écart, ni à l’ouest ni à l’est, et ce fut seulement à la date du 21 mars, que le Paracuta perdit sur bâbord la vue d’Halbrane-Land.
Je donne toujours ce nom à cette terre, puisque son littoral se prolongeait sans discontinuité jusqu’à cette latitude, et il n’était pas douteux pour nous qu’elle constituait un des vastes continents de l’Antarctide.
Il va sans dire que si le Paracuta cessa de la suivre, c’est que le courant portait au nord, alors qu’elle s’écartait, en s’arrondissant vers le nord-est.
Bien que les eaux de cette portion de mer fussent libres encore, elles charriaient néanmoins une véritable flottille d’icebergs ou d’icefields, – ceux-ci semblables aux morceaux d’une immense vitre rompue, ceux-là d’une étendue superficielle ou d’une altitude déjà considérables. De là sérieuses difficultés et aussi dangers incessants de navigation au milieu des sombres brumes, lorsqu’il s’agissait de manœuvrer à temps entre ces masses mouvantes, ou pour trouver des passes ou pour éviter que notre canot fût écrasé comme le grain sous la meule.
Actuellement, d’ailleurs, le capitaine Len Guy ne pouvait plus relever sa position ni en latitude ni en longitude.
Le soleil absent, les calculs par la position des étoiles étant trop compliqués, il était impossible de prendre hauteur. Aussi le Paracuta s’abandonnait-il à l’action de ce courant qui portait invariablement au nord, d’après les indications de la boussole. Toutefois, en tenant compte de sa moyenne vitesse, il y avait lieu d’estimer que, à la date du 27 mars, notre canot se trouvait entre le 68° et le 69° parallèles, c’est-à-dire, sauf erreur, à quelque soixante-dix milles seulement du cercle antarctique.
Ah! si au cours de cette périlleuse navigation il n’eût existé aucun obstacle, si le passage eût été assuré entre cette mer intérieure de la zone australe et les parages de l’océan Pacifique, le Paracuta aurait pu atteindre en peu de jours l’extrême limite des mers australes. Mais encore quelque centaine de milles, et la banquise déroulerait son immobile rempart de glaces, et, à moins qu’une passe fût libre, il faudrait la contourner par l’est ou par l’ouest. Une fois franchie, il est vrai…
Eh bien, une fois franchie, nous serions, à bord d’une frêle embarcation, sur ce terrible océan Pacifique, à l’époque de l’année où redoublent ses tempêtes, où les bâtiments ne supportent pas impunément ses coups de mer…
Nous n’y voulions pas songer… Le Ciel nous viendrait en aide… Nous serions recueillis… Oui!… nous serions recueillis par quelque navire… Le bosseman l’affirmait, et il n’y avait qu’à écouter le bosseman!…
Cependant la surface de la mer commençait à se prendre, et, il fallut plusieurs fois rompre des icefields afin de se frayer un passage. Le thermomètre n’indiquait plus que 4° (15° 56 C. sous zéro). Nous souffrions beaucoup du froid et des rafales à bord de cette embarcation non pontée, quoique nous fussions pourvus d’épaisses couvertures.
Par bonheur, il y avait en quantité suffisante, et pour quelques semaines, des conserves de viande, trois sacs de biscuit et deux fûts de gin intacts. Quant à l’eau douce, on s’en procurait avec de la glace fondue.
Bref, pendant six jours, jusqu’au 2 avril, le Paracuta dut s’engager entre les hauteurs de la banquise, dont la crête se profilait à une altitude comprise entre sept et huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer. On n’en pouvait voir les extrémités ni au couchant ni au levant, et si notre canot ne rencontrait pas une passe libre, nous ne parviendrions pas à la franchir.
Grâce à la plus heureuse des chances, il la trouva à cette date, il la suivit, au milieu de mille dangers. Oui! on eut besoin de tout le zèle, de tout le courage, de toute l’habileté de nos hommes et de leurs chefs pour se tirer d’affaire. Aux deux capitaines Len et William Guy, au lieutenant Jem West, au bosseman, nous devons une éternelle reconnaissance.
Nous étions enfin sur les eaux du Sud-Pacifique. Mais, pendant cette longue et pénible traversée, notre embarcation avait gravement souffert. Son calfatage usé, ses bordages menaçant de se disjoindre, elle faisait eau par plus d’une couture. On s’occupait sans cesse à la vider, et c’était assez, c’était déjà trop de la houle qui embarquait par-dessus le plat-bord.
Il est vrai, la brise était molle, la mer plus calme qu’on eût pu l’espérer, et le véritable danger ne tenait pas aux risques de la navigation.
Non! il venait de ce qu’il n’y avait aucun navire en vue sur ces parages, aucun baleinier parcourant les lieux de pêche. Aux premiers jours d’avril, ces lieux sont déjà abandonnés, et nous arrivions trop tard de quelques semaines…
Or, ainsi que nous devions l’apprendre, il aurait suffi d’être là deux mois plus tôt pour rencontrer les bâtiments de l’expédition américaine.
En effet, le 21 février, par 95° 50’ de longitude et 64° 17’ de latitude, le lieutenant Wilkes explorait ces mers avec l’un de ses navires, le Vincennes, après avoir reconnu une étendue de côtes, qui se développait sur 66° de l’est à l’ouest. Puis, comme la mauvaise saison s’approchait, il avait viré de bord et regagné Hobart-Town en Tasmanie.
La même année, l’expédition du capitaine français Dumont d’Urville, partie en 1838, dans une seconde tentative pour s’élever vers le pôle, avait, le 21 janvier, reconnu la terre Adélie par 66° 30’ de latitude et 38° 21’ de longitude orientale, puis, le 29 janvier, la côte Clarie par 64° 30’ et 129° 54’. Leur campagne terminée après ces importantes découvertes, l’Astrolabe et la Zélée avaient quitté l’océan Antarctique et mis le cap sur Hobart-Town.
Aucun de ces bâtiments ne se trouvait donc dans ces parages. Aussi, lorsque le Paracuta, cette coquille de noix, fut seul au-delà de la banquise, sur une mer déserte, nous dûmes croire que le salut n’était plus possible.
Quinze cents milles nous séparaient alors des terres les plus voisines, et l’hiver datait d’un mois déjà…
Hurliguerly lui-même voulut bien reconnaître que la dernière heureuse chance, sur laquelle il comptait, venait de nous manquer…
Le 6 avril, nous étions à bout de ressources, le vent commençait à fraîchir, et le canot, violemment secoué, risquait d’être englouti à chaque lame.
«Navire!»
Ce mot fut jeté par le bosseman, et, à l’instant, nous distinguâmes un bâtiment, à quatre milles dans le nord-est, au-dessous des brumes qui venaient de se lever.
Immédiatement, signaux faits, signaux aperçus. Après s’être tenu en panne, le navire mit son grand canot à la mer pour nous recueillir.
C’était le Tasman, un trois-mâts américain de Charleston, où nous fûmes reçus avec empressement et cordialité. Le capitaine traita mes compagnons comme s’ils eussent été ses propres compatriotes…
Le Tasman venait des îles Falklands, où il avait appris que, sept mois auparavant, la goélette anglaise Halbrane avait fait route pour les mers australes à la recherche des naufragés de la Jane. Mais la saison s’avançant, la goélette n’ayant pas reparu, on avait dû penser qu’elle s’était perdue corps et biens dans les régions antarctiques.
Cette dernière traversée fut heureuse et rapide. Quinze jours après, le Tasman débarquait à Melbourne, province de Victoria de la Nouvelle-Hollande, ce qui avait survécu de l’équipage des deux goélettes, et c’est là que furent payées à nos hommes les primes qu’ils avaient bien gagnées!
Les cartes nous indiquèrent alors que le Paracuta avait débouqué sur le Pacifique entre la terre Clarie de Dumont d’Urville et la terre Fabricia, reconnue par Balleny en 1838.
Ainsi s’est terminée cette aventureuse et extraordinaire campagne qui coûta trop de victimes, hélas! Et, pour tout dire, si les hasards, si les nécessités de cette navigation nous ont entraînés vers le pôle austral plus loin que nos devanciers, si nous avons même dépassé le point axial du globe terrestre, que de découvertes de grande valeur il reste à faire encore en ces parages!
Arthur Pym, le héros si magnifiquement célébré par Edgar Poe, a montré la route… A d’autres de la reprendre, à d’autres d’aller arracher au Sphinx des Glaces les derniers secrets de cette mystérieuse Antarctide!
FIN DE LA SECONDE ET DERNIÈRE PARTIE
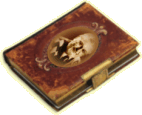
1 Les calculs, d’après Hansteen. placent le pôle magnétique austral par 128° 30’ de longitude et 69° 17’ de latitude. Après les travaux de Vincendon Dumoulin et Coupvent Desbois, lors du voyage de Dumont d’Urville à bord de l’Astrolabe et de la Zélée, Duperrey donne 136° 15’ pour la longitude, et 76° 30’ pour la latitude. Il est vrai, tout récemment, de nouveaux calculs ont établi que ce point devait se trouver par 106° 16’ de longitude est et 72° 20’ de latitude sud. On voit que l’accord à ce sujet n’est pas encore fait entre les hydrographes, comme il l’est en ce qui concerne le pôle magnétique boréal. J. V.
2 C’est précisément ce qui était arrivé: le lieutenant James Wilkes, après avoir été contraint de rétrograder treize fois, était parvenu à conduire le Vincennes jusqu’à 56° 57’ de latitude par 105° 20’ de longitude est. J. V.